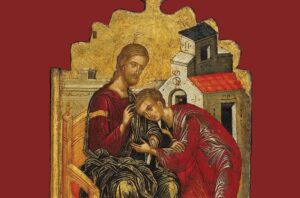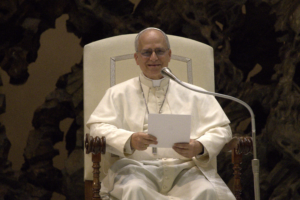Saint Grégoire (+ 604) a écrit la vie de saint Benoît moins d’un demi-siècle après le décès de celui-ci. C’est un joyau de la littérature de ce premier Moyen-Âge, plein de finesse et de candeur. Avant de décrire sa mort, il relate une vision singulière qu’eut le Patriarche des moines d’Occident : priant la nuit près de sa fenêtre, il vit un rayon de lumière venu du ciel dans lequel, dit le saint biographe, se trouvait contenue toute la création de tous les temps. Plutôt que d’imaginer une énorme caisse contenant tout ce qui est issu du bing-bang originel, saint Grégoire se contente d’en déduire une loi magnifique de la vie spirituelle, à savoir que « pour qui voit le Créateur, la créature est toute petite ». Au XIIIe siècle, le théologien grec Grégoire Palamas, pourtant très critique envers l’Occident latin, prend le fait comme l’apogée de la vie intérieure, mieux encore que tout ce qu’il magnifiait dans son propre patrimoine oriental.
Je crois que ce fioretti de la vie de saint Benoît mérite d’être cité dans son ensemble, car il inspire des pensées simples sur ce qu’attend le Bon Dieu de notre vie de baptisé. Saint Grégoire délivre son enseignement en répondant à un interlocuteur, le diacre Pierre. Immisçons-nous donc dans ce « dialogue », en reprenant candidement la question du diacre Pierre : « Quelle chose admirable et terriblement étonnante ! Qu’on puisse dire que le monde entier fut offert à ses yeux, rassemblé dans un seul rayon de soleil, cela ne m’est jamais arrivé ! Et par conséquent, je ne peux me le représenter. Comment peut-il bien se faire que le monde entier soit vu par un seul homme ? »
Voilà carrément dite l’objection qui nous brûlait les lèvres. Attendons la réponse du pape Grégoire : « Retiens bien, Pierre, ce que je te dis : Pour l’âme qui voit le Créateur, toute créature devient toute petite. L’âme ne contemple en fait qu’un faible rayonnement de la lumière du Créateur, mais tout le créé se réduit complètement pour elle ». Je comprends donc que la création perd l’attrait tyrannique qu’elle exerce sur moi dès que je suis branché sur Dieu. Mais déconnecté de Lui, ma relation à la créature devient ambiguë, sinon dangereuse. « La lumière divine intime, élargit le cœur qui grandit alors tellement en Dieu qu’il est placé au-dessus du monde », précise Grégoire, d’où l’on peut déduire qu’il ne s’agit pas là d’un privilège singulier dont saint Benoît fut le bénéficiaire. Toute grâce venue de Dieu dans ma vie a cette connotation d’union ; mon âme devient l’Unique de l’Époux, enrichie des splendeurs de la vie intérieure, sérieuse, rayonnante de Lui.
Grégoire veut croire que le diacre Pierre a bien compris ; il insiste pourtant devant celui qui se voit dépassé par cette invasion du Ciel, et cela vaut pour les béotiens que nous sommes tous : « L’âme du voyant se trouve donc au-dessus d’elle-même. Ravie ainsi et surélevée dans la lumière de Dieu, l’âme s’amplifie intérieurement ; et regardant en dessous dans cet état d’élévation, elle constate combien est petit ce que, au sol, elle ne pouvait étreindre ». Cette fin de phrase me paraît importante pour notre monde qui se croit scientifique en s’acharnant à scruter la créature, sans jamais s’en rassasier. D’ailleurs, les vrais savants ne se meuvent dans la recherche qu’avec respect, devinant que plus grand qu’eux n’est pas loin alors (Einstein, bien sûr, mais Stephen Hawking aussi, je pense).
Gardons enfin la conclusion de saint Grégoire : « Aussi quand je dis que le monde était rassemblé devant les yeux de Benoît, ce n’est pas que terre et ciel se soient contractés, c’est l’âme du Voyant qui s’était dilatée ; ravie en Dieu, elle pouvait voir, sans difficulté, tout ce qui était au-dessous de Dieu. Ainsi donc, en union avec la lumière divine jaillissante devant ses yeux, à l’extérieur de lui-même, de façon concomitante, son esprit bénéficiait d’une lumière intérieure ; celle-ci ravissait son âme vers les hauteurs, lui montrant combien sont exiguës toutes les réalités d’ici-bas. »