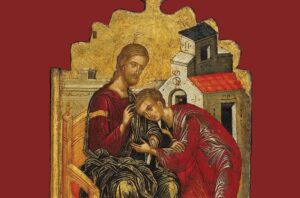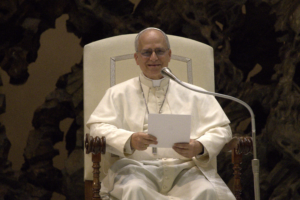L’évangile dominical évoque ces temps-ci, en fonction du missel suivi, les hauteurs de l’humilité ou le pouvoir divin du Christ de remettre les péchés. Mais cette année, la belle fête de saint Michel tombe un dimanche, occasion de rappeler le rôle particulier de l’archange dans la lutte contre Satan.
Ce dimanche, l’évangile lu dans le Missel romain de 1970 (Mc 9, 30-37) apporte à la fois gravité et douceur. En effet, pour la deuxième fois, Jésus annonce à ses disciples sa Passion, sa mort et sa Résurrection, mais ceux-ci « ne comprenaient pas cette parole » (v. 32). Il faut dire que leurs pensées étaient ailleurs, car ils discutaient entre eux pour savoir « qui était le plus grand » (v. 33). Et Jésus de leur enseigner que la grandeur réside dans la petitesse d’un enfant. Pour l’évêque oriental Théophylacte († 1109), choisi par l’Homiliaire patristique pour commenter ce passage, « le Seigneur ne contrarie pas leur désir de jouir de sa plus haute estime. Il veut, en effet, que nous désirions parvenir au rang le plus élevé. Il n’entend pourtant pas que nous nous emparions de la première place, mais plutôt que nous atteignions les hauteurs par l’humilité. » Dans le passage rapporté par l’évangile du Missel romain de 1962 (Mt 9, 1-8), Jésus déconcerte tout d’abord. Au paralytique qui lui demande sa guérison, il dit simplement : « Aie confiance, mon enfant, tes péchés te sont remis » (v. 2). Le Seigneur se place à un niveau bien supérieur. Selon saint Pierre Chrysologue († 450), « par ces paroles, il donnait à entendre qu’il était Dieu, bien que caché encore par sa nature humaine au regard des hommes : car ses miracles et ses prodiges le faisaient comparer aux prophètes (…), mais en accordant le pardon des péchés, ce qui est le privilège exclusif de la divinité, il montrait aux cœurs humains qu’il était Dieu ». À la guérison de l’âme, il joindra finalement celle du corps, mais en donnant au passage un bel enseignement sur le pardon des péchés qui rétablit dans l’âme la paix, déjà demandée par l’introït : « Donnez la paix, Seigneur, à ceux qui espèrent en vous » (Si 36,18) puis le graduel : « Que la paix règne dans ta force, [Jérusalem] et l’abondance dans tes tours » (Ps 121, 7). À la faveur d’une règle de préséance liturgique, dimanche 29 septembre, ceux qui suivent le MR 1962 célébreront la fête de…