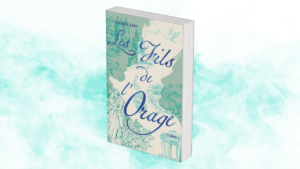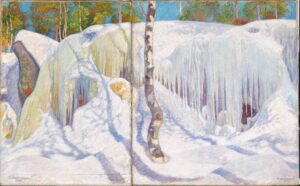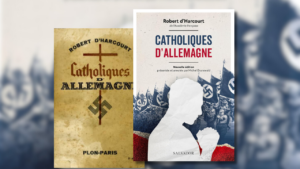Cet été : La tunique d'Argenteuil témoin de la Passion
Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 57 consacré à la sainte Tunique. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « La tunique d’Argenteuil témoin de la Passion »
Cet été : La tunique d'Argenteuil témoin de la Passion
Chaque jour à 13h, le clocher d’Argenteuil sonne trois coups, rappelant la geste de Charlemagne, venu déposer, entre les mains de sa fille abbesse Théodrade, une tunica venue d’Orient, la sainte Tunique du Christ.
« Les soldats, lorsqu’ils eurent crucifié Jésus, prirent ses vêtements et en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Et ils prirent aussi la tunique (1). Mais la tunique était sans couture, d’un seul tissu depuis le haut. Ils se dirent donc les uns aux autres: “Ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera.” Afin que l’Écriture fût accomplie: Ils se sont partagé mes vêtements, ils ont tiré au sort ma robe. (Ps 22, 19.) C’est ce que firent les soldats. » (cf. Jn 19, 23-24.)
Les premières communautés chrétiennes ont certainement pris soin de tout ce qui touchait à la personne du Christ, et en particulier de cette robe ou tunique sans couture sur laquelle saint Jean avait pointé son attention et qui sera par la suite considérée comme symbole de l’unité de l’Église (2). Mais que sait-on, historiquement, de ce vêtement insigne, témoin de la Passion de Notre-Seigneur comme de son agonie ?
La Tunique de l’Agneau immaculé
Son souvenir est évoqué à plusieurs reprises au cours des premiers siècles. Dès le VIe siècle, Grégoire de Tours évoque dans son Histoire des Francs « une Tunique de l’Agneau immaculé […] qui couvrit le corps bienheureux par excellence ». Cent ans plus tard, La Chronique de Frédégaire fait mention d’une sainte Tunique qui aurait été découverte, vers 590, à Zafad, qu’il faut identifier à Safed (au nord du lac de Tibériade), et qui fut transférée à Jérusalem la même année.
Dans son Discours III sur les images, en 726, saint Jean Damascène écrit : « Nous vénérons le saint Golgotha, le bois de la Croix […], la Tunique, les linceuls […] », semblant ainsi confirmer que la Tunique est toujours présente en Palestine. Mais au XIIe siècle, c’est en Europe que l’on retrouve sa trace. Au cœur du Saint Empire romain germanique, la cathédrale de Trèves (Trier) revendique la possession de la Tunique sans couture, qui aurait été apportée par sainte Hélène vers 327.
Des tissus datant de l’Empire romain
L’étude de cette relique a montré qu’elle comprenait une succession de couches protectrices, gaze, tulle et taffetas de soie ; il y aurait des morceaux de laine de couleur verdâtre, qui remonteraient au début de l’Empire romain, mais son très mauvais état et les restaurations qui en ont été faites ne permettent pas d’aller plus loin dans les conclusions.
À la même époque, la tradition locale d’Argenteuil, à une dizaine de kilomètres de Paris, fait aussi état d’une Tunique offerte à Charlemagne par l’impératrice Irène de Constantinople, qu’il avait envisagé d’épouser. L’empereur l’aurait confiée peu avant 814 (3) à sa fille Théodrade, abbesse de l’abbaye Notre-Dame d’Humilité d’Argenteuil, fondée au VIIe siècle par un riche seigneur.
Le bénédictin Eudes de Deuil, abbé de Saint-Denis en 1151, raconte le voyage de Charlemagne à Jérusalem, dans un poème épique, mais l’empereur n’y est sans doute pas allé en personne : Éginhard, son biographe, atteste qu’en 799, un moine de la Ville sainte, venant de la part du patriarche, a apporté à Charlemagne, alors à Aix-la-Chapelle, sa bénédiction ainsi que des reliques recueillies sur le lieu même de la Résurrection de Notre-Seigneur. Eudes de Deuil mentionne aussi le coffre d’ivoire qui servait de reliquaire à la Tunique, et montrait la Sainte Vierge travaillant au vêtement de son Fils et plusieurs scènes de sa Passion.
Une fille de Charles le Chauve, Judith, brièvement mariée à Ethelwulf d’Angleterre, succède à Théodrade comme abbesse d’Argenteuil (4) ; elle y serait restée jusqu’en 862. La « parcelle de la Tunique sans couture », conservée à l’abbaye Saint-Pierre de Westminster et mentionnée dans une charte de 1066 de saint Édouard le confesseur, roi d’Angleterre, pourrait provenir d’Argenteuil et avoir été donnée à l’époque de Judith.
Toutefois, dans sa Généalogie du royaume des Francs de la 3e race, écrite vers 1160, un moine de l’abbaye laonnoise de Foigny chercha à expliquer le surnom de Capet (Cappatus) donné à Hugues le Grand († 956), en suggérant qu’Hugues le Grand aurait rapporté la Tunique de Terre sainte (5)…
Nous en sommes donc réduits à des conjectures.
Pierre Dor
Historien d’art
1. Tunica (en latin), chitōn (en grec).
2. Saint Augustin, Traité sur l’Évangile de saint Jean, 118e homélie ; Commentaire des psaumes (Enarrationes in psalmos), 21 et 147.
3. En 1851, Bouterwek peint, dans la chapelle de la sainte Tunique de l’église d’Argenteuil, une fresque représentant l’arrivée de la relique offerte par Charlemagne à sa fille Théodrade.
4. Théodrade quitte Argenteuil pour l’abbaye de Swarzach quelque temps après 824, et meurt peu après 844 (en tout cas avant 853).
5. Pierre Dor, Une nouvelle attestation de la Tunique d’Argenteuil au XIIe siècle, Maulévrier, éd. Hérault, 2010.
>> à lire également : Les Croisades (1) | La première croisade