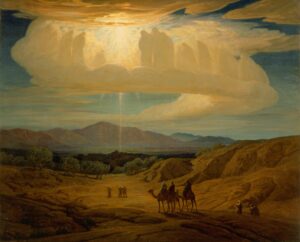20ᵉ dimanche ordinaire, année A
Anniversaire de la Dédicace d’une église
| Traduction | Ma maison sera appelée maison de prière, dit le Seigneur. En elle, celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et à celui qui frappe, on ouvre. (Mt 21, 13 ; 7, 8) |
Thème spirituel
La communion de la Dédicace des églises, emprunte son texte à deux passages de l’Évangile de Saint Matthieu, assez éloignés l’un de l’autre : le début : « Ma maison sera appelée maison de prière, dit le Seigneur » (Mt 21, 13) est relatif à l’épisode de Jésus chassant les vendeurs du temple ; et la fin : « celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et à celui qui frappe, on ouvre » (Mt 7, 8) renvoie à l’enseignement de Jésus sur la prière et son efficacité.
Le thème dominant de toute la messe de la Dédicace est bien celui de la maison de Dieu. On le trouve explicitement dès l’introït (domus Dei ou aula Dei). On le retrouve ici, dans le chant de communion où c’est le Christ qui parle (domus mea). Et on le trouve implicitement dans l’alléluia où c’est le mot templum qui est choisi ; ainsi que dans le graduel où est employé le terme plus vague de locus, déjà utilisé dans l’introït. Donc, toutes les pièces de la messe parlent de l’église de pierre comme signe : signe de la présence de Dieu, signe aussi de la communion avec Dieu, dans la prière notamment.
Le graduel parle même d’un signe inestimable et même sans reproche. On peut le dire de toute église. Qu’elles soient cathédrales, abbatiales ou paroissiales ; qu’elles soient grandes ou petites ; qu’elles soient plongées au cœur des grandes cités ou isolées dans nos campagnes ; qu’elles soient parfaites dans leurs lignes romanes ou gothiques ou plus modestes dans leur beauté architecturale, toutes nos églises nous parlent d’une présence et nous invitent à entrer en présence du Maître qui y réside.
Le deuxième thème est justement celui de la prière. Une dimension contemplative. L’introït ne le mentionne pas explicitement, sinon dans l’effroi divin que provoque la vision de ce lieu. Mais le graduel, l’alléluia, l’offertoire et surtout notre communion nous montrent bien que c’est pour la prière que ce lieu existe.
Prière de supplication dans le graduel ; prière de louange dans l’alléluia ; prière d’action de grâces dans l’offertoire ; prière de demande dans la communion. Il y a une belle progression dans cet ensemble. La crainte nous a mis dans une attitude primordiale, sous le regard de Dieu. Face au Dieu vivant, la conscience de notre néant nous invite à la supplication et à la confession de nos péchés.
On devient alors capable de louer Dieu pour tous ses bienfaits. De cette vue jaillit spontanément l’action de grâces. Et l’amitié divine étant solidement établie, notre prière de demande peut se présenter en toute confiance, et voilà le sens profond de notre communion. La liturgie est maîtresse de vie spirituelle, on le voit bien en scrutant ces chants et leur enchaînement.
Admirons comment le compositeur, en assemblant ces deux textes, a incliné le premier dans un sens on ne peut plus aimable. Il ne s’agit plus ici d’une parole de colère ou de menace (même si la colère de Jésus est profondément juste et bienfaisante) mais d’une invitation à l’admiration et à la confiance. C’est bien le Seigneur qui parle, et il convoque son Église autour de lui dans l’acte de communion. Il définit comme lieu de la rencontre d’amour cet édifice construit de main d’homme mais pour une destinée surhumaine.
Le compositeur a juste ajouté deux petits mots, si inspirés, qui font la jonction entre les deux textes de saint Matthieu : « en elle », c’est-à-dire dans l’église, mais aussi dans l’Église, mais aussi dans le sanctuaire de notre âme, mais aussi enfin dans le Cœur de Marie, première église de la chrétienté, premier temple et temple vivant de la présence de Dieu parmi les hommes.
Comme ils sont beaux ces deux petits mots qui évoquent l’épouse, le mystère féminin de l’accueil, de l’ouverture, de deux bras qui s’écartent et se resserrent pour recevoir et consoler, réconforter, nourrir. Dans ce climat de confiance, la prière est déjà exaucée, puisque la fin de la prière, c’est l’union à Dieu.
Commentaire musical
Comme souvent dans le répertoire grégorien, c’est la communion qui est la pièce la plus simplement joyeuse. Il s’agit d’ailleurs d’un 5ᵉ mode qui porte bien son nom : laetus. La joie traverse de part en part cette pièce. On peut la comparer avec la communion Petíte qui utilise elle aussi la seconde partie du texte de saint Matthieu. Cette communion Petíte est beaucoup plus sobre, très profonde, mais sérieuse. La mélodie ne s’envole jamais.
Ici, au contraire, elle est très aérienne, très vive. Elle a quelque chose de très affirmatif, voire même d’un peu triomphal. Dom Baron parle de spontanéité joyeuse (1), et cette joie est d’abord celle du Seigneur qui parle et qui laisse son bonheur s’épancher à l’idée de recevoir en son église et dans le beau mystère de la prière, les enfants qu’il a acquis au prix de son sang.
La pièce, pourtant assez longue, est composée de deux phrases musicales seulement, mais qui correspondent aux deux parties bien distinctes de l’Évangile de saint Matthieu.
La première phrase commence de façon plutôt sobre, mais déjà on pressent la joie. Elle est dans le tempo rapide de l’intonation ; elle est aussi et surtout dans la luminosité du Si naturel, atteint au sommet d’une belle vocalise joyeuse et vive, sur mea. C’est la complaisance du Seigneur pour son église qui est habilement soulignée ici.
Et tout de suite après l’intonation, la mélodie attaque sur la dominante Do avec un double Do très ferme mais aussi très enthousiaste. Il faut que cela se sente dans l’interprétation et on doit mettre beaucoup de cœur à lancer cette définition de l’église dans laquelle on est venu prier.
La suite de l’incise est d’ailleurs assez accidentée au niveau mélodique. Quelques grands intervalles, des petits passages syllabiques, tout cela contribue à donner aux mots domus oratiónis un caractère bien joyeux. L’apparition du Sib sur vocábitur amène une douceur appréciable, comme aussi le dicit Dóminus, sorte de signature de cette première phrase, avec sa progression très calme pour le coup, par degrés conjoints.
La seconde phrase commence de façon plus calme. Le Sib est toujours de mise, il y a de la douceur et un brin de mystère dans ce in ea omnis. Puis l’enthousiasme reprend ses droits, en quelque sorte avec le bel élan de qui petit qui se prolonge, après une toute petite et délicate distinction verbale entre les deux verbes, sur áccipit, le verbe de la première récompense. On renchérit ensuite sur et qui quaerit.
Même chose par rapport au verbe qui suit : une petite distinction verbale qui demande cette fois de prendre le second verbe (ínvenit) au levé du rythme, en faisant attention à ne pas déplacer l’accent tonique du verbe, car la syllabe qui suit est au posé et au grave, d’où la tentation de la marquer plus nettement que l’accent.
Quant au dernier membre de cette seconde phrase, il s’élargit sur l’accent de pulsánti, muni d’un épisème. C’est vraiment la complaisance du Seigneur qui se traduit ici musicalement. On sent la joie du Maître à l’idée d’ouvrir la porte de son cœur, de son royaume, à celui qui vient de frapper, c’est-à-dire de manifester son désir de lui appartenir. Il y a beaucoup de joie dans ce dernier verbe aperiétur. La porte s’ouvre sur la révélation du Bien-Aimé, sur l’éternité de la communion avec Dieu.
1. Dom Louis Baron, L’expression du chant grégorien, Kergonan, 1950, tome 3, page 319. Réédition Saint-Rémi.
>> à lire également : DOSSIER | Newman (1/3) : Qu’est-ce qu’un Docteur de l’Église ?