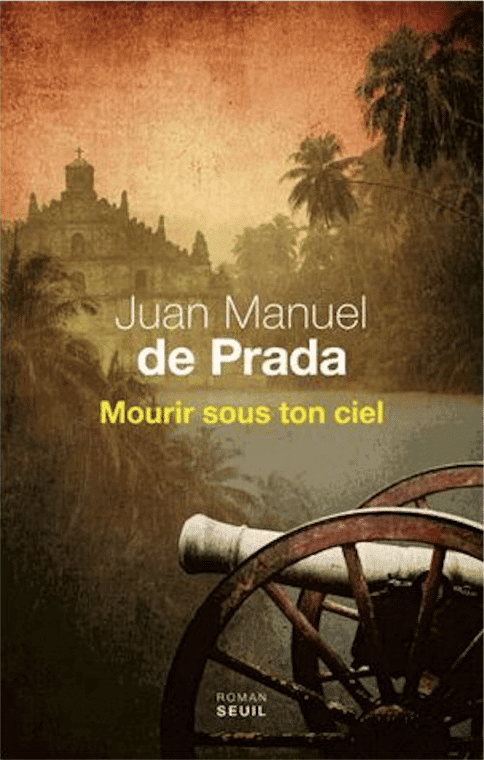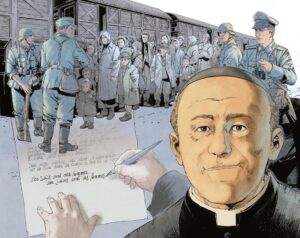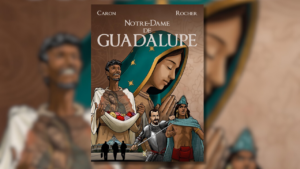Né en 1970, l’Espagnol Juan Manuel de Prada est entre autres éditorialiste et critique littéraire. Son roman Mourir sous ton ciel, qualifié de chef-d’œuvre, est désormais accessible en français. Il relate la résistance héroïque, à Baler, d’une poignée d’Espagnols voulant garder les Philippines à l’Espagne. Cette lutte se double du combat métaphysique qui se joue en l’âme des nombreux protagonistes, réels ou fictifs, tandis que le verbe magistral de l’écrivain porte haut les valeurs qui les animent parmi lesquelles l’amour de la patrie et une espérance invincible.
Internationalement reconnu pour son œuvre romanesque de grande ampleur, l’Espagnol Juan Manuel de Prada avait publié en 2014 un roman dont le titre, Morir bajo tu cielo, contenait presque une tonalité romantique. Aujourd’hui traduit en français, Mourir sous ton ciel nous transporte, en fait, aux Philippines, à la fin du XIXe siècle, dans un contexte historique dont nous autres Français, nous ignorons tout la plupart du temps.
Magellan fut le premier Espagnol à mettre le pied sur l’archipel, vite baptisé Philippines en l’honneur de l’Infant d’Espagne, le futur Philippe II. Après plusieurs siècles de présence, l’Espagne se vit contrainte, en décembre 1898, de les céder aux États-Unis. Une longue page se tourna alors, non sans que l’Espagne ait livré le cœur même de son existence, le trésor de son histoire et de sa vitalité, la sève de son amour : la foi catholique.
C’est aux dernières heures de la présence espagnole que s’intéresse justement Juan Manuel de Prada, dans ce roman, ou, plus exactement, à un épisode tragique, une sorte de bataille de Camerone, livrée par un petit détachement de soldats, dans le petit village de Baler.
Un fait historique
Comme il l’a déjà fait dans d’autres romans, Prada s’empare ici d’un fait historique, dont il ne dénature rien, mais sur lequel il greffe en quelque sorte des personnages fictifs qui se mêlent merveilleusement aux personnages et aux faits réels. Au fil du temps et des livres, le romancier espagnol a, en effet, développé son savoir-faire, donnant à lire de longs récits de mieux en mieux maîtrisés, toujours rehaussés par l’usage d’un vocabulaire particulièrement choisi et riche, qui doit donner par moments à son traducteur, Gabriel Iaculli (dont on peut saluer ici la performance), quelques sueurs froides.
Faut-il écrire aussi que le temps a assagi cette véritable force de la nature qu’est Juan Manuel de Prada et que sa longue quête personnelle semble le porter toujours davantage vers un approfondissement de l’héritage espagnol ? À ce titre, en tous les cas, Mourir sous ton ciel apparaît comme le livre le plus abouti du romancier et même s’il prend soin de préciser que les avis, les pensées et les discours de ses personnages leur appartiennent en propre, on semble retirer de cette lecture une vision d’ensemble des pensées de Prada lui-même.
Impossible, en effet, de réduire l’écrivain au seul rang de romancier, même s’il l’est de manière éminente. C’est aussi un homme engagé, éditorialiste vigoureux du quotidien madrilène ABC, animateur d’une émission de télévision, Lágrimas en la lluvia, qui propose des débats sur des thèmes politiques et culturels, qui, contrairement à ce que nous voyons trop souvent en France, réunissent des invités d’horizons les plus divers. Par ailleurs, Prada collabore de temps en temps à L’Osservatore Romano (il affirmait au début du pontificat actuel se sentir plus proche de la théologie de Benoît XVI mais en syntonie avec le positionnement anti-libéral au plan économique du pape François) ou à la petite (mais de très haute tenue intellectuelle) revue catholique Verbo, dirigée par son ami Miguel Ayuso.
Le catholicisme sourde d’ailleurs tout au long de ce roman. Pas simplement parce qu’il s’agit des Philippines et de l’Espagne. Pas uniquement parce que parmi les personnages principaux on croise une Fille de la Charité et un père franciscain. Mais, peut-être surtout, parce que le terrible conflit entre le bien et le mal, entre la grâce et le péché traverse l’âme de chacun des protagonistes, même et y compris l’indépendantiste Novicio, pourtant gagné au point de départ aux idées nouvelles.
Le péché et le mal présents
Le péché et le mal abondent donc dans ce livre, et, parfois crûment. Frère Cándido n’a pas toujours été fidèle aux exigences de son sacerdoce et il en porte douloureusement le remords. Le capitaine Enrique Las Morenas est tenu par l’honneur, ce qui lui évite de se laisser emporter par les inclinations de son cœur. Même sœur Lucià, qui reste jusqu’au bout fidèle à sa vocation, n’échappe pas tout à fait à l’ambiguïté des situations et des non-dits.
Mourir sous ton ciel n’a rien d’un roman à l’eau de rose ou d’un ouvrage du plus mauvais sulpicien. Il n’est certes pas à mettre entre toutes les mains. L’humanité s’y révèle à la fois dans toute sa capacité héroïque, mais aussi dans toute sa misère (les soldats du détachement), sa folie (celle du lieutenant Martín Cerezo ou celle du Hollandais Van Houten) ou sa cruauté (celle des Ilongos). L’amour, pourtant, triomphe, malgré la mort et malgré la haine. L’amour des êtres humains entre eux, surtout s’ils sont jeunes et porteurs d’espérance. Mais aussi l’amour de la patrie !
Ce dernier point est l’un des thèmes très fort de ce roman. Il le traverse de bout en bout et l’habite constamment. La patrie, c’est bien sûr cette Espagne qui se trouve au-delà des mers et qui prend souvent pour les protagonistes de ce livre, même les plus humbles, un visage et un nom, des couleurs, des senteurs et des sons. C’est l’Espagne, ou plus exactement, les Espagnes dans toutes les particularités de la topographie, de la géographie et de l’histoire. Nous ne sommes pas ici dans les contrées froides de Monsieur Descartes et de ce monde des idées claires et distinctes, mais plutôt au point de jonction du spirituel et du charnel.
La patrie, c’est encore ces Philippines, pressées d’arriver à maturité, jeunes adolescentes qui croient les beaux discours et qui se laissent emporter par les mirages. Des discours creux et des mirages lourds, ceux des États-Unis qui, pour mieux emporter le gros lot, suscitent un mouvement indépendantiste avant de se retourner contre lui pour mieux mettre la main sur les richesses du pays. Une histoire dont nous connaissons, malheureusement, les nombreux épisodes qui lui ont succédé.
Une fidélité revendicative
Qui dit patrie implique forcément la fidélité ! Fidélité toute chatouilleuse des Espagnols, entre le Cid et don Quichotte. Fidélité revendicative des Philippins qui rêvent de liberté et d’indépendance alors que se profile à l’horizon l’esclavage de l’argent.
Fidélité aussi aux grandes causes. Mourir sous ton ciel s’inscrit, à cet égard, dans le contexte du souvenir des guerres carlistes, de l’opposition irréductible entre les fidèles de don Carlos, serviteur d’une monarchie traditionnelle, catholique, légitime et décentralisée contre les tenants d’une monarchie constitutionnelle, libérale, asservie aux grandes oligarchies modernes. Tout le drame de l’Espagne du XIXe et du XXe siècle se joue dans cette opposition. Prada ne prend nullement partie et, encore une fois, c’est en chacun de ses personnages que le bien et le mal combattent. Mais, quand même ! Dans sa totalité, dans sa tonalité, l’héritage traditionnel habite ce roman.
On le retrouve d’ailleurs très clairement dans le personnage, humble, presque discret s’il ne tombait amoureux, de Chamizo, le maître d’école. Il s’agit là de l’une des figures les plus pures de cette histoire. Or, pour lui, « plus il est cerné par le progrès, plus l’homme est malheureux, formule qui ne manque pas de faire dire aux progressistes : “ce que vous voulez, c’est maintenir les peuples dans l’ignorance, sous prétexte de leur laisser le bonheur”, mais ce n’est pas du tout ça. On ne devient pas enseignant pour tenir les gens dans l’ignorance. Le fait est que le progrès détache l’homme de son milieu en prétendant affranchir son existence des limitations qu’imposent les cycles naturels, mais en le séparant ainsi de la nature, il l’appauvrit en l’empêchant d’avoir une vision du monde fidèle aux réalités pérennes, tangibles ; il est alors forcé à tout passer au crible de sa conscience. Or la réalité ne peut vivre prisonnière d’une conscience : si on le lui impose, elle se corrompt et devient nocive. C’est la tragédie de l’homme moderne, ce dont on ne parle jamais dans les journaux », conclut-il. Tous les opposants modernes au progrès, tous les défenseurs actuels des limites, ne sont généralement pas remontés aussi loin dans les raisons de leur refus du monde moderne. Il faut retenir cette leçon sur la réalité prisonnière d’une conscience. C’est exactement notre drame, le poids qui pèse sur nos frêles épaules, dans la situation qui nous est faite dans l’Église et dans la patrie.
Un capitaine, un détachement, un siège et un soleil de plomb ! Le siège de Baler a tout pour nous Français de celui de Camerone. Tout ou presque ! Les différences de détail sont innombrables. À Camerone, les légionnaires tinrent toute une journée devant l’assaut de 2 000 soldats mexicains avant d’être écrasés et quasiment tous tués. À Baler, le siège dura 11 mois et c’est dans une église que le détachement espagnol ainsi que deux prêtres franciscains trouvèrent refuge pour résister aux assauts des indépendantistes. Une trentaine survécurent. Dans les deux cas, pourtant, l’héroïsme et la fidélité à la patrie s’inscrivent dans une résistance acharnée et jusqu’au-boutiste. Le côté dramatique de Baler se trouve, en fait, dans l’ignorance où se trouvent les Espagnols de la paix signée et dans leur refus de croire aux différents signes qui le démontrent.
Montée en puissance
Si le roman de Prada trouve son point d’orgue dans le siège et dans les ultimes moments de la garnison, une très grande partie du livre se situe pourtant bien en amont et chaque chapitre, qui installe les personnages dans leur complexité, décrit les évènements et les situations, constitue comme une montée en puissance qui conduit le lecteur, haletant et parfois même oppressé, vers le dénouement. Malgré le mal qui occupe, au fur et à mesure de l’avancée de l’histoire, une place de plus en plus importante, le regard de Guicay cristallise en lui toute la pureté et l’espérance de cette histoire. Il faut donc s’y accrocher. Résolument !
Mourir sous ton ciel, de Juan Manuel de Prada
Traduit par Gabriel Iaculli
Aux éditions du Seuil, 24,90€