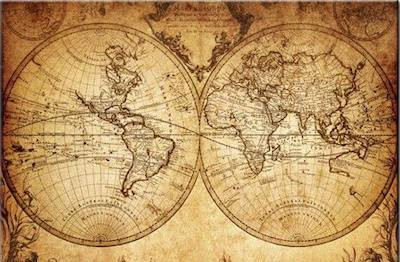Dans un long entretien qu’il a accordé au Figaro Histoire, Jean-Robert Pitte, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences morales et politiques, professeur émérite de géographie à l’université Paris-Sorbonne, revient sur l’importance décisive de cette discipline, trop délaissée aujourd’hui.
Comment expliquer la vision rébarbative que les Français semblent avoir de la géographie alors que l’histoire jouit, elle, d’une grande popularité ?
L’histoire nous fait rêver parce qu’elle est révolue. Aucune machine à remonter dans le temps ne nous y donnera plus jamais accès. Nous n’en connaissons que ce que nous en disent les livres. La géographie a beaucoup fait rêver à une certaine époque, elle aussi, pour les mêmes raisons que l’histoire, parce qu’elle évoquait des mondes inconnus. Il y avait très peu de chances, alors, d’aller visiter les terres lointaines. Celles-ci étaient donc revêtues d’une aura de mystère. Le blanc sur les cartes fascinait car il supposait tout un monde de dangers, de terres et de climats inhospitaliers, de peuples hostiles et d’animaux sauvages. La géographie permettait en outre de mieux connaître le monde dans lequel on vivait et surtout d’y agir. Aussi les rois et les puissants de ce monde étaient-ils passionnés de géographie, parce qu’ils avaient envie de connaître le monde, et parfois de le conquérir. Louis XIV, Louis XV et Louis XVI étaient entourés de savants géographes et de grands serviteurs de l’Etat (tel Vauban), qui partageaient avec eux une véritable culture géographique. Louis XVI était fou de géographie, et il avait écrit de sa main les instructions du voyage de La Pérouse, alors même qu’il ne verrait la mer qu’à une seule occasion, lors de son voyage (triomphal) de 1786 en Normandie au cours duquel il naviguerait un peu.
Comme l’a écrit Yves Lacoste en 1976 dans un livre célèbre, « la géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre ». De fait, la géographie a été indispensable aux militaires car il leur fallait connaître les lieux où leurs armées seraient appelées à intervenir. De là sont nées successivement les cartes de Cassini, financé par le roi pour cartographier la France, les cartes d’état-major du XIXe siècle, les cartes de l’IGN – ancien service du ministère de la Défense. Alors que les plaines céréalières étaient laissées en blanc sur les cartes, les vergers, vignes et forêts y étaient indiqués très précisément. Aucune autre raison à cela que militaire : vignes et forêts étaient indiquées car il était impossible d’y faire avancer des régiments de cavalerie !
Plus tard, la IIIe République a fait de la géographie un moyen de former le citoyen à la connaissance de son pays après l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine, indiquées en noir sur les cartes pour signaler que leur perte était un deuil national. En même temps qu’on enseignait l’histoire de France pour la faire aimer à ses fils, sur le conseil de Lavisse, on la leur faisait connaître par la géographie. Les élèves apprenaient par cœur les noms des départements, leur préfecture et leurs sous-préfectures. De grandes cartes illustraient, sur les murs de la classe, les spécialités agricoles de chaque province.
Les Français voyageant toujours peu, les grandes cartes de Vidal de La Blache, avec les océans et les grands aplats roses marquant nos colonies continuaient de faire rêver. Tout change après la Seconde Guerre mondiale, lorsque se développent les voyages. Le monde, soudain, se rétrécit, la géographie perd une part de son exotisme.
Il faut reconnaître que l’université française a sa part de responsabilité dans la désaffection qui frappe alors la matière. Elle a d’abord favorisé excessivement la géomorphologie, qui a émergé dès la première moitié du XXe siècle autour d’Emmanuel de Martonne, le gendre de Vidal de La Blache. Pour Martonne, elle devait permettre aux géographes d’être enfin pris au sérieux par les « sciences dures ». Or cette géographie physique pure et dure, ultra-spécialisée, qui met en rapport le relief, la géologie, le climat et l’érosion à travers des commentaires de cartes a terrorisé les historiens et découragé plus d’un élève ! De son côté, la géographie humaine, à cause de l’influence du marxisme à l’université, surtout à Paris, bascule dans une géographie très matérialiste, analogue à celle qui prévaut en Union soviétique, où il faut tout compter : les masses de population et la production de matières premières agricoles et industrielles (minerais, pétrole, etc.), le tout sous un angle quantitatif. Les statistiques envahissent les programmes du secondaire.
Dans le même temps, on délaisse au contraire la géographie culturelle, soit l’étude de l’influence de la liberté humaine sur l’organisation de l’espace. Les travaux de Roger Dion ou de Pierre Gourou, professeurs au Collège de France, qui la perpétuent, sont ignorés ou méprisés. C’est pourtant Gourou qui a montré de façon géniale que c’est pour des raisons culturelles qu’on compte 500 habitants au kilomètre carré dans les deltas du Vietnam ou de Chine et 2 habitants au kilomètre carré en Afrique : parce qu’en Asie on sait lire et écrire, qu’on respecte son père, son patron ou le chef du village, on y est capable de maîtriser un système d’irrigation complexe comme celui des rizières. Cette capacité est liée à ce que Gourou a appelé « l’encadrement social ». Cette branche de la géographie, qui nous donne des clés précieuses pour comprendre le monde, est devenue le parent pauvre de la discipline, en dépit des efforts d’immenses savants comme mon maître, Xavier de Planhol, qui affirmait que la géographie avait pour but de répondre à la question : « Pourquoi ici et pas ailleurs ? »
Au contraire, la géographie économique, marxisante, a abouti dans les années 1990 à un mariage inattendu entre les mathématiques et la géographie. Il s’agissait d’encadrer la géographie par des modèles théoriques, comme en physique ou en chimie, pour y faire rentrer la réalité au chausse-pied. Dès lors, le culturel, qui ne se compte pas et n’est donc pas jugé scientifique, a fini par ne plus exister. Dans cette perspective, des questions comme « Pourquoi mange-t-on salé ici et sucré là ? » ne présentent aucun intérêt, alors que, pour moi, elles sont essentielles, puisqu’elles s’intéressent à ce qui donne de la couleur à la vie et, au-delà, ce qui donne envie de vivre. Cette vision quantitative des choses a également gommé le rôle du sacré. Or celui-ci est capital. Si les tribus amazoniennes ne croyaient pas qu’il y a des divinités dans les arbres, les oiseaux ou les serpents, elles ne pourraient pas supporter leurs conditions d’existence. C’est le fait de vivre dans un monde enchanté qui donne les moyens d’y vivre. Dès lors que le monde est désenchanté, il devient un enfer que l’on fuit.
La réhabilitation de la géographie passe donc à mes yeux par celle de la géographie culturelle, celle qui m’a personnellement permis d’étudier des sujets aussi divers que le vin, l’aménagement des paysages, la gastronomie ou les religions. C’est elle qui rend particulièrement précieuse notre discipline pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, ce qui devrait être, il me semble, le premier objectif de la géographie.