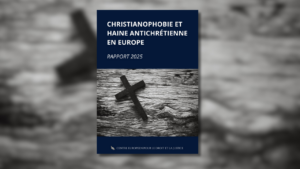Directeur de l’European Center for Law and Justice (Centre européen pour le droit et la justice), et actif à ce titre auprès de l’Onu et des instances européennes sur les sujets de bioéthique, Gregor Puppinck a dirigé la publication de Droit et prévention de l’avortement en Europe [1]. Il analyse les conséquences de la constitutionnalisation de l’avortement récemment proposée par le président de la République.
| À la suite de l’annonce d’Emmanuel Macron d’un projet de loi constitutionnelle inscrivant dans la Constitution « la liberté des femmes de recourir à l’IVG », votre association appelle à signer une pétition pour la protection de toute vie humaine. Quel est l’objectif de cette initiative ?
Il s’agit d’abord de montrer qu’il existe une opposition à l’avortement et qu’une autre politique est possible. Nous l’utiliserons auprès des institutions françaises et du Conseil de l’Europe, plus précisément au Comité des droits sociaux, chargé de veiller au respect des droits sociaux notamment en matière de protection de la maternité et du droit de la famille. Notre objectif est de démontrer que le gouvernement français ne prend pas suffisamment de mesures en matière de prévention de l’avortement.
Actuellement, la France a le taux d’avortement le plus élevé en Europe, alors qu’il diminue chez nos voisins. Selon Eurostat et l’Ined, 298 avortements ont été réalisés pour 1 000 naissances en France en 2020, contre 129 en Allemagne et 125 en Suisse. C’est plus du double, toutes proportions gardées. En France, ces avortements sont moins compensés par les naissances, car celles-ci diminuent alors que l’IVG reste très élevée. En 2022, le nombre moyen d’enfant par femme a encore baissé, pour atteindre 1,8. C’est l’immigration qui contribue à présent « pour près des trois quarts à la hausse de la population », selon l’Insee.
| Pourquoi l’avortement fait-il l’objet d’une telle obstination de la part de ses défenseurs en France ? D’où vient cette volonté de le sacraliser ?
C’est une question bassement idéologique. L’avortement a été présenté en France comme un progrès, associé à une libération dans le combat féministe, porté par la franc-maçonnerie, bien plus présente que dans la plupart des autres pays européens. L’avortement est un dogme, presque un sacrement : l’affirmation de la domination absolue de la volonté individuelle sur la vie humaine.
D’autres pays européens ont une histoire différente. En Pologne par exemple, l’avortement a d’abord été imposé par les nazis, comme arme démographique, pour affaiblir ce peuple. Dans d’autres pays, il est surtout associé au communisme. Ainsi, la Yougoslavie de Tito est le seul pays à avoir inscrit le droit à l’avortement dans la Constitution – ce qui fut supprimé à la fin de la dictature. Ces pays ont donc une autre vision de l’avortement, pas du tout féministe, ce qui facilite une politique réaliste de prévention de l’avortement.
À l’inverse de la France, où nous dépassons 230 000 avortements par an, le recours à l’avortement baisse considérablement chez nos voisins. Depuis 2000, il a été réduit de moitié en Italie (de 135 133 à 66 413), et est passé de 134 609 à 99 948 en Allemagne (Eurostat). Cette baisse n’est pas due au seul vieillissement de la population, car le taux d’avortements par naissance a baissé considérablement, passant de 150 à 129 avortements pour 1 000 naissances en Allemagne, et de 195 à 162 avortements pour 1 000 naissances en Italie, entre 2013 et 2020.
En France, il reste autour de 300 avortements pour 1 000 naissances. En Hongrie, grâce à une forte politique de prévention, le recours à l’avortement a été divisé par deux entre 2010 et 2021, passant de 40 450 à 21 900 avortements par an. Ici non plus, cela n’est pas dû au seul vieillissement de la population, car le taux d’avortement par femme en âge de procréer a baissé de plus de 42 % sur cette même période (source : https://www.statista.com).
| Concrètement, qu’est-ce qu’une politique de prévention ?
De nombreuses mesures concrètes de prévention méritent ainsi d’être mises en œuvre, visant en particulier à mieux éduquer les jeunes, à aider les femmes et à responsabiliser les pères. L’éducation sexuelle et la contraception ont longtemps été présentées comme les meilleurs moyens de prévenir l’avortement. Pourtant, dans les pays qui ont généralisé la contraception et l’éducation sexuelle dès l’école primaire, le nombre d’avortements ne baisse pas, en particulier chez les mineures.
Dans les pays comme le Royaume-Uni, la Belgique ou la France où le recours à la contraception a été le plus généralisé, le nombre d’avortements n’a pas baissé car les femmes recourent plus souvent à l’IVG en cas de grossesse non prévue. À cet égard, il est frappant que la grande majorité des femmes qui avortent en France utilisent un moyen de contraception. Il est donc urgent de réfléchir à une véritable prévention de l’avortement, pour réduire celui-ci notamment chez les jeunes, pour que les femmes n’y soient plus contraintes par leur situation économique, sociale ou affective.
La prévention passe d’abord par une meilleure éducation sexuelle et affective, mais aussi physiologique, qui informe en vérité sur le cycle féminin et le développement de l’enfant, sur la dimension relationnelle de la sexualité, ainsi que sur la réalité concrète de l’avortement et de ses conséquences. Cette éducation aiderait les jeunes, les femmes et les couples à agir de façon plus responsable et plus humaine.
Aux États-Unis, le taux de grossesses adolescentes a été réduit de moitié entre 1990 et 2010 grâce à une campagne visant à la responsabilisation et à la valorisation de la sexualité et de la vie humaine. Le nombre d’élèves de terminale se déclarant abstinents a doublé, passant de 33 % à 66 %, provoquant une réduction des deux tiers des avortements chez les jeunes, un recul des maladies sexuellement transmissibles et une amélioration de leur équilibre affectif et psychologique (voir l’ouvrage Droit et prévention de l’avortement en Europe).
La prévention passe aussi par des mesures d’ordre social et économique. En effet, les statistiques démontrent le déterminisme social de l’avortement : plus une femme est pauvre et isolée, plus elle a de risques de subir un avortement et d’en souffrir psychiquement. Les femmes seules ont un risque supérieur de 37 % à celui des femmes en couple de subir un avortement.
De même, les femmes faisant partie des 10 % les plus pauvres ont un risque supérieur de 40 % de subir un avortement par rapport aux 10 % les plus riches, à groupe d’âge et situation conjugale identique (selon la DRESS). Selon un sondage de l’Ifop, la moitié des femmes françaises déclarent que la « situation matérielle » constitue « l’influence principale qui pousse une femme à recourir à l’IVG ». Pour ces femmes, pauvres et seules, l’avortement n’est pas une liberté !
Si monsieur Macron voulait vraiment aider les femmes et les rendre plus libres, il lutterait d’abord contre ces déterminismes.
| Quels seraient les risques de l’adoption de ce projet de loi ?
On peut retenir deux effets principaux.
Le premier est symbolique. Il s’agit d’ériger l’avortement en dogme dans la Constitution : c’est un acte de foi matérialiste affirmant que l’homme n’a pas d’âme, la vie n’est que matière, la volonté prime la vie, et la liberté s’identifie à cette puissance. Inscrire l’avortement dans la Constitution revient à en faire une forme de religion d’État tant ses implications sont terribles.
Le deuxième effet est une menace directe sur les libertés de conscience et d’expression.
Aujourd’hui, le principe est le respect de la vie dès son commencement, et l’avortement l’exception. Placer l’avortement dans la Constitution renverserait cette équation. S’agissant de la clause de conscience, elle est prévue explicitement dans la loi, et pourrait donc être remise en question si elle est considérée comme faisant obstacle à la liberté d’avorter.
Il deviendrait possible de justifier sa suppression au nom de l’objectif constitutionnel d’effectivité de l’accès à l’avortement. Cela pourrait être réalisé par le Parlement, par l’abrogation de la clause, ou par une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), adressée au Conseil constitutionnel à l’occasion d’une affaire introduite contre un médecin objecteur.
La liberté d’expression pourrait aussi être encore plus limitée, car une fois dans la Constitution, l’avortement serait associé aux valeurs de la République.
[1] Droit et prévention de l’avortement en Europe, sous la direction de Grégor Puppinck, LEH, 2016, 300 p., 19,32 €.
>> à lire également : Élections polonaises : les non-dits