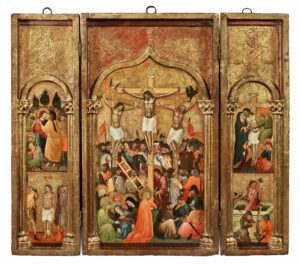Du fait de la loi de séparation de 1905, la restauration de Notre-Dame de Paris est bien à la charge de l’État. Mais qu’en est-il du remplacement du mobilier liturgique ? Quels textes législatifs régissent cette question ? Réponse par un spécialiste en droit public. Notre-Dame de Paris, née du génie des bâtisseurs de cathédrales il y a plus de 850 ans, continuera de traverser les siècles. La dame de pierre se remet peu à peu des graves blessures causées par un incendie de 15 heures, les 15 et 16 avril 2019. Tant la structure de ce joyau de la Chrétienté en France que son mobilier liturgique furent atteints. Par application de la loi du 9 décembre 1905 de séparation des Églises et de l’État, le bâtiment et la structure de Notre-Dame, au même titre que les 67 cathédrales de France, sont la propriété de l’État. La République a donc par cette législation contracté l’obligation de conduire et financer tous les travaux d’entretien, de réparation et de restauration du bâtiment en lui-même ! En 1862, Notre-Dame a été classée monument historique. Aujourd’hui, cette obligation s’inscrit donc dans le cadre de la loi Malraux du 4 août 1962[1] mais aussi de la Charte internationale sur la conservation et la restauration des monuments et des sites du 31 mai 1964. Cette charte est importante car elle oblige l’État à conduire des restaurations « se fondant sur le respect de la substance ancienne et de documents authentiques ». Tant que cela demeure possible, les techniques et matériaux anciens seront employés. Ce principe est respecté par la loi du 29 juillet 2019 pour la restauration et la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet[2]. Cette loi encadre une souscription nationale de levée de fonds, consacrée au financement de la restauration et de la conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de son mobilier, dont l’État est propriétaire, ainsi qu’à la formation des métiers d’art et du patrimoine nécessaires à la conduite des travaux. Se pose néanmoins une question importante dans le cadre de l’application de la loi du 9 décembre 1905 : qui est propriétaire du mobilier liturgique de Notre-Dame, destiné essentiellement à l’exercice du culte ? Qui est responsable financièrement de son achat, de son entretien et de sa restauration ? L’article 2 de la loi du 29 juillet 2019 est explicite sur ce…
Dans le secret des Archives du Vatican
Mgr Sergio Pagano, qui a dirigé les Archives du Vatican pendant plus d’un quart de siècle, expose, dans un livre-entretien, le fonctionnement de cette institution célèbre et méconnue à la fois. Et il met en lumière certains des dossiers sensibles qui y sont conservés.