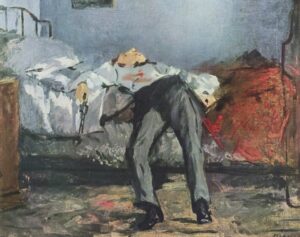Comme chaque année à la même date, ce jeudi 21 mars marque la journée mondiale de la trisomie 2. L’occasion de faire le point sur l’avancée des recherches concernant cette maladie avec Catherine Lemonnier, médecin et directrice de la recherche à la Fondation Jérôme Lejeune.
La fondation Jérôme Lejeune soutient actuellement une soixantaine de projets de recherche sur la trisomie 21 qui visent à corriger la déficience intellectuelle. Quelles sont ces recherches et ces avancées médicales dans le domaine de la trisomie 21 ? En quoi la recherche sur la trisomie 21 est-elle essentielle ?
La trisomie 21 fait partie des aneuploïdies, c’est à dire que les cellules comportent une anomalie du nombre des chromosomes qui sont porteurs du matériel génétique. Il y a un chromosome supplémentaire sur la paire 21 qui comprend trois chromosomes au lieu de deux. Ceci entraîne des conséquences sur ces enfants, notamment dans le processus de développement qui est plus lent que dans la population générale, accompagné de troubles d’apprentissage, de mémorisation, de malformations fréquentes dès la naissance avec des particularités du visage bien connues.
Ces malformations dès la naissance sont essentiellement cardiovasculaires. Un certain nombre de ces personnes développe des pathologies associées au cours de leur vie, de façon plus fréquente que dans la population générale et celles-ci doivent être dépistées (en particulier Alzheimer ou pathologies auto-immunes). La recherche pour la trisomie 21 est au cœur de notre stratégie. Le but ultime est de trouver un traitement qui permettra d’améliorer progressivement les capacités cognitives, d’apprentissage, de développement afin que ces personnes avec trisomie 21 puissent se développer et suivre un parcours scolaire, puis parcours d’adulte avec une autonomie le plus proche possible de celui de la population générale.
Quels sont vos principaux objectifs en termes de recherche sur la trisomie 21 ?
C’est d’arriver à trouver un traitement qui permettrait de résoudre ou de diminuer ces troubles cognitifs et d’apprentissage. Ces enfants ne vont pas changer, mais le but est que nous puissions donner à ces enfants une meilleure capacité de développement, de mémorisation, d’adaptation, et de retrouver des capacités qu’ils ont un peu enfouies en eux et pouvoir ainsi les aider.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les chercheurs dans le développement du traitement ?
Le principal défi à relever réside dans le domaine financier pour identifier la molécule optimale. À mesure que l’on progresse vers les premières phases de test précliniques dans le processus de développement d’un médicament, les coûts deviennent exorbitants. Les phases préliminaires se font grâce à des donateurs privés. Il est impératif de rechercher ensuite d’autres partenaires (investisseurs, industriels…) afin de garantir la continuité du développement du traitement pour les phases cliniques en particulier.
Pourriez-vous décrire les avancées les plus récentes dans la recherche pour corriger la déficience intellectuelle associée à la trisomie 21 ?
L’espérance de vie des personnes trisomiques au début du 20e siècle ne dépassait pas les 20 ans. Elle est actuellement de plus de 60 ans. Cette avancée a été en particulier possible par la mise en place de dépistage précoce de toutes les pathologies associées : traitement des malformations cardiovasculaires qui existent dès la naissance, surveillance de l’apnée du sommeil très présente chez ces personnes, dépistage de troubles infectieux latents et aide au développement… Un suivi attentif régulier par des médecins connaissant la trisomie 21 et ces personnes est nécessaire. L’Institut Jérôme Lejeune avec ses médecins et paramédicaux suit actuellement une cohorte de plus de 13 000 personnes vues régulièrement.
Nous avons aussi des recherches qui sont focalisées sur deux gènes présents sur le chromosome 21 en particulier le gène DYRK1A surexprimé car présent sur les 3 chromosomes présents, source des troubles cognitifs liés à la trisomie 21 et une des causes de maladie d’Alzheimer en particulier et le gène CBS (cystathionine B-synthase) également sur le chromosome 21.
Le projet DYRK1A est entré en essai clinique de phase 1, en partenariat avec la société de biotechnologies Perha Pharmaceuticals. Quant au projet CBS, c’est une autre piste très prometteuse suggérée auparavant par le Professeur Jérôme Lejeune et confirmée par des travaux récents. Ces dernières années, les équipes de recherches ont identifié des molécules capables de limiter l’activité de CBS dans la trisomie 21. Le défi est de confirmer les critères pharmacologiques des molécules, candidates sur différents modèles cellulaires et animaux, pour ouvrir la voie à l’évaluation clinique de la sécurité et de l’efficacité d’un traitement.
Comment la Fondation Lejeune travaille-t-elle pour sensibiliser le public et mobiliser des fonds pour la recherche ?
La Fondation a trois missions principales, une mission de recherche, de soin et de défendre la vie.
Ses trois missions sont intriquées. La recherche de fonds se déroule sur ses trois missions.
En parallèle aux projets de recherche plus spécifiques décrits précédemment en vue du développement de médicaments, la recherche fondamentale pour mieux comprendre le fonctionnement des cellules se poursuit grâce à des financements de projets, qui nous sont soumis par des chercheurs du monde entier et évalués par notre conseil scientifique. Les dons nous permettent de financer environ 20 à 25 projets annuels de 50 à 90 K € chacun. La fondation aide aussi beaucoup les chercheurs à s’orienter vers la recherche sur la trisomie 21 par différents moyens.
>> à lire également Irlande : Les propositions de modification de la constitution rejetées