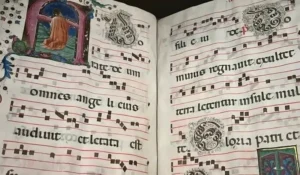Commentaire de l’allocution du Pape lors de l’Audience générale du 13 septembre 2020
Le Pape poursuit ses allocutions post-pandémie, sur la guérison, en abordant cette fois un aspect nécessaire à toute guérison : se laisser soigner. Cela est déjà vrai au plan naturel : un malade qui refuserait d’accomplir les prescriptions médicales, ou pire d’aller voir le médecin. Il en va de même pour la guérison spirituelle. Si vous ne vous soignez pas en allant vous confesser et en recevant les sacrements, votre âme ne sera jamais guérie et votre salut est en danger. Mais il faut aussi se soigner mutuellement, car si le salut est individuel, nous nous sauvons aussi collectivement, en vertu du magnifique dogme de la communion des saints. Il faut savoir prendre soin des malades de tout genre, comme le demande l’Évangile, et sans attendre aucune rémunération.
Un vaccin spirituel, garanti sans effet secondaire
La maison commune qu’est la Terre doit aussi être sauvegardée comme l’avait enseigné le Pape dans son encyclique Laudato si’. Si l’homme est le roi de la création et si Dieu a voulu que toutes les créatures minérales et vivantes lui soient soumises, il lui est en revanche interdit d’abuser de cette création. Et le Pape prescrit la contemplation comme antidote ou comme seul vaccin possible à cette destruction et à cet usage impropre de la maison commune. L’homme ne doit jamais considérer la création comme simple ressource, car chaque créature et un rayon de la sagesse divine et par les créatures nous devons, en contemplant leur beauté, atteindre leur source elle-même, qui est éternelle. C’est l’enseignement du Livre de la Sagesse, mais aussi celui de saint Paul au premier chapitre de son épître aux Romains. La contemplation de la création doit nous faire découvrir la beauté qui clôt les lèvres, selon les mots de sainte Angèle de Foligno. Et c’est parce qu’elle est un rayon de la sagesse et de la lumière divine, que la contemplation guérit les âmes. Il suffit ici de penser à un saint François d’Assise, ou à un Père de Foucauld émerveillé par le ciel saharien ou la nature marocaine. On pense ici à la parole que la sainte Vierge adresse au ravi, dans la « Pastorale des santons de Provence » : « Le monde sera merveilleux tant qu’il y aura des hommes capables comme toi de s’émerveiller ».
Collaborer à l’œuvre divine
Mais à l’inverse, sans contemplation, l’homme tombera rapidement dans un anthropocentrisme extrêmement orgueilleux. Sans contemplation, le moi de l’homme devient le centre de tout et surdimensionne son rôle par rapport au reste de la création. Une interprétation erronée, ou simplement déformée, du devoir de l’homme de mettre en valeur la création en a conduit plus d’un à exploiter la terre jusqu’à l’étouffer. Or ici peut résider un péché grave. L’homme n’est pas le maître de la création. Le maître, c’est Dieu. La création est au service de l’homme, mais celui-ci ne doit pas en faire son bien uniquement personnel. Prétendre prendre la place de Dieu en supprimant son rôle de créateur et de provident, voilà un péché actuel très grave, car il détruit l’harmonie de la création et par là son harmonie dans le dessein de Dieu. En oubliant sa vocation de gardien de la vie, certains sont devenus prédateurs, au service du diable qui ne cesse de vouloir détruire l’homme appelé à la vie éternelle. Cela ne veut pas dire pour autant que le travail ne soit pas fondamental pour l’homme. À la suite du péché originel, le travail est devenu une peine, mais nous ne devons jamais oublier sa dimension première, qui est de collaborer à l’œuvre de Dieu. Le travail n’est pas exploitation, il est au contraire protection. En travaillant, l’homme prend soin de lui et de toute la famille humaine. Que Marie nous aide à comprendre que contempler et prendre soin sont les deux attitudes indispensables pour sauver la création.