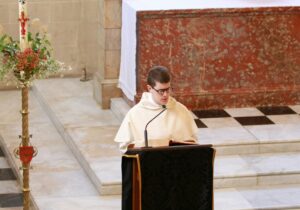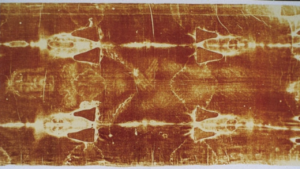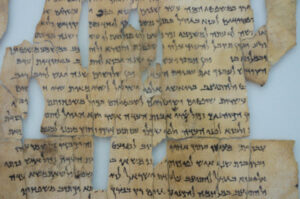L’Europe, dans ses structures officielles, semble s’être détournée à tout jamais du christianisme authentique. La guerre paraît s’être installée à ses portes. La culture classique elle-même est rejetée au nom d’idéologies révolutionnaires. Ce tableau alarmant renvoie l’observateur attentif et féru d’histoire à une autre grande époque de décadence de l’Occident : le VIe siècle, marqué par saint Benoît.
La figure du Patriarche des moines d’Occident (dont l’Eglise fête aujourd’hui la translation des reliques), nous offre, aujourd’hui comme hier, une réponse à cette décadence : la Règle qu’il rédigea à l’intention de ses moines.
« La Règle de saint Benoît, écrivait le pape Benoit XVI en 2006, est comme une lumière pour notre chemin. Le grand moine demeure un véritable maître à l’école duquel nous pouvons apprendre l’art de vivre le véritable humanisme. »
Ce sont en particulier trois aspects de la sagesse de la Règle que nous pouvons réaliser dans notre vie de chrétiens.
Retrouver l’obéissance
« Ecoute, mon fils, les préceptes de ton Maître, prête-moi l’oreille de ton cœur : accueille les avis d’un tendre Père afin de les accomplir efficacement et de revenir par le labeur de l’obéissance à celui dont t’éloignait la lâcheté de la désobéissance. »
Ces mots par lesquels saint Benoit débuta sa Règle nous placent d’emblée dans la perspective caractéristique de son œuvre d’évangélisation de l’Occident : c’est en vivant l’obéissance chrétienne, sur le modèle de celle du Christ, que les barbares du Ve siècle purent être convertis.
Et c’est sans nul doute par la même voie que les nouveaux barbares, héritiers malheureux d’un rejet de toute forme de loi naturelle, pourront retrouver leur identité en même temps que la chrétienté de leurs ancêtres.
Cette obéissance, à l’exemple de celle des moines, s’exerce à l’égard d’une règle de vie : loin d’être une barrière infranchissable qui nous empêche de quitter le droit chemin, cette règle est bien plutôt une sorte de guide, dont le franchissement devrait nous alerter sur le péril prochain d’une capitulation face à la tentation (pour peu que nous examinions encore notre conscience).
Cette liberté intérieure que nous gardons vis-à-vis de la règle explique l’avertissement de la prieure à sœur Blanche dans le Dialogue des carmélites de Bernanos : « Ce n’est pas la Règle qui nous garde, c’est nous qui gardons la Règle », mais le curé d’Ambricourt, dans le Journal d’un curé de campagne, lui rétorque : « Garder le silence, quel mot étrange ! C’est le silence qui nous garde. » Il s’agit en réalité d’un cercle vertueux : plus nous serons fidèles à la règle de vie, plus cette règle nous donnera les moyens de lui rester fidèles.
La primauté de l’Œuvre de Dieu
La Règle est toute orientée à l’Office divin : c’est en donnant la primauté d’honneur à l’Œuvre de Dieu que le moine établit dans sa vie un climat de vie intérieure : cette même vie intérieure que refuse la civilisation moderne, aux dires de Georges Bernanos, puisque cette civilisation ne cherche qu’une chose : étouffer le discernement dans les âmes afin d’imposer sa doctrine mortifère aux individus.
« Il y a dans le monde, constatait dom Gérard, une dose d’inconscience et de médiocrité qui ne peut être compensée que par des âmes éprises de vie intérieure. » Aussi faut-il nécessairement que certaines âmes, à la suite de saint Benoît, répondent à l’appel divin. Retranchés du monde, ils seront comme les phares brillant dans les ténèbres qui parfois s’amoncellent dans les âmes. Ils prieront pour la fidélité de ceux qui restent dans le monde, en leur montrant la radicalité généreuse de l’offrande de leur vie comme un bel idéal de chrétienté.
Mais de quoi peut bien être constitué le cœur de cet idéal chrétien ? Saint Benoît nous répond : « Ora et labora. Prie et travaille. » L’Œuvre de Dieu, l’Office divin (qui se prolonge avec toutes les formes de prières personnelles) étant mise à la place d’honneur dans la journée du moine, il acquerra une fécondité surnaturelle qui irriguera toutes ses œuvres. Presque mille ans plus tard, cette primauté du service de Dieu se retrouve dans la devise de sainte Jeanne d’Arc, « Messire Dieu premier servi ! »
Si la vie de l’homme moderne est si étouffante, entre atrophie intellectuelle, activisme effréné et perte du sens de la vie comme du réel, ne serait-ce pas parce que nous avons délaissé la prière, ou que nous l’avons réduite à la portion congrue ? Bernanos écrivait : « Il faut se nourrir à proportion de ses fatigues, et la prière doit être à la mesure de nos peines. » Le modèle bénédictin nous enjoint donc à retrouver le primat de la prière, seul moyen de donner la pleine valeur surnaturelle à notre activité humaine.
Être dans le monde sans être du monde
« Nul ne peut servir deux maîtres » (Mt. 6, 24), nous avertit Jésus. Nous le comprenons assez bien, mais butons souvent sur la mise en pratique de cet axiome : d’aucuns trouveront commode de s’accorder des compromis avec l’esprit du monde ; d’autres jugeront impossible d’arrêter la course de ce monde vers l’abîme et chercheront à s’en extraire définitivement.
A ces derniers, André Charlier, dans Que faut-il dire aux hommes, répond : « Il ne faut pas fuir le monde, il faut s’y enfoncer : là est la liberté, parce que là est la vérité. »
Aussi la solution à cette exigence de l’apostolat sans compromis se trouve-t-elle proposée par le « pari bénédictin » de Rod Dreher : pour vivre en chrétien dans un monde qui ne l’est plus, plutôt que de rechercher une fuite du monde dans une perspective de repli sur soi communautariste, il convient de s’attacher à la recherche d’un rayonnement de l’apostolat. La tâche est assurément ardue, puisque seules les âmes assoiffées de vérité pourront être sensibles à cette joie surnaturelle qui rayonne de l’âme enracinée en Dieu.
Mais il faut opposer à cette difficulté la réponse du Père abbé à ses jeunes frères, dans les Défricheurs de l’éternité de Michelet : « Nous n’avons pas le droit au découragement ; et si parfois Dieu nous y laisse succomber, c’est pour mieux nous aider à le combattre et à le vaincre. » Voilà bien un programme tout bénédictin : semer, dans les larmes peut-être, là où nous place la Providence, et abandonner à d’autres la joie de récolter.
A lire également : Saint Benoît nous parle