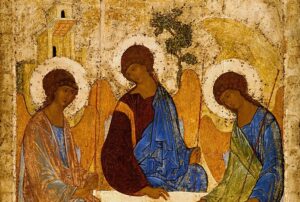Du tronc bénédictin, surgi au début du VIe siècle, est née à la fin du XIe siècle la solide branche des cisterciens. Du tronc franciscain, surgi au début du XIIIe siècle, est née au XVIe siècle la solide branche des capucins. Dans les deux cas, il s’agit d’une volonté de retour aux sources et d’une observance plus littérale de la règle d’origine. Alors que l’Ordre capucin va célébrer en 2025 le 500e anniversaire de sa naissance, un volume collectif retrace son histoire, particulièrement en France. Ce volume est dirigé par le père Jean-Marcel Rossini, gardien du petit couvent capucin de Lourdes et l’un des chapelains du sanctuaire. L’ouvrage est structuré en trois parties très claires : une brève histoire des capucins, suivie d’une chronologie de l’Ordre en France ; les portraits de quatorze capucins français, du XVIe au XXe siècle, avec un extrait de leurs écrits ; une dernière partie est consacrée à l’oraison, à travers principalement les écrits du père Martin de Cochem (1634-1712), sur « la prière du cœur » et du père Martial d’Étampes (1575-1635) sur « l’exercice du silence ». Les capucins sont un ordre qui allie vie contemplative et vie active, c’est-à-dire la prière, la pauvreté, la pénitence et la mission. Ce livre collectif, préfacé par le cardinal Bustillo, qui lui est franciscain conventuel et évêque d’Ajaccio, veut œuvrer à une meilleure connaissance de l’histoire des capucins. C’est aussi un plaidoyer pour un retour à la tradition capucine. Dans une contribution intitulée « Points lumineux de la spiritualité capucine », le père Costanzio Cargnoni, qui est italien et historien de son ordre, exprime clairement cette aspiration : « il nous est nécessaire de revenir à notre tradition ». Il expose ce « retour » nécessaire en six points et conclut par une sorte de mea culpa : « Aujourd’hui, notre proximité accentuée avec l’esprit du monde (médias et consommation) ne serait-elle pas la cause qui nous éloigne de notre tradition, et ne nous rend plus joyeusement en lien avec elle, évangéliquement significatifs et aussi populaires et attrayants, avec pour conséquence une diminution du nombre des vocations et d’autres désagréments importants ? » Aujourd’hui, les capucins sont 72 en France, répartis en huit maisons. La crise qu’a traversée l’Ordre capucin dans l’après-Concile n’est pas évoquée, comme ne sont pas citées les communautés d’observance traditionnelle qui sont alors apparues en Italie, au…
Sessions « Cultur’Elle » : Mettre au monde le vrai, le beau, le bien
Initiatives chrétiennes | À 45 km de l’abbaye de Lagrasse, dans un ancien monastère de clarisses, vit une communauté de religieuses, les Chanoinesses régulières de la Mère de Dieu. Depuis 2023, elles proposent les sessions « Cultur’Elle ». Cette formation se découpe en trois week-ends et s’adresse aux femmes à partir de 23 ans pour leur faire réaliser leur rôle unique de transmission de la culture, au service de la société. Entretien.