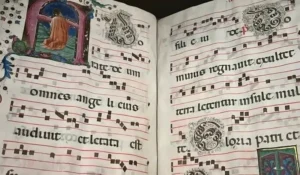La crémation est entrée dans les mœurs depuis des décennies et sera bientôt suivie de nouvelles pratiques funéraires. On oublie trop facilement que l’Église répugne à l’incinération des corps et défend toujours la mise en terre pour des raisons de foi et de respect des morts. Explications par Mgr Kruijen, ancien collaborateur de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Le mois de novembre, dédié de manière plus particulière à la prière pour les fidèles défunts dans la tradition catholique, offre une bonne opportunité pour se pencher sur le sort que nous réservons aux dépouilles de nos morts. Il s’agit là d’une thématique nullement anodine, dans la mesure où l’approche de la mort dépend notamment de la manière dont on conçoit la vie.
Bref aperçu de différentes pratiques funéraires
Sur le plan historique, on peut recenser une ample palette de pratiques funéraires, variables en fonction des lieux, des cultures et des époques. Schématiquement, et sans prétendre à l’exhaustivité, il est possible de classifier lesdites pratiques en trois ensembles, selon la finalité recherchée : a/ pratiques visant à conserver le plus possible le cadavre : embaumement (thanatopraxie), momification, cryogénisation ou cryonie ; b/ pratiques visant au contraire à précipiter la disparition du cadavre : incinération (ou crémation), hydrolyse alcaline par bain chimique (aquamation) ; c/ pratiques non volontaristes abandonnant le cadavre à un processus naturel de décomposition : inhumation terrestre ou marine, humusation. Il a existé ou il existe encore d’autres pratiques que l’on pourrait qualifier de mixtes, comme l’excarnation (récupération des os avant la putréfaction des chairs) et l’inhumation céleste (le cadavre est exposé à l’air libre en hauteur pour être dévoré par les vautours).
La pratique judéo-chrétienne traditionnelle
Dans le monde païen gréco-romain, au sein duquel s’est diffusée la religion chrétienne, on procédait aussi bien à l’incinération qu’à l’inhumation des morts. Il en était de même chez les Gaulois, les Celtes, les Germains et les peuples slaves. Au contraire, les peuples sémites rejetaient l’incinération qu’ils considéraient comme un outrage abominable ou un châtiment (1), même si elle n’était pas expressément interdite par la Loi. Jusqu’à aujourd’hui, le judaïsme, de même que l’islam, d’ailleurs, exige normalement l’inhumation des défunts. Héritières de la tradition juive, les communautés chrétiennes naissantes conservèrent la coutume d’ensevelir leurs morts. Il ne s’agissait pas là d’un simple donné conjoncturel, comme si l’on s’était seulement conformé aux us et coutumes du milieu culturel dominant. En effet,…