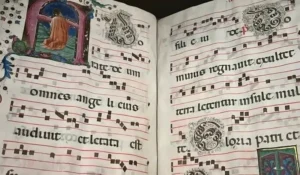Le 19 septembre dernier, le Dicastère pour la Doctrine de la Foi a publié une longue Note sur l’expérience spirituelle liée à Medjugorje. Cette Note a été présentée lors d’une conférence de presse par le préfet du Dicastère, le cardinal Fernández, qui a apporté d’intéressantes précisions.
Les apparitions présumées de la Vierge Marie à Medjugorje, en Yougoslavie (aujourd’hui en Bosnie-Herzégovine), ont commencé le 24 juin 1981. Six enfants et adolescents en ont été les bénéficiaires. Ces apparitions se sont poursuivies jusqu’à nos jours – trois des six voyants affirment voir encore la Gospa (« la Dame », en croate) tous les jours. La Note du Dicastère parle d’« une histoire longue et complexe », non seulement par la durée des supposées apparitions – quarante-trois années à ce jour – mais aussi par le fait que « se sont succédé des opinions divergentes d’évêques, de théologiens, de commissions et d’analystes ».
Les étapes
Rappelons les principales étapes. La commission diocésaine d’enquête instituée par Mgr Žanic, évêque du diocèse de Mostar-Duvno où se trouve la paroisse de Medjugorje, a rendu un premier jugement le 19 mai 1986 : ces supposées apparitions ne peuvent pas être considérées comme d’origine surnaturelle (non constat de supernaturalitate). Puis la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a chargé la Conférence épiscopale yougoslave d’examiner à nouveau le dossier. Celle-ci s’est prononcée le 10 avril 1991 : « sur la base des investigations effectuées jusqu’ici, on ne peut affirmer qu’il s’agisse d’apparitions et de révélations surnaturelles ». C’était donc à nouveau un non constat de supernaturalitate. Mais la même Conférence épiscopale demandait qu’à Medjugorje « une saine dévotion à la Vierge Marie soit promue, en accord avec l’enseignement de l’Église ». Mgr Peric, qui fut évêque de Mostar-Duvno de 1992 à 2020, n’a pas institué une nouvelle commission d’enquête, mais il a suivi de près le développement du phénomène et a rencontré plusieurs des supposés voyants. Le 2 octobre 1997, il a fait une déclaration affirmant : « Ma conviction et ma position n’est pas seulement non constat de supernaturalitate mais constat de non supernaturalitate [il est établi que les faits ne sont pas surnaturels] ». Les controverses se poursuivant alors même que les pèlerins étaient de plus en plus nombreux, le 14 janvier 2008, Benoît XVI décidait de créer une commission internationale d’experts, présidée par le cardinal Ruini, pour évaluer à nouveau les présumés phénomènes surnaturels. Cette commission a rendu ses conclusions en janvier 2014. Le cardinal Fernández les…