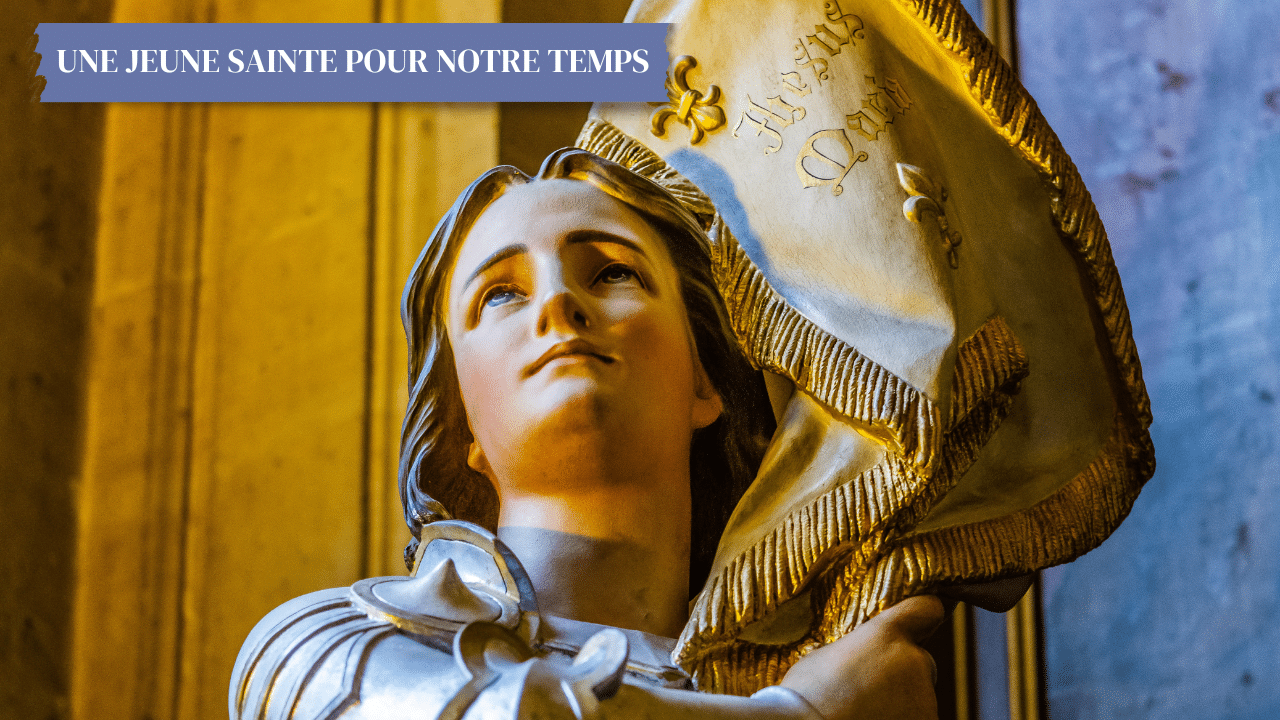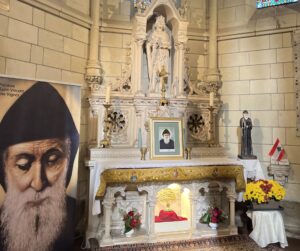Cet été : Jeanne d'Arc, une jeune sainte pour notre temps
Cet été, L’Homme Nouveau vous propose une sélection d’articles issus de son hors-série n° 54-55 consacré à sainte Jeanne d’Arc. Pour bénéficier de tous les articles de ce hors-série, commandez-le sur notre boutique en ligne. 👉🏻 Dossier thématique « Jeanne d’Arc »
Cet été : Jeanne d'Arc, une jeune sainte pour notre temps
Jeanne d’Arc vécut pendant une bien triste époque pour le Royaume de France. Famine, guerre, mercenaires n’en finissaient pas d’alourdir le sort des populations. La vocation de la Pucelle répond à un besoin pressant. Retour sur le contexte de son épopée.
Entre 1425 et 1428, une jeune paysanne des Marches de Lorraine entend quotidiennement les voix de saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite lui confier une mission : sauver le royaume de France et bouter les Anglais hors de France. Mais comment comprendre cet appel et cette épopée qui marque encore aujourd’hui les imaginaires nationaux français et anglais ? Il faut remonter à 1337 et au début de ce que les historiens du XIXe siècle ont baptisé la guerre de Cent Ans pour comprendre. Ce conflit entre les rois de France et d’Angleterre s’enracine dans la crise démographique, économique, sociale et religieuse que traverse l’Europe à la fin du XIVe siècle. Les populations sont en effet touchées par une crise économique structurelle : les ressources agricoles, du fait du morcellement des terres et des difficultés climatiques, se raréfient alors que la population tend à s’accroître et que les besoins des États en construction imposent des levées de taxes de plus en plus importantes. Les tensions entre la population rurale et les seigneurs se font de plus en plus vives, et ces derniers ont de plus en plus tendance à considérer la guerre comme un moyen de renflouer les caisses, grâce aux pillages et aux rançons. Dans ce contexte morose, les villes constituent des îlots de richesses et de relative liberté qui attirent toutes les convoitises, tout en constituant l’armature d’une organisation économique fondée sur des échanges au long cours : la maîtrise de certaines régions, par exemple viticoles comme le Bordelais, devient un enjeu central entre les puissances de l’époque, singulièrement les rois d’Angleterre et de France. La crise religieuse est elle aussi profonde : les intrigues se multiplient à Rome, la papauté doit se replier sur Avignon et entre 1378 et 1417 le Grand Schisme déchire la chrétienté,…