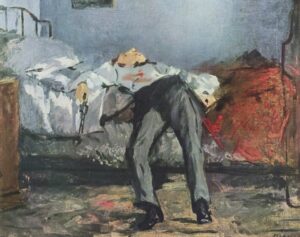Née de l’action terroriste du Front libération nationale (FLN), l’Algérie indépendante suit avec attention les actions terroristes en France et les moyens mis en œuvre pour lutter contre. Elle s’offre même le luxe de donner quelques leçons comme le rapporte Le Point (4 novembre) :
Alger est très attentif à ce qui se passe en ce moment en France. « Nous sommes liés. La proximité humaine et géographique, les liens multiformes font que chaque secousse d’un côté fait trembler l’autre », relate un officier du renseignement, assurant qu’une sorte de « téléphone rouge » relie très régulièrement les deux communautés de renseignement. Côté algérien, personne ne veut commenter publiquement les récents événements, mais, chez les « opés », on regrette la « persistance de ce problème si français ». « Leurs décideurs écoutent peu les sécuritaires parce que la stratégie de ces derniers, protéiforme, inscrite dans la durée et nourrie d’une excellente expertise, ne correspond pas à l’offre politique qui doit être rapide et expéditive », note un ex-cadre militaire, qui a assisté à des échanges entre les services français (« d’une qualité d’écoute et d’analyse impressionnante ») et algériens. L’autre souci est qu’en France « le discours politique ou médiatique assimile vite l’assaillant à une communauté au lieu de l’en isoler, le principe d’une traque est d’isoler la proie loin des bois, et non pas de la repousser vers ses tanières », fait remarquer un ancien officier de la lutte antiterroriste. De plus, comme l’expliquait au Point le théologien Kamel Chekkat, qui a participé en France à des travaux sur la déradicalisation : « Leurs hommes politiques idéologisent tout ce qu’ils font… Toute action est placée sous le signe de la laïcité qui, selon moi, n’est plus la laïcité de 1905 mais un déni du religieux, une sorte d’athéisme. » « L’hystérie politicienne apporte de la confusion là où un policier ou un militaire a besoin de cohésion, ajoute M., l’ex-analyste des services. Quand j’entends en France des responsables de la sécurité ou des syndicats de la police faire des déclarations sur les religions ou sur Erdogan, je ne comprends pas. Il ne faut jamais hypothéquer le temps long de la lutte antiterroriste par la conjoncture politique. Nous en savons quelque chose. » « Avons-nous déclaré la guerre au Soudan, à l’Iran ou à l’Arabie saoudite qui, indirectement, avaient soutenu nos barbus ? Non. Nous avons rompu nos relations avec Téhéran (1993-2000) et envoyé des avertissements aux autres : “Voilà ce que vous avez fait, voilà le résultat chez nous ; si vous continuez, assumez.” Et ils ont compris le message sans pour autant “monter” l’opinion publique ou les relais officiels les uns contre les autres », nuance un ancien diplomate algérien. Ce dernier ne comprend d’ailleurs pas la montée de l’hostilité envers la Turquie qu’il ressent en France : « D’abord, la Turquie n’est pas Erdogan. Quand Khatami est arrivé au pouvoir [1997-2005], Téhéran a été plus audible à nos argumentaires et a cessé de nous embêter (…). Ensuite, focaliser sur un “ennemi de l’extérieur” brouille les priorités internes. »