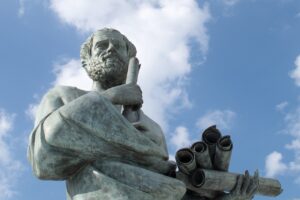Ce 1er janvier, nombre de communes nouvelles sont nées par regroupements et fusions. L’historien Reynald Secher dénonce un véritable mémoricide et a lancé une procédure judiciaire à l’encontre de son maire et de l’État.
Vous avez lancé une procédure judiciaire à l’encontre de votre maire et de l’État. Pourquoi ?
La Chapelle Basse-Mer, mon village natal, a fusionné avec la commune de Barbechat. Arbitrairement, les deux maires ont appelé cette nouvelle entité « Divatte-sur-Loire ». En clair, on définit le nouveau territoire par des éléments liquides périphériques, ce qui est totalement insensé. Pire : ce nom est totalement mortifère. La Divatte est une petite rivière asséchée six mois sur douze. Quant à la Loire, « la baignoire nationale » comme l’appelait Carrier, elle a servi durant la Révolution pour noyer les habitants, et de base à une flotille en charge de leur extermination. Ce nom est donc particulièrement atroce puisqu’il fait référence à l’arme du bourreau. C’est comme si on donnait à un fils le prénom de l’assassin de son père. Vous imaginez le tollé. J’ai entendu des habitants hurler de douleur. Ce nouveau nom est donc inacceptable d’où ma démarche, menée d’ailleurs avec une dizaine d’habitants.
Pour vous, il s’agit d’un mémoricide, comparable à celui que vous avez dénoncé pour la Vendée ?
Absolument. C’est un mémoricide total car non seulement on nie la victime, mais on la remplace par le bourreau. Ceux qui ont fait cela nient, relativisent, justifient totalement l’acte premier de l’extermination et de l’anéantissement des habitants en 1793 et 1794.
Qu’attendez-vous de ce procès ?
Au niveau national une prise de conscience de ce qui est en train de se produire. Jusqu’à une période récente, les changements de nom étaient du ressort exclusif de l’État, pour des raisons évidentes, la dénomination des communes, villes et villages de France appartenant au patrimoine commun de la nation, comme au patrimoine culturel immatériel de l’humanité.
Au niveau local, que l’on redonne le nom de La Chapelle Basse-Mer aux deux communes qui ont fusionné, d’autant que ces deux entités n’en formaient qu’une sous ce vocable depuis leur création, vers l’an mil, Barbechat ne s’étant séparé qu’en 1868.
Vous n’êtes pas contre les fusions. Que dénoncez-vous donc ?
Ce n’est pas la fusion que j’attaque, mais les nouveaux noms donnés dans ce cadre. Je vous donne quelques exemples stupéfiants. En Vendée, Saint-Michel-Mont-Mercure, La Flocellière, Les Châtelliers-Châteaumur, La Pommeraie-sur-Sèvre deviennent Sèvremont. En Anjou, Bouzillé, Champtoceaux, Drain, Landemont, Liré, Saint-Christophe-la-Couperie, Saint-Laurent-des-Autels, Saint-Sauveur-de-Landemont deviennent Orée d’Anjou. En Ille-et-Vilaine, La Chapelle-Caro, Le Roc Saint-André et Quily deviennent Val d’Oust. En raison du caractère systématique et général de cette politique, on est en train de faire un véritable remembrement toponymique très lourd de conséquences.
On perd en effet d’un seul coup les repères géographiques, historiques, culturels, anthropologiques. On met en place une désorganisation générale qui, au-delà du coût financier, va avoir un coût humain considérable. À moyen et long termes, les racines et identités locales vont être fracassées partout et en même temps. C’est catastrophique. Ceux qui ont conçu cette réforme ont fait n’importe quoi, sans aucune précaution, ou, peut-être, ce qui serait gravissime, l’ont fait en conscience, faisant leur le principe attalien de création de l’homme nouveau, déraciné. En rompant avec le passé, on projette dans le futur l’homme sans cordon ombilical. Je tiens d’ailleurs à faire remarquer que quasi systématiquement les références chrétiennes sont supprimées.
Quelle serait pour vous la solution toponymique ?
Elle est très simple. Il suffit de prendre le nom d’une des communes comme on l’a fait au XIXe siècle pour les cantons, les autres entités conservant leur nom comme communes déléguées. Regardez le cas de Paris qui a absorbé toutes les communes périphériques, devenues des quartiers (Montmartre, Belleville, etc.). Chacune a conservé son nom et son identité. Autre solution : unir les noms comme l’ont fait les communes de Mouilleron-en-Pareds et de Saint-Germain l’Aiguiller. Ce qui a donné Mouilleron-Saint Germain.
Propos recueillis par Olivier Figueras