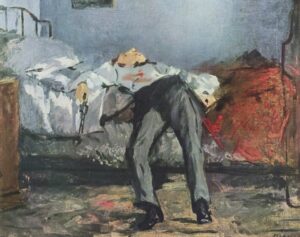Éditorialiste à L’Homme Nouveau et Professeur en Histoire du droit, Joël Hautebert a écouté ce samedi 14 novembre, au matin, le discours du Président de la République, François Hollande. Il en propose ici une première analyse.
La déclaration de François Hollande prononcée ce matin à l’Elysée démontre une évolution sensible du discours présidentiel. Nous retenons trois points, les deux premiers ayant été abondement repris et commentés, à l’inverse du dernier.
Reconnaisance de la guerre en cours
Tout d’abord, François Hollande parle ouvertement d’actes de guerre, menée contre nous par une « armée ». Les conséquences juridiques et politiques du constat tardif de cette situation de guerre, devront être tirées au cours des prochaines semaines.
Un ennemi désigné
Ensuite, puisque nous sommes en guerre, il convient de désigner clairement l’ennemi, dont l’identité se diluait jusqu’à présent dans le moule bien commode du terrorisme. Le progrès est cette fois-ci notable, puisque François Hollande dénonce explicitement « une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste (…) avec des complicités intérieures ». La nouveauté réside ici dans la modification du statut du terrorisme qui tend à redevenir moyen d’action, au service d’une puissance politique (Daesh) et d’une cause (Djihad). Certes, le Président préfère évoquer Daesh plutôt que l’Etat Islamique, et parler du Djihad plutôt que de l’islamisme, mais l’on ne peut envisager de djihad sans le référent islamique.
La France avant la République
Enfin, le discours présidentiel a évolué au sujet de ce que nous sommes, c’est-à-dire de ce qui doit nous unir (« j’en appelle à l’unité, au rassemblement »). Nous sommes hélas habitués à l’effacement de la France derrière la République. Cette fois-ci, il n’en est rien. La République n’est mentionnée qu’à la fin du discours, dans la formule habituelle « vive la République, vive la France ». Dans le corps du discours, il est surtout question de la France, mais aussi du pays, un peu de la nation (aux sens variables) et même de la patrie, ce dernier terme pourtant si fort, étant généralement absent. Toutes les allusions aux valeurs portées par la France restent volontairement vagues. Ainsi, dit-il, cet acte a été perpétré contre « les valeurs que nous défendons et ce que nous sommes : un pays libre ». Les allusions aux valeurs d’humanité, supérieures à la patrie, restent également vagues. Tout le monde peut s’y retrouver, l’ensemble des « familles spirituelles », comme on dit aujourd’hui. On est loin, pour l’instant, de la suprématie affichée des « valeurs de la République », absentes du discours. C’est suffisamment rare pour mériter d’être souligné. Il en va de même pour le triptyque « liberté, égalité, fraternité », cité par Barak Obama mais pas par François Hollande.
Une déclaration habile
De ce point de vue, cette déclaration, très habile, nous instruit beaucoup sur les véritables ressorts d’une authentique défense. Quand l’extrême gravité de la situation exige un vrai sursaut unitaire, c’est vers la France que nous sommes invités à rechercher notre « commun »et non vers la République (dans son acception idéologique) qui, pour l’occasion, reste en retrait.
Certes, ce n’est qu’un discours, peut-être sans lendemain. Mais qu’il soit l’œuvre d’un rédacteur particulièrement adroit, ou qu’il s’agisse d’un réflexe spontané après une longue nuit d’épreuves pour le pays, ce discours nous dit quelque chose sur le seul fondement communautaire politique susceptible de galvaniser les énergies dans notre pays.