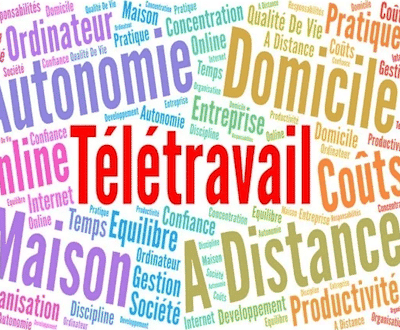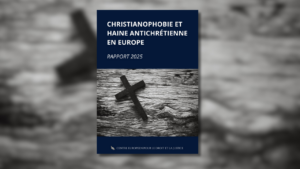La lutte contre la Covid-19 a entraîné le déploiement du télétravail, impliquant d’associer travail à domicile et moyens informatiques. Un article de Marianne (7 février 2021) s’attache à montrer que le travail à domicile a toujours existé, depuis la nuit des temps.
La pandémie actuelle a engendré un passage massif au travail à domicile. Dans les premiers temps, cette forme de besogne à la maison a suscité un certain enthousiasme. Les patrons y voyaient un moyen commode de faire des économies d’espaces et d’alléger les loyers. Des syndicats trouvaient une forme d’autonomie salariale. Aujourd’hui, dix mois après le confinement de mars, les critiques dominent plutôt. Moins de communication, moins d’humanité, sur fond de confusion entre sphère privée et lieu de travail. (…)
Et durant plus de dix mille ans, depuis le Néolithique et son long processus de sédentarisation, l’immense majorité des humains travaille à domicile son lopin de terre, élève quelques animaux et y fabrique aussi quelques rudimentaires outils agricoles, vêtements, ustensiles de cuisine et paillasses.
Beaucoup plus près de nous, les villes médiévales étaient majoritairement peuplées d’artisans travaillant à domicile. L’atelier était le plus souvent dans l’habitation elle-même. Les témoignages des puissants de l’époque fourmillent de plaintes sur le bruit, les odeurs et les diverses nuisances de toutes ces activités à domicile et, souvent, dans les rues. Dans les règlements qui régissent les corporations, on découvre souvent que le maître artisan doit être marié et que les apprentis partagent la vie familiale du patron.
Une lente évolution, amorcée dès le Moyen Âge, s’accentuant au XVIe siècle et s’imposant au début du XVIIIe, favorisera le développement d’une production à domicile qui, traditionnellement destinée à la consommation locale, s’orientera vers une production destinée à être vendue sur des marchés, même très lointains. Bien avant l’arrivée du coton et de la soie et sans amélioration technique notable, devant l’explosion de la demande en Europe et dans le Nouveau Monde, il semble bien que, dès le XVIe siècle, les marchands-fabricants de la ville aient vu tous les avantages d’un essaimage des tâches les plus rudimentaires, ou parfois les plus fines, dans un monde rural réputé peu coûteux, plus docile et plus flexible. (…)
Pour la plupart des historiens, cette proto-industrie est « fille de la misère », dans les régions aux sols pauvres mais aussi dans les régions plus riches, où la concentration foncière et la privatisation des « communs » vont effondrer les revenus de beaucoup de paysans. « L’appauvrissement demeure la cause principale du recours à une activité d’appoint » résume Jean-Marc Olivier. Mais à la suite de Jan de Vries, historien américain, cette vision a été contestée. À partir de son travail sur les Flandres, il affirme que si les revenus individuels ont bien baissé, les revenus des ménages ont augmenté grâce à une activité marchande élargie à toute la famille. Le moteur de cette transformation étant, selon lui, le nouveau désir de consommation et non la paupérisation. Le débat reste ouvert, et il semble bien que les deux réalités aient pu coexister suivant les régions.