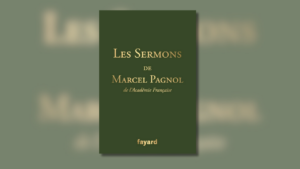Dans la tradition chrétienne, tout au long de son histoire, le cimetière n’est pas le lieu du dernier adieu aux morts, mais le lieu d’attente de la vie éternelle. Dans l’Antiquité paléochrétienne, on y recherche la proximité des martyrs et l’espace en est sacré. En France, à partir du XIXe siècle, les cimetières se sécularisent et tombent sous l’autorité civile. Pour désigner le lieu où sont enterrés les morts, le christianisme a utilisé le mot « cimetière » (koimetérion en grec, coemeterium en latin), littéralement « le lieu du repos ». L’idée se retrouve dans les autres mots employés dans l’Antiquité chrétienne : dormitorium (l’endroit où l’on dort), accubitorium (l’endroit où l’on s’allonge). Ces divers noms indiquent que dans la foi chrétienne la mort n’est pas la fin de la vie mais un passage vers la vie éternelle, dans l’attente de la résurrection des morts. Saint Jean Chrysostome, au IVe siècle, disait des cimetières : « ceux qui y reposent ne sont pas morts, mais endormis ». Les catacombes Dès l’origine, les chrétiens, comme les juifs, ont enseveli les morts et ne les ont pas incinérés. Dès l’origine aussi, les agonisants et les morts ont été entourés de la prière de l’Église. Sans évoquer l’histoire de la liturgie des défunts, on relèvera simplement que les litanies des saints font partie « des invocations récitées près de ceux qui vont mourir, et cela dès une époque très ancienne » (1). D’abord il n’y eut pas de cimetière chrétien proprement dit. Les chrétiens enterraient leurs morts aux côtés des païens, avec sur la tombe un symbole discret qui marquait leur appartenance à la religion chrétienne. En témoigne, sous la basilique du Vatican, la nécropole mise à jour au XXe siècle : « C’est dans cette nécropole que l’on déposa les restes de saint Pierre, puis ceux d’autres fidèles, au milieu ou à côté des mausolées de familles païennes. » (2). Saint Paul, lui aussi, a été enterré dans un cimetière païen sur la route de Rome à Ostie. Progressivement, les communautés chrétiennes se sont dotées de cimetières propres : les areae sepulturarum nostrarum, « les espaces pour nos sépultures » dont parle Tertullien. Comme les nécropoles antiques, pendant longtemps les cimetières chrétiens furent situés à l’écart des villes. Quand le terrain le permettait, à Rome et dans d’autres villes, les cimetières chrétiens pouvaient aussi être souterrains. Ce qu’on appellera plus tard les « catacombes », en référence à un des cimetières chrétiens de Rome, situé ad catacumbas,…
Saint-Pierre de Rome : Le chef-d’œuvre collectif de la chrétienté universelle
Hors-série n° 60-61 | La consécration de la nouvelle basilique Saint-Pierre de Rome eut lieu exactement 1300 ans après celle de Saint-Pierre du Vatican. Pendant près de deux siècles, l'action continue de plus de 20 papes, le concours d'artistes de génie tels que Bramante, Raphaël, Michel-Ange, Maderno ou le Bernin, permirent à un chef d'œuvre d'harmonie de voir peu à peu le jour : l'église-mère de toute la chrétienté.