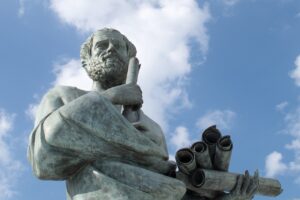Entendons-nous aujourd’hui les responsables socialistes évoquer les classes populaires ? Pourtant, il arrive encore que de nos jours, on rencontre des Français qui soutiennent mordicus que la gauche est du côté du peuple, des prolétaires, tandis que la droite serait du côté des riches exploiteurs de la misère humaine. Sans doute faut-il supposer que dans une ancienne vie, ces gens participèrent ardemment à la lutte des classes et qu’ils restent attachés aux vieilles rengaines militantes de leur jeunesse, voire de leurs parents. De manière plus générale, il nous semble que ce genre d’allégation démontre surtout un aveuglement coupable, inhibant toute capacité à accepter que le socialisme se soucie de tout autre chose, et qu’il s’appuie sur les puissances financières dans les causes qu’il défend prioritairement aujourd’hui.
Des prolétaires de substitution
À dire vrai, les prémices de cette mutation du socialisme ne datent pas d’hier, puisque dès les années 1960-1970, quelques intellectuels de gauche, comme Herbert Marcuse, ont pris leur distance à l’égard des schémas du marxisme, constatant que les trente glorieuses avaient embourgeoisé un prolétariat détourné de sa mission révolutionnaire. Il fallait donc trouver des prolétaires de substitution. Ce contexte post-Mai 68, marqué par l’immigration et la révolution sexuelle, a motivé un réajustement du corpus théorique au sein d’une gauche où les minorités ont progressivement pris la place des prolétaires. Naquirent alors l’idéologie antiraciste, le combat pour tous les « sans » (sans-papiers, etc.), l’anti-sexisme, les mouvements homosexualistes, et ultérieurement l’engagement en faveur du Genre.
Dans son dernier livre, Philippe de Villiers voit dans Mai 68 la naissance du boboïsme, « c’est-à-dire d’une nouvelle idéologie en fusion : celle des bourgeois – les libéraux – et celle des bohèmes – les libertaires. (…) Petit à petit, la grande fracture s’installe : les deux France vont s’éloigner l’une de l’autre : la France citadine des bobos qui cherche sa prospérité dans le libre-échangisme, et la France périphérique qui cherche à s’en protéger » (1). Il est vrai que la géographie sociale a profondément évolué. La France périphérique, c’est la France pavillonnaire, celle des Français de souche qui ont quitté les villes boboïsées et occupées par des populations issues de l’immigration. Les couches populaires françaises se sont déplacées vers les espaces péri-urbains et ruraux. Le géographe Christophe Guilluy explique avec pertinence comment aujourd’hui les politiques de la ville résultent d’un « compromis sociétal sur une base ethnoculturelle » (2), et en aucun cas d’une politique sociale. Le socialisme au pouvoir se moque du sort des couches populaires françaises, aimablement qualifiées de « beaufs » qui, en retour, se détournent massivement de lui dans les urnes. Ceux qui précédemment se gargarisaient du mot « travailleur » accusent désormais de populisme ceux qui se soucient des déclassés de notre époque, c’est-à-dire les Français défavorisés qui n’entrent pas dans la catégorie des minorités bénéficiaires de la politique de reconnaissance.
Modernisme culturel
Même si l’on peut discuter de la profondeur de la mutation idéologique du socialisme, nous observons qu’elle suscite des réactions parmi les intellectuels de gauche, attachés à un socialisme « traditionnel », si l’on peut dire. Jean-Pierre Le Goff remarque qu’« aujourd’hui, la référence à la mission historique du prolétariat apparaît comme un mythe d’un autre âge, la dynamique passée du mouvement ouvrier est morte et la composition sociologique de ce qu’on a appelé plus tard “le peuple de gauche” a pour le moins changé » (3). Le projet de déstructuration généralisée de tout lien social et le déracinement causé par la mobilité et le modernisme culturel satisfont également les promoteurs du libre-échangisme. Par exemple, la dénaturalisation de l’identité sexuelle est analysée par des intellectuels socialistes réalistes comme un facteur d’universalisation au service des intérêts marchands. Cette politique dite « sociétale » ne se distingue guère du libéralisme. Pour Jean-Claude Michéa, la droite, gênée par la frange conservatrice de son électorat, a sous-traité à la gauche « le soin de développer politiquement et idéologiquement l’indispensable volet culturel de ce libéralisme (l’éloge d’un monde perpétuellement mobile, sans la moindre limite morale, ni la moindre frontière) » (4).
Quelques réfractaires
Tous les socialistes n’acceptent pas cela, ou du moins n’acceptent pas tout. Ainsi, le 2 février prochain, des Assises pour l’abolition universelle de la maternité de substitution (GPA) auront lieu à l’Assemblée nationale, en présence de Marie-George Buffet, Yvette Roudy, Sylviane Agacinski (femme de Lionel Jospin), José Bové et quelques autres figures de la gauche française.
On le voit, les lignes habituelles de fracture politique sont perturbées. On ne peut que se féliciter du courage des uns ou des autres qui n’hésitent pas à aller à rebours des choix politiques officiels. Toutefois, un point de vue commun dans un combat précis ne crée pas une empathie doctrinale, embrassant tous les aspects de la vie sociale, de la politique et de l’anthropologie. L’accord sur les effets négatifs d’une politique ne fait pas disparaître le désaccord sur l’ensemble des causes. Mais ne nous gênons pas pour reprendre ce qu’il y a de juste et de vrai dans les critiques mentionnées, parfois remarquablement formulées. Mais il est temps de proposer autre chose que le socialisme et le libéralisme. La naissance en France d’une force dite conservatrice doit s’accompagner d’une rigueur doctrinale que nous ne trouverons pas chez les autres.
1. Le moment est venu de dire ce que j’ai vu, p. 88, Albin Michel, 352 p., 21,50 €.
2. Christophe Guilluy, Fractures françaises, p. 103, Flammarion, « coll. Champs essais », 186 p., 8 €.
3. Jean-Pierre Le Goff, La Gauche à l’épreuve. 1968-2011, p. 27, Perrin, « coll. Tempus », 288 p., 8,50 €.
4. Jean-Claude Michéa, Les Mystères de la gauche, p. 47, Flammarion, coll. « Champs essais », 132 p., 6 €.