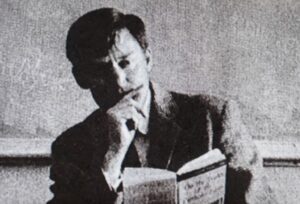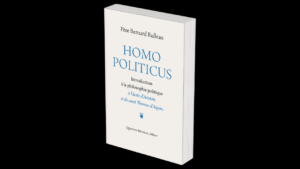Leur distinction et leur opposition sont constitutives de notre humanité et « le premier fruit d’une conscience droite est d’appeler par leur nom le bien et le mal » (Jean-Paul II, Dominum et vivificantem). Que dire quand des universitaires titulaires de chaires d’éthique prétendent que donner la vie est toujours en toutes circonstances un mal, et le refus de la donner, y compris l’avortement, toujours un bien ? Nous sommes ici bien au-delà de ceux qui préconisent un avortement en cas de diagnostic prénatal annonçant de graves malformations du bébé à naître.
Les principes de cette idéologie qui se répand sont : il n’y a pas de symétrie entre le plaisir, bien limité (surtout physique, et considéré comme le plus souvent une illusion) et la souffrance, mal absolu. Faire souffrir est donc toujours une action mauvaise. Comme on ne peut jamais être sûr que l’enfant qu’on pourrait mettre au monde n’aura qu’une vie de plaisir sans jamais aucune souffrance, on agit donc mal en lui donnant la vie, le condamnant volontairement à souffrir. Et ne pas donner la vie est seul bon.
On retrouve ici les mêmes vieilles lunes du XIXe siècle du pessimisme anti-vie de Schopenhauer, von Hartmann ou Mainländer (qui lui au moins se suicida, voulant montrer l’exemple), avec l’aura de l’étiquette universitaire. Cette idéologie rejoint celle du Mouvement écologique pour l’extinction volontaire de l’humanité (d’ailleurs dépassé par ceux qui prônent celle de toute vie sur terre pour corriger le hasard malheureux qui a fait apparaître celle-ci.
Signe du nihilisme ambiant : la plupart des universitaires qui critiquent ces idées le font avec des pincettes, semblant s’en excuser, et je n’en ai encore trouvé aucun criant : « Au fou ! » Cela en favorise la propagation – étudiants, livres, journaux, médias. Pour les uns, « l’antinatalisme est un humanisme » (« antinataliste » signifiait « hostile…