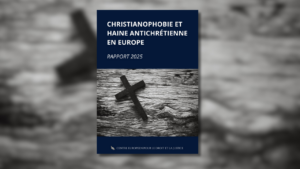> Dossier « Le christianisme face à l’esclavage »
Des premières communautés chrétiennes aux débats contemporains, l’histoire montre la lente maturation d’une conscience morale sur la dignité humaine. Le salut proposé par l’Évangile n’a pas immédiatement aboli les chaînes sociales, mais il a semé les graines d’une libération plus profonde.
Le sujet est complexe : presque deux mille ans d’histoire pour l’Église, avec une très grande variété des situations dans le temps et l’espace, et beaucoup plus pour l’esclavage comme réalité. Celui-ci est une évidence sociale et juridique, quasi universelle et durable, sur tous les continents, pendant très longtemps sans contestation véritable. L’Ancien Testament le connaît, tout comme les mondes grec et romain. Pourtant la production scientifique sur ce sujet est assez limitée.
Des sorts divers
Esclavage : de quoi parle-t-on ? On peut définir l’esclave comme la propriété légale d’un homme par un autre, si bien que l’esclave est considéré comme un outil animé (qui parle). Son maître a tout pouvoir sur lui. Les raisons de devenir esclave sont nombreuses : par naissance de parents esclaves, vaincus à la guerre, endettés qui subissent une contrainte par corps, achetés sur un marché. Le sort des esclaves est très divers : esclaves domestiques ou travailleurs dans des entreprises (agriculture, artisanat, mines, etc.). L’Onu en 2021 compte 50 millions de personnes victimes de l’esclavage moderne (28 pour le travail forcé, y compris sexuel, et 22 millions de mariages forcés). La Mauritanie l’a aboli plusieurs fois, en 1981, 2007 et 2015. Attention à l’anachronisme. La question de l’esclavage est récente : époque moderne et surtout XVIIIe. C’est une obsession de la fin du XXe siècle dans le monde occidental, dont la sensibilité juge facilement le passé à la mesure de notre présent : ainsi Périclès et la démocratie athénienne ont fini par être exclus, effacés de la Constitution européenne en 2004, au motif qu’il y avait des esclaves à Athènes et que les femmes ne votaient pas. D’où une double tentation face à ce « crime contre l’humanité » : soit une légende dorée chrétienne, à visée apologétique. L’Église et les chrétiens seraient la cause principale, voire unique de la fin de l’esclavage, et cela de manière constante. Soit aussi et surtout une accusation contre les Européens, avec la confusion fréquente entre esclavage, traite, racisme et colonisation européenne. Confusion dans laquelle on embarque l’Église dans une légende noire. Elle aurait été la complice de l’esclavage, en trahissant le…