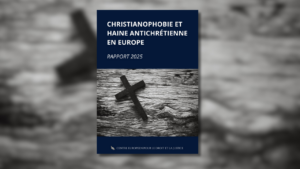On ne devrait pas paraître le dimanche. Surtout lors du long W.-E. du 1er mai, qui tombait cette année, un lundi. Pourtant, dans Le Monde, daté de dimanche dernier, disponible la veille à Paris, dans certaines grandes villes et sur Internet, Zeev Sternhell a, lui aussi, publié sa tribune à propos du Front national.
Pour les plus jeunes de nos lecteurs qui l’ignoreraient, Zeev Sternhell est un spécialiste du fascisme dont il a découvert voici quelques années les origines françaises. Sa thèse a été discutée et même battue en brèche. Et pas seulement par des adversaires politiques et intellectuels embêtés de se voir assimilés au mouvement de Mussolini d’origine clairement italienne et de gauche…
Le réel comme option facultative
Mais, qu’importe ! Zeev Sternhell revient pour dénoncer le Front national. C’est de bonne guerre. Mais, comme toujours chez cet intellectuel les a priori remplacent ce que d’aucuns appelleraient la prise en compte du réel. Il avait voulu à tout prix faire de Barrès et de Maurras des pré-fascistes. Aujourd’hui, il perçoit encore le Front national comme opposé aux Lumières et comme défenseur de la civilisation chrétienne.
Dans quel monde vit M. Sternhell, intellectuel reconnu, auteur publié et bonne conscience de la gauche ? On se demande s’il a seulement entendu parler de l’évolution du Front national, de la lutte interne entre les anciens et les modernes, du déclassement des catholiques au sein de ce parti et même de l’éviction de Jean-Marie Le Pen.
A-t-il seulement lu le discours d’investiture de Marine Le Pen lorsqu’elle est devenue Présidente du Front national, en remportant la victoire face à son adversaire, de l’ancienne garde, Bruno Gollnisch ?
On peut certes, pour des questions électorales et de basse politique, continuer d’assimiler le nouveau Front national à l’ancien. On peut nier l’évolution du discours, le changement de référence, les orientations nouvelles. Entre militants politiques, pourquoi pas ! Mais, quand on est un intellectuel sérieux, a-t-on raison de réduire le réel à une vague poussière que l’on repousse négligemment de la main ?
Pourtant, il y a un élément fondamental à prendre en compte chez Zeev Sternhell et dans sa prose publiée par Le Monde le dimanche 30 avril. Un élément juste, donc, qui mérite cependant d’être replacé dans un cadre plus adéquat.
La vraie césure
Là où Zeev Sternhell a raison, c’est que la césure, le combat s’il préfère, se passe toujours entre les pro et les anti-Lumières. Pas forcément ceux que Zeev Sternhell désigne sous ce dernier vocable et qui seraient les tenants « d’une autre modernité, fondée sur le culte de tout ce qui distingue et sépare les hommes », selon les propos de l’historien rapportés par Sven Ortoli, dans le hors-série justement consacré aux « Anti-Lumières » de Philosophie Magazine (un hors-série d’ailleurs plutôt décevant qui ignore, par exemple, les travaux de Xavier Martin sur les Lumières et la traduction dans le droit de leur conception mécaniste de l’homme) et que l’on trouve dans l’introduction de son livre, Les Anti-Lumières (Fayard). Dans l’entretien qu’il nous a accordé récemment, le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté remarque d’ailleurs à propos des classifications généralement opérées par Zeev Sternhell :
« L’œuvre de Zeev Sternhell a tendance à renvoyer dans le camp des anti-Lumières tous ceux qui ne s’enthousiasment pas pour la modernité comme il la voit. Si on ne saurait contester l’érudition de Sternhell, rien ne nous oblige en voir en lui un profond philosophe. Il simplifie la complexité historique de manière outrancière : d’un côté les partisans de l’émancipation, de l’autre ceux de la régression. En gros, les gentils et les méchants. Puis, il plaque ce schéma sur l’histoire française et plus largement, sur l’histoire européenne. Nul n’est obligé de se plier à cette déformation grossière de l’histoire, qui exige quand même un peu plus de finesse pour être comprise. Nul n’est obligé non plus d’en faire une grille d’analyse électorale. »
« L’homme n’est rien par nature »
Il n’en reste pas moins que le mouvement philosophique que l’on appelle abusivement les Lumières, constitue toujours la véritable ligne de démarcation. Il semble que nous sommes au stade ultime de son développement. L’autonomie absolue de l’individu et l’éloge d’une raison émancipée de tout ont conduit non seulement aux massacres du XXe siècle, mais à cette anthropologie affolée qui réduit l’homme à la marchandisation et à la fabrication en laboratoire de lui-même et de son avenir. C’est encore dans le hors-série de Philosophie Magazine, déjà cité, qu’Alain Finkielkraut remarque que pour les « Lumières » : « l’homme n’est rien par nature ». Nous sommes là au cœur du vrai drame qui se joue à propos, non seulement de ce mouvement philosophique, mais plus largement de la modernité, qui contenait en son berceau et en puissance ce mouvement d’émancipation.
La vraie ligne de démarcation se situe bien entre ceux qui acceptent l’existence d’une nature humaine, limite immédiate de l’autonomie de l’être humain, mais aussi meilleur point de départ de son perfectionnement, et ceux qui nient radicalement l’existence de cette même nature et sont ouverts, par principe, à toutes les aventures dont l’être humain sera aussi bien le sujet que l’objet.
Les indécis pencheront tantôt d’un côté tantôt de l’autre. Ils hésiteront, soit en voyant les progrès techniques accomplis, soit en s’inquiétant sur le sort fait à l’être humain et plus largement à la planète. Mais il semble qu’il n’y ait pas vraiment de compromis possible à propos des Lumières car derrière se profile une question anthropologique. Et l’homme n’est pas divisible.