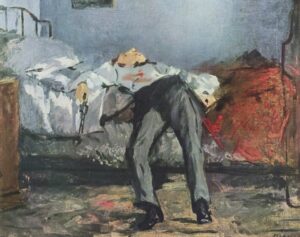> DOSSIER : « Les guerres carlistes : Pour Dieu, la Patrie, le Roi »
Trois guerres carlistes déchirèrent l’Espagne à partir de 1833 et jusqu’aux années 1870. Déclenchées par la succession disputée du roi Fernando VII, elles opposèrent des successeurs au trône d’obédience traditionaliste à des souverains libéraux et se prolongèrent par les luttes politiques de la Communion catholico-monarchique jusqu’à l’époque de Franco.
Les guerres carlistes, qui ont profondément bouleversé l’histoire de la monarchie espagnole pendant trente-cinq ans, en conditionnant lourdement sa configuration politique, ont commencé par un grave conflit de succession qui surgit lorsque le roi Fernando VII procéda à des modifications au moyen de ce qu’on appelle autoacordado, à la fin de son règne, en omettant les exigences légales essentielles, les règles de succession à la couronne espagnole, dans le but d’imposer l’accession au trône de sa fille Isabel, au détriment des droits légitimes de son frère, l’infant Carlos María Isidro [1]. Le ressort d’une décision aussi inquiétante fut les desseins de sa quatrième épouse, María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, mère de l’infante, qui avait le soutien d’une partie de la Cour et de l’idéologie libérale, déterminée à déposséder du trône le frère du roi parce qu’il était fidèle aux principes directeurs de la monarchie catholique espagnole et adversaire du ferment révolutionnaire que la Constitution de Cadix de 1812 avait introduit en Espagne. La séquence d’affrontements militaires – les trois guerres carlistes – déclenchée par la mort du roi, le 29 septembre 1833, avait donc une double dimension de facteurs imbriqués : un conflit de succession d’une part, et un conflit public d’ordre juridique et doctrinal d’autre part. Les carlistes défendirent – avec une détermination d’autant plus admirable si l’on considère que les armées qu’ils devaient affronter avaient le soutien exclusif de l’appareil d’État – les droits de leur roi légitime, envers qui ils avaient une exigence sacrée de fidélité, et les principes fondateurs de la monarchie catholique traditionnelle, d’une validité ancienne, qui sont résumés dans la quadruple devise carliste « Dios, Patria, fueros, Rey » [2]. Il y eut cinq rois porte-drapeaux de la légitimité proscrite : Carlos V, Carlos VI, Carlos VII, Jaime III et Alfonso Carlos Ier, avec la mort duquel, le 29 septembre 1936, s’éteignit la ligne directe de la dynastie légitime espagnole, ouvrant une succession juridiquement et politiquement compliquée qui revint à la personne de Javier de Borbón Parma. …