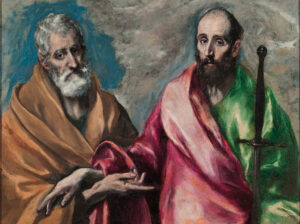Les 23 et 24 mars dernier, le manteau de Saint François était exposé dans l’église Sainte Elisabeth, à Versailles. L’occasion pour de nombreuses meutes de louveteaux de venir vénérer cette relique, Saint François étant leur saint patron. Le Frère Éric Bidot, participait à l’organisation de cette vénération. Il nous a aidé à comprendre l’histoire et le sens de cette relique.
Vénération du manteau de Saint François
« Il y a plusieurs épisodes dans les biographies de Saint François où il est narré qu’il donnait ses manteaux. Une personne pauvre vient lui demander l’aumône, François voit qu’elle a froid, et il lui donne son manteau. » Nous dit le frère Éric Bidot, en charge du manteau.
Ce manteau qui a été exposé les 23 et 24 mars est celui que Saint François donna lui-même à Sainte Elisabeth de Hongrie, cette femme noble connue pour le miracle des roses1. Miracle rappelé par cette grande peinture au fond de l’Église sainte Élisabeth, à Versailles.
Si François donnait ses manteaux aux pauvres, il peut paraître singulier qu’une princesse l’ait reçu. Ce cadeau a été fait à la demande du Cardinal Hugolin, il enleva des épaules de François ce manteau et demanda qu’Élisabeth le reçût en héritage : « car puisqu’elle est vraiment fille de votre esprit, de même qu’Élie laissa son Manteau à son disciple Élisée pour marquer qu’il héritait de son esprit, je veux aussi qu’elle ait le vôtre comme héritière de votre esprit. »
« Ce que je trouve beau dans la symbolique de ce manteau, c’est que François le donne à Élisabeth de Hongrie comme à la fois un gage et un encouragement. Un encouragement à vivre selon l’Évangile. Ce manteau à travers l’histoire jusqu’à nous, c’est la même symbolique. C’est pour ça que j’ai voulu le faire vénérer de nouveau. Je me rends compte qu’on a besoin de signes tangibles et d’encouragements à vivre l’Évangile, et en particulier par le chemin de la simplicité, le chemin de la pauvreté, comme François l’a vécu. » Ajoute le frère Éric.
Circulation du manteau
Le manteau voyage, principalement à la demande de paroisses, pour des missions. Le frère Éric nous fait part de son souhait que le manteau soit toujours accompagné d’un frère qui puisse l’expliquer. Afin que ce ne soit pas simplement un objet qu’on balade.
Il y a également une approche liée à sa conservation, les sorties sont des risques supplémentaires de détérioration. Ce manteau est une cape, qui arrivait à peu près à mi-cuisse, au fur et à mesure de ses déménagements il a été endommagé. Raison pour laquelle le manteau a été très récemment restauré, par la même personne qui a restauré la sainte tunique d’Argenteuil. Le résultat donne un très beau travail de reprise, notamment sur quelques trous qui s’étaient faits au fil du temps et avaient étés reprisés un peu rapidement. Mis à part les morceaux coupés au fil du temps pour faire des reliques, il est dans un état impeccable. Le restaurateur conseille sur la pertinence des voyages récurrents.
Les franciscains ont fait observer le tissu par des ateliers de tapisserie, ils ont confirmé un tissu médiéval de très bonne qualité. Ce qui n’est pas étonnant quand on connaît les origines de saint François.
Comment le manteau est-il arrivé à Paris
Renonçant à toute possession à la mort de son mari, Élisabeth de Hongrie ne garde que le manteau du Saint, jusqu’à sa mort. C’est Conrad son beau-frère qui récupère le manteau, il en fait don à l’ordre Teutonique dans lequel il est Grand Maître.
Le manteau arrivera en France par le biais de Saint Louis. Lors de grandes processions solennelles, le peuple de Paris se met à genoux au passage de la relique, pour obtenir la grâce de la paix. Enceintes, les reines de France se le font apporter pour que l’accouchement se déroule bien. Elles y puisent force et simplicité.
À la Révolution, le Manteau fut sauvé par un tertiaire franciscain, frère Aguin, qui craignait les destructions qui faisaient rage. En 1800 le manteau refait surface, reconnu par l’archevêque de Paris, celui-ci fait le vœu de le confier aux premiers franciscains qu’il verrait à Paris. C’est chose faite avec les Récollettes des Batignolles en 1816, celles-ci quittèrent Paris avec la relique.
Par l’intermédiaire du Père Bonaventure de Ville-sous-Terre, la relique revient aux capucins et à Paris, en 1866, ceux-ci la vénèrent en demandant l’esprit de pauvreté. Cachée lors des guerres, exilée plus de 20 ans, après la loi de 1905, la relique dormait dans le couvent de la rue Boissonade, sorti seulement pour la fête de Saint François.
Le reliquaire sorti de son obscurité
Alors qu’il ne sortait plus qu’une fois par an, Fleur Nabert, une artiste de renom, lui fit un nouveau reliquaire, il y a une dizaine d’années, et le manteau circule de nouveau pour la plus grande joie des fidèles.
Ce reliquaire a une portée pédagogique, facilement compréhensible pour des enfants. Le pied des deux montants qui tiennent le manteau est un olivier, symbolisant la paix. Il rappelle que « François a reçu sa mission au cours d’une liturgie de la fête de saint Mathias, il y entend l’évangile de l’envoi en mission avec le Christ qui dit : que le seigneur te donne la paix » et François se dit « mais c’est ça que je veux vivre » dès lors, chaque fois qu’il entrera quelque part, il dira : « que le seigneur vous donne la paix ». C’est aussi l’arbre de la croix qui est symbolisé, avec un lien le reliant à la couronne d’épines, rappelant les stigmates de Saint François. C’est un rappel de ce don des larmes qu’avait François nous dit le frère Eric : » il pleurait particulièrement devant les scènes de la passion, il aura d’ailleurs ce cri : « L’amour n’est pas aimé ». Le drame de Saint François c’est d’être conscient, témoin, de l’amour de Dieu et il voit que l’amour de Dieu n’est pas reçu. »
1. Sainte Elisabeth descendait seule dans la rue pour donner de la nourriture aux pauvres d’Eisenach. Son mari n’appréciait pas ces bonnes actions, un jour qu’il la surprend les bras chargés et cachés par son manteau, il lui intime de lui montrer ce qu’elle retient. Alors qu’elle ouvre les bras, en lieu et place des pains qu’elle retenait, ce sont des roses qui s’échappent de ses mains pour se déverser aux pieds de son mari.