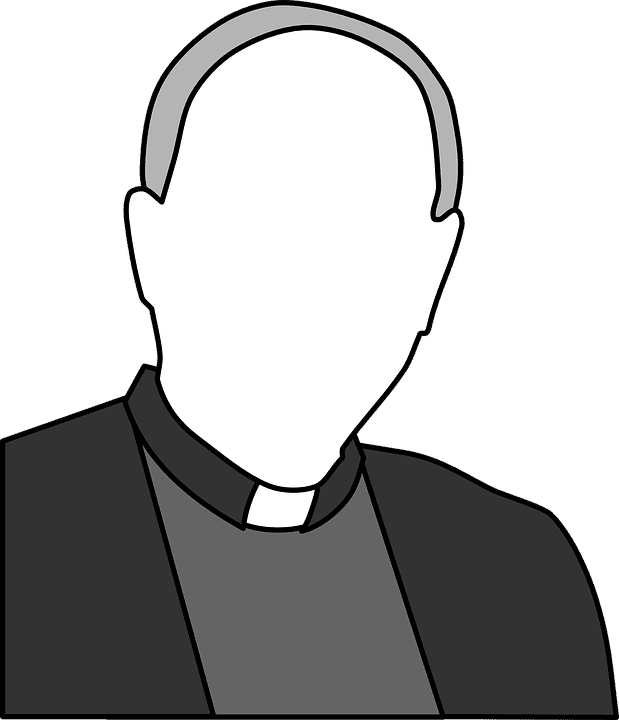« Le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! » Ce mot de Clemenceau reste dans la mémoire nationale. Il demeure comme un étendard pour les impies, un affreux blasphème pour les croyants honnêtes. Le président du Conseil concluait ainsi un discours prononcé à la Chambre des députés le 4 mai 1877. La France était encore sous le coup de la défaite de 1870 ; celle-ci avait suscité une piété nationale de repentir, à laquelle nous devons la basilique de Montmartre. Face à une Chambre encore largement teintée de cette ferveur repentante, Clemenceau usait de la formule par mode d’emprunt : « Je ne fais que traduire les sentiments intimes du peuple de France en disant ce qu’en disait un jour mon ami Peyrat : le cléricalisme ? Voilà l’ennemi ! » Peu avant, il accusait les catholiques du Sénat de faire obstruction à l’Assemblée nouvellement élue et largement socialiste : ces hommes, disait-il, « qui se déclaraient, dans leur conduite politique et privée, soumis au Syllabus, le prenant pour règle de leurs actions, et ils poursuivent, au dehors, leur campagne contre nos institutions au nom du cléricalisme. » Le document du bienheureux Pie IX était alors brandi comme une menace, sourde et hypocrite, à l’égard de l’État.
Un quart de siècle après, le gouvernement expulsait les religieux hors de France (1902), faisant ensuite main basse sur les édifices religieux, avec l’affrontement traumatisant des inventaires (1905) : les gendarmes s’emparaient des églises par la force malgré la résistance physique des catholiques. Par la suite, Clemenceau régla adroitement cette querelle des inventaires en sa qualité de « premier flic de France », comme il aimait à se nommer.
« Cléricalisme », le mot vient de réapparaître dans l’actualité, émanant cette fois du Souverain Pontife. Il désigne alors l’abus d’autorité dans l’Église, lorsque la paternité spirituelle ou sacramentelle devient l’occasion d’une emprise morale dévoyée, qui peut même aller jusqu’à l’abus sexuel. La gravité de telles turpitudes impose donc d’être dénoncée sans ménagement. Au Français moyen, il faut néanmoins une souplesse avisée et intelligente pour dissocier cet usage de celui qu’en faisait Clemenceau.
Pour le pape François, il s’agit d’une horrible caricature qui justifie bien l’axiome antique : corruptio optimi pessima – la corruption de ce qui est appelé au meilleur, devient alors la pire des choses. Le saint Curé d’Ars disait du prêtre, que si l’on savait comme le Bon Dieu le voit, on en mourrait ! Une lettre du Père spirituel de Marthe Robin, Georges Finet, dit bien cet enjeu merveilleux et terrifiant, tant il est grand et l’homme fragile. Ce document datant de 1943 répond bien au malaise actuel.
« Dieu partage avec ses prêtres, sa paternité ; notre mission est d’engendrer à la vie divine. C’est une mission paternelle. Mais notre paternité appelle la maternité de la Sainte Vierge. Pour être mère, Marie se donne à son enfant sans cesser d’être Elle-même, c’est-à-dire elle enfante sans cesser d’être vierge. Pour être père, le prêtre doit se donner à son enfant sans cesser d’être lui-même : c’est-à-dire il engendre sans cesser d’être vierge. La fécondité du père et de la mère pour donner le Christ suppose donc la virginité, et le prêtre ne peut engendrer en Marie, les âmes à la vie divine que dans la mesure où il est vierge. »
Le célibat sacerdotal est bien plus une mesure de discipline qui pourrait varier selon les époques. La lettre poursuit, en effet : « Dès qu’un prêtre perd sa chasteté, il ne peut plus réaliser cette transformation des âmes en Marie. Bref, le célibat ecclésiastique comme la virginité de la Sainte Vierge sont source de vie et en eux nous retrouvons l’aspect supérieur de la paternité et de la maternité perdu avec la tache originelle ». On touche donc là à l’intimité du mystère de l’Église. La désinvolture à l’égard des péchés de la chair n’est jamais anodine ; mais lorsqu’elle vient du clergé, elle est le triste indice de la disparition de l’esprit de foi, « si l’on ne veut pas réduire (celle-ci) à une théorie », écrit Benoît XVI sur le sujet (Klerusblatt, 10 avril 2019). Réservons le dernier mot à saint Jean-Paul II : « La vocation sacerdotale est essentiellement un appel à la sainteté, [une] imitation du Christ pauvre, chaste et humble ; elle est amour sans réserve envers les âmes, et don de soi-même pour leur véritable bien ; elle est amour pour l’Église qui est sainte et nous veut saints, car telle est la mission que le Christ lui a confiée » (Pastores dabo vobis, 1992, 33).