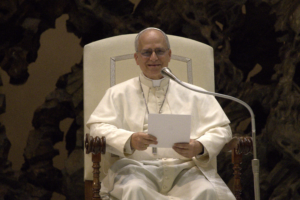Le Carême, un effort de conversion à la suite du Christ
« Après son baptême, écrit l’évangéliste saint Luc, Jésus, rempli de l’Esprit-Saint, quitta les bords du Jourdain. Guidé par l’Esprit, il fut conduit au désert quarante jours, pour y être tenté par le Diable[1] ». Ainsi le Verbe incarné voulut-il soumettre son corps à la faim, à la soif, aux veilles, pour reconquérir l’humanité blessée.
En deux versets, sous l’impulsion du même Esprit-Saint, Jésus-Christ, Fils unique du Père, est glorifié alors qu’il descend dans le Jourdain, puis humilié, exposé à la malice et aux embûches du démon. Un même idéal unit pourtant les deux scènes : Jésus descend dans les eaux qui symbolisent la vie, la grâce, l’abondance, pour y recevoir un baptême de pénitence ; il rejoint ensuite la terre aride et sèche qui rappelle notre condition pécheresse, pour y faire pénitence en notre nom.
L’ascèse, principe de renaissance spirituelle
En ce temps du Carême, l’Église, maîtresse de vie et pédagogue des âmes, nous invite à observer un certain nombre de pratiques, telles que la prière, le jeûne et l’aumône, qui ont pour fin essentielle de nous détacher des réalités éphémères d’ici-bas et de recentrer nos affections, nos forces et nos désirs sur le Christ. Dans la vie chrétienne, l’ascèse qui se manifeste par de multiples renoncements, privations, efforts et exercices spirituels, constitue une expérience de mort à soi-même.
« Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste stérile ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit[2] ». C’est ainsi que le temps du carême entend être celui du renouveau de l’âme ; pour parvenir à cette renaissance, il nous invite à mourir aux passions, aux désirs, aux péchés qui nous enchainent aux illusions et aux dangers de ce monde.
On définit ordinairement l’ascèse comme une discipline volontaire du corps et de l’esprit permettant de tendre à la perfection, un entraînement, un exercice (ἄσκησις) que saint Paul compare volontiers à la course des athlètes dans le stade. « Les athlètes, précise-t-il, s’imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une couronne périssable ; mais nous, nous acceptons ces privations pour une couronne indestructible[3] ».
L’ascèse et la mystique constituent les deux principales ramifications de la vie spirituelle ; elles doivent pallier au double désordre qui a frappé la nature humaine suite au péché originel. Ainsi, la vie mystique permet de rendre à l’âme son orientation fondamentale à Dieu ; l’ascèse, quant à elle, a pour fin de soumettre le corps aux élévations de l’esprit.
Ascèse chrétienne et ascèse païenne
La mortification chrétienne se distingue des autres formes d’ascèse divulguées par les grandes écoles philosophiques, antiques ou orientales, en ce qu’elle ne prétend pas libérer l’homme de ses misères et pauvretés par l’expérience d’un vide sans lendemain, mais qu’elle ouvre plutôt son cœur à la présence mystérieusement vivifiante du Très-Haut. Le détachement, l’anéantissement, la contrainte n’y ont donc pas valeur de fins, mais de simples moyens, en ce qu’ils sont les inévitables préambules à la rencontre avec Dieu.
« Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, écrit le prophète Joël, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour. Il renoncera au châtiment[4] ». L’ascèse chrétienne sollicite la plénitude dont Dieu comble ordinairement les âmes qui se donnent sans retour, par pur amour. Cette donation n’admet pas de demi-mesure et exige une consécration de nos sens, de nos facultés, une purification de notre intention qui, par respect pour notre divin Maître, ne s’attarde plus à désirer des biens en-deçà de ce qu’il lui propose.
L’âme fermement établie dans ces pieuses dispositions devient indifférente à son propre intérêt et s’efface devant la personnalité de Jésus-Christ qui veut s’y refléter. Cette indifférence n’est pas l’apathie stoïcienne, qui est une forme d’orgueil jointe à une insensibilité affectée ; elle n’est pas le Noble Chemin Octuple des bouddhistes qui ne produit, au mieux, qu’une fragile quiétude ; elle ne correspond pas davantage à l’ἐγκράτεια de Socrate, qui n’est qu’une performance humaine et toute naturelle.
Au contraire, elle est une attention de tous les instants à la volonté de Dieu qui se manifeste sous les nombreuses grâces, rencontres, joies, peines et circonstances qui rythment la trame de notre vie. Pour autant, l’âme fidèle ne s’y attache pas, parce qu’elle s’est élevée à un degré de vie supérieur. Elle est au-delà du faire, au-delà du ressenti et de l’impressionnable. Désormais, elle veut être. La recherche d’un tel absolu aboutit ordinairement à trois grandes formes d’ascèse, qu’illustre la triple tentation du Christ au désert : une ascèse des sens, une ascèse de l’esprit, une ascèse du cœur.
L’ascèse des sens
Les occasions de se désister affluent dans notre société, hélas si corrosive pour la pureté de l’âme. Ce monde dont Satan est le prince, démultiplie les motifs de chutes, cherche sans cesse à créer des bonheurs sur mesure pour substituer à l’amour de Dieu des béatitudes factices, trompeuses et souvent très éphémères…
Voilà pourquoi l’Église recommande le jeûne qui n’est pas seulement un jeûne alimentaire, mais une privation volontaire de tout ce qui peut nous détourner du Bien : notre goût du confort, les mauvaises relations, les addictions, les démons de l’audiovisuel…
Ce sont là de très redoutables tyrannies, qui rendent notre âme incapable de recevoir le lait et le miel des consolations divines. Cette première forme d’ascèse rend à l’homme la conscience de sa noblesse en assujettissant à la droite raison et aux commandements de Dieu ce qui, en lui, est trop instinctif, spontané, désordonné…
L’ascèse de l’esprit
L’Église ne saurait se satisfaire d’une conversion toute extérieure, formelle, superficielle : elle entend renouveler en profondeur notre existence et doit, à cette fin, étancher notre soif de possession, éteindre notre appât du gain, condamner notre interprétation matérialiste des priorités de la vie. Combien d’idoles faussent notre relation à Dieu ! Que nous sommes attachés à nos mérites, à nos exploits, à nos dons matériels et naturels… Aimons en ce temps du carême à nous détacher de ce qui est trop nôtre.
L’aumône permet certes de nous alléger d’un peu de nos biens, qui souvent s’avèrent être superflus ; mais luttons également contre l’avarice spirituelle qui porte à considérer que nous ne devons rien à personne et que nous sommes la propre cause des joies et des espérances qui viennent éclairer notre vie. La mortification de l’esprit, seconde grande forme de pénitence, consiste à rendre à Dieu l’hommage de notre entière dépendance et de notre humble reconnaissance pour les bienfaits dont il nous comble chaque jour.
Dans les mains de la divine Providence, nous serons protégés des dangers de ce monde. Alors, prédit le psaume, « le malheur ne pourra te toucher, ni le danger, approcher de ta demeure : car il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins[5] ».
L’ascèse du cœur
Enfin, l’ascèse chrétienne impose une troisième forme de discipline qui consiste en une attention émerveillée et reconnaissante vis-à-vis des dons qui jalonnent notre marche vers le ciel. « Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu[6] ». Comment nous, pauvres créatures, pourrions-nous mettre le Seigneur à l’épreuve ?
Le livre d’Isaïe nous donne un élément de réponse : alors que le roi Achaz est enfermé dans Jérusalem et que le prophète, sous l’inspiration divine, l’invite à demander à Dieu un signe, le souverain, préférant conclure une alliance avec son proche allié plutôt qu’un acte d’éperdue confiance en Dieu, affirme ne pas vouloir « tenter le Seigneur Dieu ». L’indignation d’Isaïe est immédiate : « Écoutez, maison de David ! Ne vous suffit-il pas de fatiguer les hommes ! Faut-il encore que vous fatiguiez mon Dieu[7] ! »
Tente Dieu celui qui ne s’abandonne pas résolument à la justice de ses desseins ; tente Dieu celui qui délaisse la simplicité de la foi pour courir au sensationnel, à l’éphémère reflux des modes, au prêt-à-penser que diffuse à l’envi notre société ; tente Dieu celui qui ne lui prête pas l’oreille de son cœur, celui qui ne lui fait pas confiance ; tente Dieu celui qui ne croit pas en la vertu purificatrice du pardon et en l’initiative de la grâce.
L’ascèse, don providentiel de Dieu
Compassion du Ciel et sollicitude maternelle de l’Église, l’ascèse vient réprimer les caprices de l’amour-propre, dompter le fond orgueilleux de notre nature, réformer notre mondanité et notre superficialité pour laisser davantage de place à l’amour incommensurable de Dieu.
Par l’ascèse, l’âme sanctifiée renonce aux chimères de bonheur pour la joie véritable, à l’inconsistance de ses désirs pour recevoir la plénitude de Dieu ; elle accepte humblement de descendre dans les profondeurs secrètes de sa conscience et c’est précisément là qu’elle découvrira, caché dans la solitude et le silence, celui qui, seul, peut apaiser nos soifs, combler nos faims et nous offrir le bonheur sans fin.
[1] Luc, IV, 1-2.
[2] Jean, XII, 24.
[3] I Corinthiens, IX, 25.
[4] Joël, II, 13.
[5] Psaume, XC, 10-11.
[6] Deutéronome, VI, 16.
[7] Isaïe, VII, 13.
A lire également : Traditionis Custodes : Rome renforce son contrôle