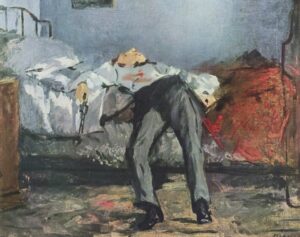Échevelées, le poitrail à l’air, le ventre en étendard, les Femen ont encore fait parler d’elles. On s’offusque, même à gauche, de cette irruption aussi indécente qu’hystérique à Notre-Dame. « Bye bye Benoît », « Crise de foi », avec d’autres messages tout aussi mémorables, écrits au marqueur noir sur le corps, elles tapaient autant qu’elles le pouvaient sur les nouvelles cloches encore exposées dans la nef de la cathédrale en hurlant « Pope no more ». C’était la provocation de trop, celle que même Bertrand Delanoë, maire de Paris, ne pouvait cautionner, c’est dire.
Les Femen méritent-elles un énième article ? Qu’on les blâme ou qu’on les loue, les activistes féministes n’ont pour seul but que de faire parler d’elles. Et pour cause. Elles n’ont pour seul argument que leur haine. Exit donc la volonté d’un réel débat.
Elles ont pour seule esthétique leur indécence et leur vulgarité. Exit donc la portée artistique de la chose.
Ces dames entendaient fêter le départ de Benoît XVI… Qu’on se le dise, nous ne voulons pas de leurs fêtes, nous avons tout ce qu’il faut en boutique. Car nous pouvons nous targuer, de Noël à Pâques, en passant par la Pentecôte et l’Ascension, de savoir célébrer, de savoir fêter, de connaître la joie. Celle qui nous vient du Christ.
La barque de Pierre a connu de sacrées tempêtes, et huit poitrails à l’air ne suffisent pas à la faire naufrager.
Ces dames entendent encore nous faire des leçons sur la place de la femme. Mais qu’avons-nous à recevoir de féministes qui ne comprennent rien à la féminité ? Qu’avons-nous besoin de Femen pour nous expliquer ce qu’est la femme, nous avons la Vierge Marie. Si les femmes ne trouvent pas leur place dans la société, qu’elles viennent dans l’Église, elles y sont sentinelles de l’invisible. Si le regard porté sur le corps par la société leur pose problème, qu’elles viennent dans l’Église, le corps y est temple de l’Esprit. Si la conception post-moderne de la sexualité les chagrine, qu’elles viennent dans l’Église, la sexualité y est communion et co-création !
« C’est l’Église comme institution qui nous gêne », explique l’une des huit activistes, interrogée après leur fracassante mise en scène.
Quant à nous, c’est la haine comme seul argument qui nous gêne…