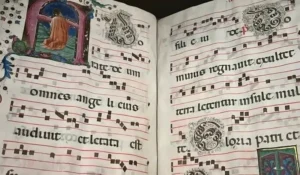Comment évoquer le principe de subsidiarité dans l’enseignement pontifical sans parler du magistère de Jean-Paul II sur la question ? Auteur de trois encycliques sociales, il est aussi à l’origine du Compendium de la doctrine sociale de l’Église. Paru dans la Lettre Reconstruire n°35 (avril 2024).
Après Paul VI, Jean-Paul II revient-il sur la notion de subsidiarité dans son enseignement social ?
Après le concile Vatican II, la doctrine sociale de l’Église a connu une sorte de période de mise à l’écart ou en tous les cas d’atténuation. Elle est moins évoquée et même regardée par certains comme suspecte. Avec son élection en 1978, Jean-Paul II change la donne. Il réintroduit officiellement les termes de « doctrine sociale de l’Église ». Il y consacre plusieurs encycliques (Laborem exercens en 1981, Sollicitudo rei socialis en 1987 et Centesimus annus en 1991 auxquelles on peut rattacher d’autres textes comme l’encyclique Evangelium vitae en 1995 ou l’exhortation apostolique Christifideles laici en 1988). Dans Centesimus annus, Jean-Paul II définit la subsidiarité en soulignant qu’« une société d’ordre supérieur ne doit pas intervenir dans la vie interne d’une société d’un ordre inférieur, en lui enlevant ses compétences, mais elle doit plutôt la soutenir en cas de nécessité et l’aider à coordonner son action avec celle des autres éléments qui composent la société, en vue du bien commun » (n. 48). Cette définition est reprise dans le Catéchisme de l’Église catholique (n. 1883).
D’autres textes importants font-ils mention du principe de subsidiarité ?
À la demande de Jean-Paul II, le Conseil pontifical Justice et Paix rédige en 2004 un Compendium de la doctrine sociale de l’Église qui paraît l’année suivante. La doctrine sociale de l’Église y est présentée dans une vision personnaliste qui prend en compte Vatican II et l’enseignement de Jean-Paul II. Il est fait mention explicitement du principe de subsidiarité. Après avoir souligné que celui-ci « figure parmi les directives les…