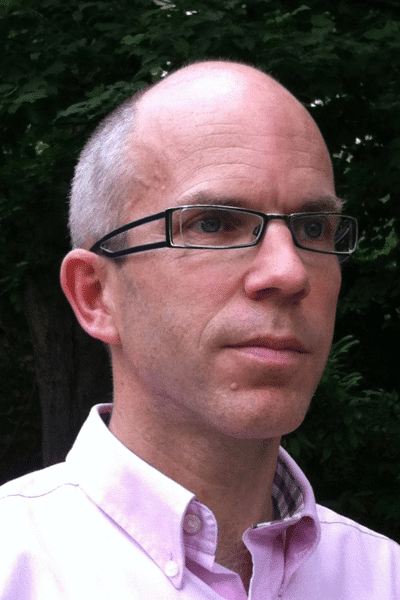Que sont les soins palliatifs et comment expliquer les grandes lacunes de l’accompagnement en fin de vie dont souffre la France ? L’avis du docteur Vincent Morel, président de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs
Propos recueillis par Adélaïde Pouchol
Vous êtes président de la Société française d’accompagnement et de soins palliatifs (SFAP), pouvez-vous nous présenter l’association ?
La SFAP est une association savante qui regroupe des professionnels qui prennent en charge des personnes en fin de vie mais également, et c’est ce qui fait sa force et son originalité, des bénévoles d’accompagnement. La SFAP veut d’abord réunir autour de la question de la fin de vie et travailler à en améliorer les pratiques par des propositions concrètes. Nous avons donc rédigé de nombreux textes à ce propos. Nous participons au débat public sur la fin de vie, nous témoignons de certaines pratiques, de la façon dont se passent les prises en charge que nous vivons sur le terrain. La SFAP entend ainsi peser sur les politiques publiques pour la prise en charge palliative. Elle se donne enfin une mission de vigilance sur les décisions politiques concernant la fin de vie. L’association regroupe 7 000 à 10 000 professionnels et bénévoles, sans compter les quelque 200 associations qu’elle fédère. Tous les ans au mois de juin, nous organisons un congrès qui réunit entre 2 500 et 3 000 personnes, ce qui en fait l’un des plus gros congrès de France.
Comment définir les soins palliatifs ?
Il n’est pas simple de définir les soins palliatifs. Je dirais qu’il s’agit de faire en sorte que le patient qui arrive au terme de sa vie ne souffre pas, soit écouté et soulagé et que sa famille soit accompagnée dans ce moment toujours difficile. Les soins palliatifs sont dans la continuité des soins curatifs, pour que la personne puisse vivre et mourir soulagée et dans la dignité. Ils recouvrent une prise en charge à la fois technique, psychologique et sociale, c’est-à-dire une prise en charge globale et regroupent ainsi un grand nombre de soignants et accompagnants autour du malade.
Vous parlez de dignité, qu’entendez-vous par là ?
C’est un terme devenu polysémique tant il est utilisé. Pour moi, comme médecin, la dignité est inaltérable et intrinsèque à l’homme. La question n’est pas d’abord de savoir comment mourir dans la dignité mais comment finir sa vie dans la dignité. Mais je pense surtout qu’il n’y a pas de personne mais seulement des situations qui soient indignes.
Quel bilan pouvez-vous faire du développement des soins palliatifs en France ?
Le dernier rapport de la Cour des comptes montre l’insuffisance des soins palliatifs en France, tant en matière de développement que de formation. D’indéniables progrès ont été accomplis depuis les années 2000 mais essentiellement dans le champ des hôpitaux ; on compte, par exemple, 400 équipes mobiles de soins palliatifs en France. Mais nous manquons clairement des structures nécessaires pour l’accompagnement palliatif à domicile et dans les établissements médico-sociaux. Seulement une personne sur deux a accès aux soins palliatifs. L’inégalité est plus forte encore dans certaines régions, il y a en France une grande disparité sur ce plan-là. L’autre drame des soins palliatifs est le manque criant de formation des professionnels de santé. Aujourd’hui, un étudiant en médecine n’a qu’une dizaine de cours sur les soins palliatifs, en tout et pour tout, sur l’ensemble de son cursus. Et la France compte actuellement seulement cinq professeurs de soins palliatifs… Les soignants connaissent mal les soins palliatifs, et, souvent, les mettent en œuvre trop tard. Et pourtant, mis en place précocement, les soins palliatifs soulagent plus efficacement le patient et permettent même d’allonger son espérance de vie. Il faut apporter des réponses qui soient à la hauteur des enjeux, de notre système de santé et de la solidarité.
Les soins palliatifs permettent toujours de trouver une réponse adaptée face à la souffrance physique ou psychologique. Il faut donc en améliorer l’accès en travaillant à la coordination et à la permanence des soins au niveau national et régional pour accompagner autant à l’hôpital qu’à la maison.
Y a-t-il un budget alloué spécifiquement aux soins palliatifs au plan national ?
Un budget spécifique avait été débloqué entre 2008 et 2012 à l’occasion du plan de développement des soins palliatifs qui avait été mis en place à ce moment-là. Il n’y a plus aujourd’hui ce budget spécifique mais des fonds sont néanmoins, de manière hélas assez inéquitable selon les régions, alloués aux équipes mobiles et unités de soins palliatifs. Il faut donc réfléchir au moyen de dégager des budgets. L’acharnement thérapeutique, par exemple, coûte très cher à la société…