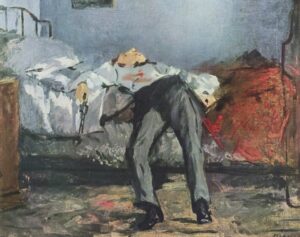À l’approche de la COP 21 fin novembre à Paris, l’urgence d’une véritable écologie – intégrale, comme le prône Laudatio si’ – apparaît de plus en plus évidente. Elle devrait aussi pointer la folle politique européenne tant en matière d’immigration qu’en matière de culture de mort.
L’écologie bien comprise ne s’arrête pas à une appréhension du réchauffement climatique ou une vénération de la chlorophylle. Car, derrière la nature, il y a le Créateur. Et entre elle et Lui, il y a l’humain, dont l’étymologie latine est humus : terre, qui est aussi la racine de « humilité ».
Comme la nature et avec elle, la société humaine fait l’objet d’une écologie, d’un écosystème (science du milieu humain) qui s’achève pour la planète en politique intégrale, dans le respect notamment des familles et des nations.
Ce n’est pas l’individu mais la cellule familiale qui constitue en effet le noyau fondamental du milieu humain établi sur un modèle organique. La science du milieu humain commence nécessairement par la famille pour aller jusqu’à la société nationale et internationale (famille de familles) en passant par les communautés de travail et de culture liées à l’Histoire.
Une œuvre commune
Chaque lieu communautaire, spécifié par une fonction et un bien commun différents, implique l’expérience d’une coopération en vue d’une œuvre commune pour vivre le mieux possible ensemble. Soit un engagement pratique où l’on n’est pas seul en cause, mais où l’on dépend de la volonté de plusieurs autres, selon la nature et la culture (et donc l’histoire) humaines. Rompre avec les équilibres et l’harmonie de l’« écosystème humain » de la planète par un mondialisme de mauvais aloi que ce soit en termes de biotechnologie, de productivisme ou de déplacements humains, c’est préparer la guerre et le malheur de l’homme.
Vivre selon la nature, pour l’homme créé à l’image de Dieu, c’est vivre selon la raison dans toutes ses dimensions dûment hiérarchisées. Ni tyranniser la nature en absolutisant « la technique et le pouvoir humain », ni l’adorer en se prêtant à « un nouveau panthéisme aux accents néo-païens ». Mais la « domestiquer » respectueusement en poursuivant en quelque sorte l’œuvre et l’ordre de Dieu : « Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la… » (Gn 1, 28). Plus qu’une science, l’écologie (le rapport de l’homme avec son milieu y compris humain) est une sagesse qui redonne à l’homme ses véritables repères, lui réapprend ses limites, sa vraie situation et sa responsabilité à l’égard de la nature et du milieu humain. C’est à la fois une école de contemplation et d’action, qui enseigne avant tout la primauté de la première sur la seconde. C’est une école d’architecture : on y apprend à conjuguer les dimensions humaines aux dimensions naturelles et divines, l’utile et le beau, l’utile et le bien, la quantité et la qualité au service de la finalité temporelle et spirituelle de l’homme. Elle démontre comment la main de l’homme peut transformer la matière sans déparer la nature, lorsqu’elle suit la main de Dieu.
Une crise morale
Entre les mythes réactualisés du bon sauvage et de Prométhée, il y a la place pour une politique écologique raisonnable. Entre la loi de la jungle et la Babel moderne du métissage obligatoire, entre la barbarie primitive et celle moderne « à visage transhumain », se tient la culture, les mœurs et les vertus chrétiennes auxquelles appelait le pape Benoît XVI avant le pape François dans une profonde révision de vie commune parce que la crise écologique est avant tout une crise morale et métaphysique.
L’urgence d’une solidarité inter- et intragénérationnelle qui se déploie dans l’espace et le temps, conformément au principe de la destination universelle des biens, ne peut se faire n’importe comment, selon le message de nos deux derniers papes. Lequel message fait irrésistiblement penser à Saint-Exupéry : « Nous ne recevons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants. » Nous devons nous considérer comme débiteurs insolvables non seulement vis-à-vis de nos ancêtres mais aussi vis-à-vis des générations futures. Ainsi en va-t-il de tout patrimoine, qu’il soit naturel ou humain, de tout bien qu’il soit commun ou particulier, qui nous sont confiés comme aux intendants de la parabole, dont il dépend de faire progresser ou non le monde qui les entoure, selon les lois de la nature (humaine).