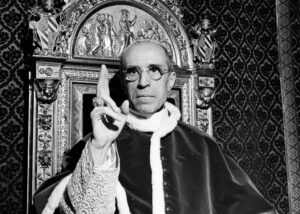Les 31 mars et 1er avril 2025, à Lourdes, la Conférence des évêques de France (CEF) a réuni plus de 300 participants pour faire le point sur les mesures mises en place depuis le rapport Sauvé et tracer de nouvelles pistes dans la lutte contre les abus sexuels dans l’Église.
Les 31 mars et 1er avril 2025, à la veille de l’Assemblée plénière de printemps, la Conférence des évêques de France a réuni plus de 300 participants à Lourdes pour faire un point d’étape sur la mise en œuvre des mesures de lutte contre les violences sexuelles dans l’Église, engagées depuis la remise du rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels (CIASE) en octobre 2021. Ce temps de travail a alterné tables rondes, ateliers, relectures spirituelles et événements culturels. Il s’inscrit dans un processus lancé en novembre 2021, lorsque les évêques avaient décidé de constituer neuf groupes de travail pour approfondir les recommandations formulées par la CIASE dans l’Église.
Des recommandations partiellement mises en œuvre
À l’ouverture des travaux, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, président de la CEF, a rappelé que cette session répondait à l’engagement pris par les évêques de faire un bilan deux ans après la remise des rapports des groupes de travail post-CIASE, présentés en mars 2023. Ces groupes, composés de personnes victimes, de laïcs, de prêtres, de religieux et d’évêques, avaient formulé des préconisations concrètes, partiellement mises en œuvre depuis. Un rapport d’évaluation a été présenté en séance, soulignant des avancées certaines, notamment en matière de formation, de prévention, d’écoute des victimes et de gouvernance, mais aussi des retards, des résistances et des lacunes dans l’appropriation des dispositifs. Le rapport met en avant une volonté réelle de changement mais insiste sur la nécessité de poursuivre le travail dans la durée.
Au cours de la session, plusieurs initiatives locales ont été présentées par des diocèses, des mouvements ou des communautés religieuses. Lundi soir, un ciné-concert conçu par Olivier Savignac, lui-même victime, a été projeté. Intitulé L’enfant du silence, ce spectacle mêle musique et vidéo pour évoquer le traumatisme lié aux abus subis durant l’enfance.
L’ombre persistante de Bétharram
Le colloque a été marqué par la proximité géographique et chronologique avec l’affaire de l’institution Notre-Dame de Bétharram, située à quelques kilomètres de Lourdes. Depuis 2024, plus d’une centaine de plaintes ont été déposées contre cette école catholique pour des faits de violences sexuelles, physiques et psychologiques survenus entre les années 1950 et 2010. Cette affaire a été largement évoquée en marge des travaux, d’autant que la médiatisation de ces faits a entraîné une hausse des demandes adressées aux instances de reconnaissance créées en 2021 par l’Église de France.
Lors de la table ronde du mardi matin, Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, Marie Derain de Vaucresson, présidente de l’Instance nationale indépendante de reconnaissance (INIRR), et Antoine Garapon, président de la Commission reconnaissance et réparation (CRR), ont présenté un état des lieux du fonctionnement de ces deux instances de reconnaissance et de réparation. Depuis leur création, l’INIRR a été saisie par environ 1 600 victimes présumées et la CRR par un peu plus de 1 000. Le montant moyen des réparations s’élève à 38 000 euros par personne dans le cadre de l’INIRR, contre 13 500 euros en moyenne dans d’autres cadres judiciaires. Les deux responsables ont souligné la difficulté d’une démarche de réparation en dehors du cadre judiciaire.
Dialogue avec la société civile
Une dernière table ronde a permis d’ouvrir un dialogue entre l’Église et la société civile. Plusieurs intervenants issus du monde de la santé, du droit et de l’éducation ont partagé leur expertise et envisagé les moyens d’une action commune contre les violences sexuelles. Si la session a montré une mobilisation réelle, elle a aussi révélé des limites persistantes. L’absence notable de représentants de l’enseignement catholique a été pointée par plusieurs participants, de même que l’impossibilité d’organiser une séquence dédiée au Saint-Siège, pourtant initialement prévue. Le nonce apostolique Mgr Celestino Migliore et l’ambassadrice de France auprès du Saint-Siège, Florence Mangin, ont néanmoins assisté à la session, témoignant du lien entre l’Église de France et les autorités ecclésiales et diplomatiques.
La session s’est conclue par une prise de parole conjointe de Mgr de Moulins-Beaufort, de sœur Véronique Margron, présidente de la CORREF, et du père Patrick Goujon, jésuite et auteur d’un témoignage sur les abus subis dans sa jeunesse. Tous trois ont insisté sur la nécessité d’une vigilance collective, d’une transformation des mentalités et d’un engagement durable au service des personnes victimes. Cette session de Lourdes n’a pas clos le travail de l’Église sur la question des abus, mais elle a marqué une étape significative dans un processus encore long.
Les mosaïques de Rupnik partiellement recouvertes
Dans le même temps, à quelques mètres du lieu du colloque, une partie des mosaïques du prêtre slovène Marko Rupnik, accusé d’agressions sexuelles, a été recouverte le 31 mars sur la façade de la basilique du Rosaire. Deux portes latérales ont été occultées par des panneaux, et les deux grandes portes centrales doivent l’être d’ici quelques jours, selon Mgr Jean-Marc Micas, évêque de Tarbes-Lourdes. Ce dernier a déclaré qu’il s’agissait d’un “nouveau pas symbolique” afin que l’entrée dans la basilique soit facilitée pour toutes les personnes ne pouvant plus en franchir le seuil en raison de ces représentations.
Déjà en juillet, l’évêque avait annoncé la fin de l’éclairage des mosaïques dorées, qui étaient mises en valeur lors des processions nocturnes. Une commission diocésaine travaillait sur ce sujet depuis deux ans. Le père Rupnik est mis en cause depuis novembre 2022 dans plusieurs affaires d’abus sexuels, psychologiques et spirituels, concernant au moins 41 femmes. Aucune poursuite pénale n’a été engagée, les faits étant prescrits. Il a été exclu de la Compagnie de Jésus en juillet 2023 et interdit de toute activité artistique publique. Ses œuvres demeurent présentes dans de nombreux sanctuaires, dont Lourdes, Fatima, la cathédrale de Madrid, ainsi que plusieurs églises paroissiales en France.
>> à lire également : Affaire Bétharram : une prise en charge nécessaire dans un climat médiatique confus