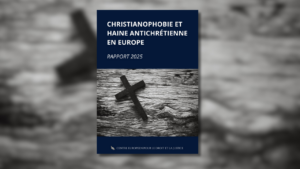Partenaire du Congrès Mission 2025, l’Institut catholique d’études supérieures (ICES) revendique une pédagogie fondée sur l’exigence intellectuelle et la rencontre humaine. Son président, Éric Ghérardi, revient sur la vocation propre d’une université catholique : former l’intelligence sans dissocier la foi, la raison et la charité.
| Selon vous, qu’est-ce qu’une université catholique ?
C’est, au sens de saint Thomas d’Aquin, un établissement d’enseignement supérieur qui sait concilier foi et raison : pleinement universitaire dans l’exigence et la rigueur scientifique, capable de porter le savoir au plus haut niveau et d’être toujours à la pointe des innovations pédagogiques indispensables pour assurer la transmission, alors même que les générations d’étudiants changent très vite dans leur manière d’apprendre.
Mais lorsqu’on met l’étudiant au cœur de la démarche, on entre dans la mission propre d’une université catholique : être un lieu qui met concrètement en pratique le sens de l’Évangile.
Le premier sens, c’est de s’adresser à tous. Nous ne nous adressons pas uniquement à des catholiques pratiquants. Notre démarche consiste à être ouverts à tous, et notre identité catholique nous oblige à prendre soin des plus faibles : les plus fragiles sur le plan académique, parce que certains ont des lacunes importantes, y compris dans l’expression écrite ; les plus fragiles sur le plan social, puisque 37 % de nos étudiants sont boursiers ; et enfin les plus fragiles sur le plan humain.
C’est pourquoi nous déployons un accueil attentif : accompagnement par des référents pédagogiques, présence d’une infirmière, d’un psychologue, et de prêtres et religieuses qui sont d’abord dans une mission d’écoute. Chaque année, nous avons de nombreux catéchumènes, mais aussi des étudiants très éloignés de la foi, qui viennent parfois simplement échanger.
Nous sommes confrontés à une jeunesse qui manque de repères et d’adultes capables d’indiquer une direction. Les ravages de l’abandon déguisé en liberté ultra-individualiste font des générations perdues. Notre démarche, c’est donc de proposer un cadre, tout en respectant la liberté de chacun.
| Diriez-vous que l’ICES est un lieu de mission ?
Nécessairement. Assumer notre identité catholique fait partie de notre mission, comme le rappelle souvent l’enseignement catholique dans son ensemble et la seule manière de l’assumer, c’est d’être irréprochable sur le plan scientifique. Sans exigence intellectuelle, il n’y a plus d’université.
| Quels sont les plus grands défis aujourd’hui pour vous en tant qu’université catholique ?
Le principal défi, c’est de conserver l’originalité de notre modèle alors que de plus en plus d’étudiants souhaitent nous rejoindre. Notre modèle repose sur un suivi hebdomadaire et individuel : chaque étudiant est accompagné personnellement, et cela demande une grande souplesse pour ne pas nous affadir en grandissant.
| Pensez-vous que l’identité chrétienne joue dans votre croissance ?
Certainement, mais il est difficile d’en mesurer la part exacte. Certains viennent pour notre taux de réussite (85 % de réussite à la licence en trois ans), d’autres parce que l’ICES a été créé comme un établissement de proximité pour les jeunes Vendéens qui n’avaient pas les moyens d’aller étudier à Nantes, Angers ou Poitiers.
Ce n’est pas l’étendard chrétien qui attire : c’est la manière de faire, jusque dans les détails les plus simples, « en chrétien ». C’est l’attention portée à chacun, des relations empreintes de liberté, de sérénité et de recherche de vérité.
Ce succès, c’est celui d’un modèle universel qui interpelle chacun. Nous avons toujours un noyau de chrétiens pratiquants, mais aussi des jeunes d’horizons très divers. Il est beau de voir des étudiants très éloignés de la foi demander le baptême ou la confirmation. Ces demandes de sacrements sont en forte croissance depuis trois ou quatre ans.
| Arrivez-vous à faire cohabiter ces différents profils d’étudiants ?
C’est un défi permanent. Nous avons travaillé sur la cohésion et la vie étudiante : engagement, bénévolat, don de soi dans les associations… Cela a permis d’améliorer l’intégration de tous les étudiants. Grâce aux doubles licences et à la diversification de nos formations, la sociologie de nos étudiants s’est beaucoup enrichie.
La diversité de notre communauté – qu’elle soit géographique, sociale ou culturelle – est une richesse immense, à partir du moment où chacun respecte l’identité et le projet de notre établissement. Ce que nous voulons cultiver, c’est une véritable courtoisie : une atmosphère qui élève l’âme et l’esprit, où la conversation devient féconde.
Ici, on apprend à penser, à se fortifier dans sa propre réflexion, à accueillir la contradiction non pas comme une menace, mais comme une chance de grandir. C’est un chemin exigeant, mais profondément formateur.
D’ailleurs, certains étudiants arrivent sans réelle connaissance du fait religieux, et découvrent ici dans le christianime, une spiritualité vivante, animée. Certains en font même un véritable chemin de conversion : c’est bouleversant, et c’est la plus belle preuve que la rencontre, quand elle est authentique, peut transformer.
| Concrètement, qu’est-ce qui est proposé à un étudiant lorsqu’il arrive chez vous ?
Dès la rentrée, chaque étudiant est accueilli dans un esprit de maison : un parrainage entre promotions, des groupes à taille humaine et une journée de cohésion avec toute l’équipe de direction pour transmettre la culture de l’établissement.
L’accompagnement est global : ateliers sur la vie affective, la santé, la gestion du stress, présence d’une équipe médicale et engagement dans une association ou un service bénévole – près de cinquante au total !
L’ICES vit du matin au soir, jusqu’à 22 h 30, pour que les étudiants puissent y grandir autrement que dans les cours. Et surtout, on y cultive une vraie courtoisie : saluer, écouter, raccompagner… Ce n’est pas un règlement, c’est un art de vivre.
Les visiteurs le remarquent souvent : « Vos étudiants sourient et disent bonjour. » C’est peut-être le plus beau résumé de l’esprit ICES.
| Avec une telle croissance, est-il difficile de garder cet esprit ?
C’est un vrai combat, mais on y arrive. Il faut de la volonté et une vigilance constante pour ne pas se laisser gagner par les modes ou les tendances.
L’ICES connaît parfois de petites « crises de croissance » : il faut adapter les structures pour continuer à dispenser un enseignement fidèle à notre philosophie. Mais cette croissance est aussi une chance, car elle nous oblige à nous réinventer.
Nous avons la liberté de le faire, malgré les contraintes administratives. Trop souvent, dans les œuvres catholiques, on a peur de l’ambition, par crainte de paraître arrogants. Ici, en Vendée, nous croyons à l’enthousiasme et à la créativité.
| Comment l’identité chrétienne se manifeste-t-elle dans la relation enseignant-étudiant ?
L’enseignant est là d’abord pour transmettre un savoir, mais à l’ICES il a aussi une mission éducative. Il enseigne à de petits groupes d’étudiants qu’il connaît : cela change tout.
Nous considérons que le professeur a une mission morale : aider l’étudiant à grandir intellectuellement, humainement et spirituellement, à donner le meilleur de lui-même pour le bien commun. Nous ne demandons pas aux enseignants leurs convictions personnelles ; chacun est libre. Mais nous attendons qu’il n’y ait pas de contre-modèle. Nous restons attachés à notre identité et à la cohésion de l’établissement.
L’enseignant signe une charte d’engagement qui inclut le suivi des étudiants : il ne vient pas seulement dispenser des heures de cours. Notre raison d’être est l’incarnation : enseigner à distance n’a pas de sens pour nous. La relation humaine est au cœur de notre pédagogie.
| En 2023, l’ICES a été reconnu par la Conférence des grandes écoles (CGE). Qu’est-ce que cela change pour vous ?
C’est une marque d’exigence. Être membre de la Conférence des grandes écoles est un gage d’excellence. Cela confirme notre volonté d’être à la pointe du savoir.
Nous avons un nombre d’enseignants-chercheurs permanents bien supérieur à celui de nombreux établissements privés. Nous produisons de la recherche, nous organisons des colloques ouverts à tous.
Par exemple, un colloque récent sur la paternité réunissait des chercheurs du CNRS, des magistrats, des maîtres de conférences des universités publiques. Nous ne travaillons pas « dans notre coin » : nous sommes résolument universitaires et pleinement catholiques.
| Quel est le rôle d’un institut catholique comme le vôtre dans l’Église de France aujourd’hui ?
Nous sommes effectivement un institut catholique, pas une université, pour des raisons juridiques et aussi par humilité : les universités catholiques historiques comptent plus de dix mille étudiants ; nous en avons deux mille deux cents. Nous devons rester à notre place.
Notre rôle, c’est d’être un lieu de christianisme vivant, fécond et incarné dans la société.
Une université catholique, selon saint Jean-Paul II et Benoît XVI, fait progresser la pensée humaine par son exigence et sa rigueur scientifique. Elle contribue au bien commun en éclairant la raison par la foi. C’est ce que nous essayons de faire : mettre la sagesse chrétienne au service des défis contemporains.
| Quelle est votre participation au Congrès Mission ?
Nous sommes partenaires nationaux cette année. C’est essentiel pour nous. Nos étudiants participent activement : bénévolat, tenue de stand, implication dans les parcours spirituels. En un mois, quatre-vingts étudiants se sont inscrits à des parcours vers les sacrements.
Être au Congrès Mission, c’est affirmer que la mission ne concerne pas seulement la pastorale ou les paroisses, mais aussi les lieux de formation, de culture et de savoir.
Missionnaire en 2025
« Le Congrès Mission, une œuvre de communion » (1/5)
« L’évangélisation reste un acte humain » (2/5)
« La messe traditionnelle attire et convertit » (4/5)
« Quand le cinéma devient mission ! (5/5)