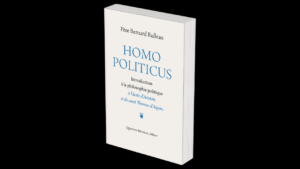Le 11 décembre prochain, nous célébrerons le centenaire de la naissance d’Alexandre Soljénitsyne, lequel est décédé il y a dix ans, le 3 août 2008.
Soljénitsyne est évidemment un nom qui porte à lui seul l’écho d’un combat pour la vérité, une exigence morale constante opposée aux mensonges du totalitarisme communiste. Porte-voix des déportés du goulag, analyste et historien de la Révolution bolchevique et de ses conséquences pour la Russie et le monde, témoin inclassable qui ne put taire également les faillites de l’Occident libéral, Soljénitsyne fut aussi et peut-être d’abord un immense écrivain.
En parallèle du hors-série que nous venons de lui consacrer, il nous a semblé intéressant d’évoquer aussi certains de ses grands romans. À travers ce genre littéraire, Soljénitsyne a donné à voir et à sentir la réalité soviétique, même dans sa banalité, permettant ainsi par le pouvoir des mots de saisir un monde inconnu, mystérieux à certains égards, recouvert à la fois d’une chape de plomb et d’une humanité ordinaire.
Premier livre publié
Une journée d’Ivan Denissovitch est le premier roman publié (mais non le premier roman écrit) de l’écrivain russe. Conçu au début des années 1950, alors que Soljénitsyne était déporté dans un camp, rédigé en 1959, repris en 1961 et allégé, le roman est proposé à la très soviétique revue Novy Mir. Son directeur, Alexandre Tvardovski, est emballé par le texte et parvient, en 1962, au prix de certaines coupures et d’une dépense d’énergie à le publier dans sa revue, après en avoir reçu l’autorisation du Politburo et de Khrouchtchev en personne. Cette publication profite de la déstalinisation alors en cours et Soljénitsyne parvient à s’engouffrer un temps dans ce trou d’air qui va vite se refermer. Dès 1963, le roman paraît en France, avec une préface de Pierre Daix. Une seconde édition, complète et plus fidèle, verra le jour dix ans plus tard.
Proust, Flaubert et Céline
Pierre Daix ? Le nom ne dira pas forcément quelque chose aujourd’hui. Écrivain et journaliste, membre du Parti communiste français, résistant et déporté, Pierre Daix occupa des fonctions officielles dans l’appareil du Parti et au sein de ses courroies de transmission à destination des intellectuels. Après la mort de Staline, il accueille favorablement la remise en cause de l’héritage de Staline et c’est à ce titre que ce communiste en vient à préfacer la première publication française du roman Une journée d’Ivan Denissovitch.
Au fond, quoi de plus normal ? Publié par une revue soviétique officielle, Soljénitsyne est un auteur qui permet – du moins le croit-on alors – de mettre en cause le règne de Staline sans rejeter le communisme. Peu à peu, Pierre Daix a admis de son côté une partie de la réalité soviétique : oui, il y a des camps ; oui, il a refusé de les voir, lui l’ancien déporté à Mauthausen ; oui, ces anciens compagnons de captivité russes ont été directement envoyés au Goulag à leur retour d’Allemagne ; oui, …
Dans Ce que je sais de Soljénitsyne, un livre publié en 1973, Pierre Daix décrit sa découverte d’Une journée d’Ivan Denissovitch, à travers la lecture de Novy Mir. Le témoignage est intéressant parce qu’il dit beaucoup de la surprise suscitée par l’écrivain et par son livre, de la qualité littéraire et de la langue utilisée. « Le numéro de Novy Mir, écrit Pierre Daix, traînait sur la table basse. Je le pris. Je m’attendais à trouver du russe simple, du russe des journaux, que je déchiffrais aisément. L’attaque du récit m’était totalement incompréhensible. Non seulement le vocabulaire me manquait, mais je n’arrivais pas à reconstituer les phrases. Je les sentais profondément rythmées, lentement, rigoureusement déployées. Le sens continuait à m’échapper.
– C’est Proust et Flaubert.
Je n’avais pas entendu Elsa (il s’agit d’Elsa Triolet, écrivain et épouse d’Aragon, ndlr) s’approcher. Ce qu’elle venait de dire me parut absurde. Elle rit de mon air interloqué.
– C’est la grande prose russe, Pierre. Un véritable classique. C’est extraordinaire. Je ne sais comment vous expliquer. C’est comme si, chez nous, vous tombiez sur le premier livre d’un inconnu, qu’on vous l’ait vanté seulement pour l’anecdote, et que vous découvriez qu’on n’a jamais écrit la langue française comme ça depuis Proust, depuis Flaubert. Et lui, c’est les deux ensemble. Ajoutez-y Céline pour le langage populaire. C’est d’une richesse… C’est proprement intraduisible. »
Dans les yeux d’un zek
Bâti sur l’unité de temps, d’action et de lieu, Une journée d’Ivan Denissovitch conte la vie dans un camp pendant une journée, à travers le regard d’un déporté, le zek Choukhov, fils de Denis, d’où son nom. De 5 h 00 du matin au soir tombant, le lecteur suit Choukhov dans sa lutte pour la survie, dans son travail et son face-à-face vis-à-vis des intempéries s ans oublier les combines et les stratégies mises en œuvre par les autres prisonniers. Dans les pensées cachées de Choukhov aussi, ses attentes, ses espoirs et ses craintes. Une journée, une journée parmi toutes les autres d’un déporté qui pressent que lorsque le temps de la libération viendra, il en reprendra à nouveau pour dix ans… Une seule journée dont le lecteur ne sort pas indemne.
Et, pourtant, il n’y a pas de pathos, pas de lyrisme, pas d’emphase dans ce roman, ni non plus une description froide d’une réalité terrible. Le déroulement de la journée est vu à travers les yeux de Choukhov et, miracle de la littérature, les sentiments du lecteur varient en fonction des propres variations du zek. Jusqu’à ce que la dernière page se referme et que le lecteur retourne à sa liberté laissant le zek à son univers concentrationnaire et sibérien. C’est alors vraiment qu’il fait froid. Du froid glacial de l’enfermement et de la mort.
À vrai dire, les comparaisons faites par Elsa Triolet pour permettre à Pierre Daix de saisir la nouveauté Soljénitsyne ne fonctionnent pas. Du moins, pas tout à fait ! Son atelier d’écriture, Soljéntisyne l’a trouvé au goulag, et le dépouillement et la sobriété d’Une journée d’Ivan Denissovitch en sortent très clairement. L’argot des camps peut évidemment entraîner le rapprochement avec Louis-Ferdinand Céline, mais pas au-delà.
Il faut s’y résoudre. Soljénitsyne est Soljénitsyne et Une journée d’Ivan Denissovitch, est une bonne porte d’entrée pour découvrir son œuvre romanesque.
Alexandre Soljénitsyne, Une journée d’Ivan Denissovitch, Robert Laffont, coll. « Pavillon Poche », 240 p., 8 €.
Pour aller plus loin, procurez vous notre Hors-Série double sur Alexandre Soljénitsyne.