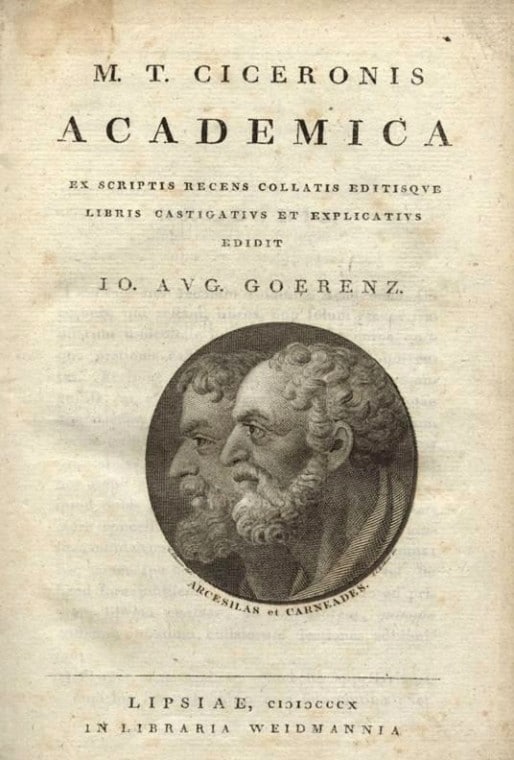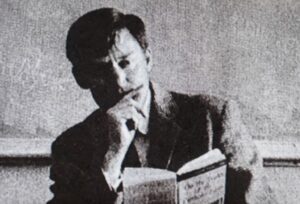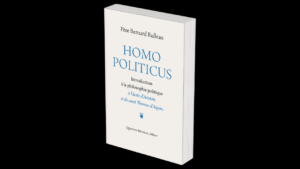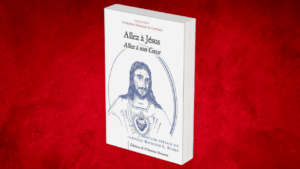Pourquoi continuer d’enseigner et apprendre le grec et le latin ? La question, ancienne, a suscité de nombreux débats, et autant d’ouvrages, pour ou contre. Aujourd’hui, alors que la défaite des humanités dans les programmes scolaires semble parachevée, des universitaires de toutes nationalités se mobilisent encore pour redonner le goût des études classiques.
L’« Association le Latin dans les littératures européennes » a réuni à l’occasion d’un colloque à Paris en 2012 seize personnalités françaises et étrangères afin de dénoncer l’éradication d’une langue sans laquelle nous perdons, outre le sens de nos langues maternelles, notre culture, notre histoire et la conscience de notre commun passé européen. Comment s’opposer à cette « logique soft de talibans » ? Comment convaincre que défendre le latin n’est pas une forme hypocrite de nationalisme et de repli identitaire malsain ? Comment empêcher qu’en « chassant le latin », nous fassions du français « un simple outil de communication » incapable de s’affirmer longtemps face à un anglais devenu pidgin ?
Sous la direction de Cecilia Suzzoni et Hubert Aupetit, seize conférenciers de haut vol, dont les interventions sont reprises en volume (Sans le latin, Mille et une nuits, 420 p., 19 €) démontrent l’urgence de sauver le latin pour ne pas nous perdre nous-mêmes et n’avoir plus rien à transmettre aux générations futures.
Le professeur Wilfried Stroh, éminent universitaire munichois et animateur d’une émission longtemps prisée de la télévision bavaroise, pensait, et l’idée se défend, que le latin n’était pas mort, comme on le prétend, aux temps barbares, quand ses locuteurs s’étaient mis à parler des charabias vaguement romanisés et s’étaient retrouvés dans l’impossibilité de communiquer entre eux en langue vulgaire, mais à l’époque augustéenne, lorsque les Romains eux-mêmes avaient estimé que leur langue avait atteint, avec Cicéron, Horace, César et Virgile, une telle puissance, une telle magnificence, qu’elle ne devait plus changer sous peine de déchoir de sa perfection. Enfermé dans un glorieux immobilisme, le latin s’était condamné à devenir une langue morte, mais était entré de plein pied dans l’immortalité, de sorte qu’il n’avait jamais cessé de vivre.
Le latin est mort, vive le latin ! (Les Belles Lettres, 302 p., 26 €) s’adresse d’abord à un public allemand et certains de ses développements concernent peu le lecteur français ; cependant, toute la première partie, consacrée à la formation et l’évolution de la langue latine, en même temps qu’à une excursion commentée dans sa littérature, est remarquable et stimulante.
Dans le même esprit, il faut impérativement lire Nicola Gardini dont on vient de traduire Vive le latin, histoires et beauté d’une langue inutile (Éd. de Fallois, 280 p., 18 €).
Si les rapports existant entre un Italien et sa langue mère ne sont pas les mêmes que ceux qui unissent un Français au latin, l’essentiel de l’essai est parfaitement extrapolable, d’autant que le traducteur a su avec intelligence adapter le texte quand il le fallait. Il s’agit ici d’une histoire de la langue latine à travers ses auteurs, non pas tant d’un point de vue historique que littéraire. Gardini aime passionnément le latin, et veut le faire aimer, en vous immergeant dans ses textes.
Que vous n’ayez jamais lu les grands classiques latins, ou n’ayez plus eu l’occasion de les reprendre, vous constaterez, grâce à ce livre, l’extraordinaire actualité de ces œuvres et de cette pensée.
Mépriser l’opportuniste que fut Cicéron ne vous empêchera jamais d’admirer le styliste prodigieux des Catilinaires. Lucrèce, trop souvent restreint à son athéisme, peut vous tirer des larmes, et vous vous apercevez, étonné et ravi, que vous êtes encore capable de traduire peu ou prou Catulle, Horace, Virgile. Gardini vous démontrera aussi que le latin des Pères de l’Église reste du grand latin.
Vous aurez envie de revenir à ces textes. Si nous en faisions tous autant, qui sait si les lettres classiques ne seraient pas sauvées ?