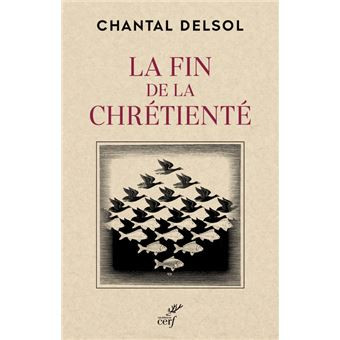Chantal Delsol, philosophe spécialiste de l’Antiquité gréco-romaine, élève de Julien Freund, a infléchi en cours de carrière sa passion spéculative vers l’étude de la pensée contemporaine. Professeur des Universités, désormais émérite, elle a publié de nombreux essais dont la tenue intellectuelle et la hauteur de vue lui ont valu d’être élue, en 2009, à l’Académie des sciences morales et politiques. Le dernier en date : La fin de la chrétienté, vient de paraître aux éditions du Cerf.
Cette catholique, mère de six enfants (dont un adoptif), élevée dans un milieu favorisé du Lyonnais, n’a jamais caché son aversion pour le communisme, lequel était encore, durant ses études, l’opium des intellectuels, selon l’expression heureuse de Raymond Aron. Libérale-conservatrice, selon ses dires, soutien discret mais fidèle des choix de société cruciaux tels que le refus du mariage pour tous, ou la dénonciation de l’effondrement général du niveau scolaire, cette observatrice attentive de ses semblables jouit d’un crédit notable auprès des milieux catholiques soucieux de le rester.
Un livre accessible et… décevant
Cette Fin de la Chrétienté méritait donc l’étude, en raison de l’excellente réception dont l’ouvrage a fait l’objet, d’une part, et de son contenu, provocateur plus encore que décevant, d’autre part. Son succès tient aussi à son accessibilité. En 170 pages lisibles par un presbyte assis sur ses lunettes, l’affaire est conclue. La Chrétienté n’est pas l’Eglise. « Il s’agit de la civilisation inspirée, ordonnée, guidée par l’Eglise ». Elle a duré 16 siècles, de l’Edit de Milan à la dépénalisation de l’IVG. Elle est désormais défunte. Elle a lassé les peuples qu’elle animait, et savez-vous de quelle façon ? « Nous avons profané l’idée de vérité, à force de vouloir à tout prix identifier la Foi à un savoir » (p.125). Cet abus aurait précipité sa fin. La croyez-vous inconsolable de ce désastre ? Que nenni : « Renoncer à la Chrétienté n’est pas un sacrifice douloureux. » (p.170). In cauda venenum.
En clair, la Chrétienté serait morte de s’être prise au sérieux. L’harmonie entre l’Eglise et la cité chrétienne n’aurait pas survécu à la tyrannie de la vérité, aggravée du refus radical de la Modernité. Cette thèse choyée des novateurs, sans discontinuité depuis les abbés démocrates du XIXe siècle et les modernistes de la Belle Epoque jusqu’à nos jours, pourrait suffire à remiser l’ouvrage, si n’était en question le sens de ce nouvel assaut de la part d’une érudite passant pour proche des milieux traditionnels. A vrai dire, si la thèse n’est pas neuve, et sauf à n’être pas comprise, il n’était pas d’usage, dans nos rangs, qu’elle soit applaudie !
Par égard pour l’académicienne engagée, on pouvait faire œuvre de justice en tentant de reconstituer la genèse de ce « livre de confinement », tel que Chantal Delsol le qualifie face au journaliste Jean Marie Guénois peu après la parution. Le contenu synthétique de l’ouvrage a sa cohérence propre, et la chute, tout autant que la pointe, choqueront tout lecteur réellement catholique. Résumons-les : La fin de la Chrétienté est un fait patent, depuis la deuxième moitié du XXe siècle. Contrairement à ce que d’aucuns (chez les dévots) redoutent, ce n’est ni le début du chaos, ni la fin du monde. Le paganisme antique, que l’Eglise a subverti puis remplacé, réalise de nos jours une subversion inverse. Cette inversion normative fait ressurgir le polythéisme, lequel devrait mériter le respect à défaut d’imposer l’adhésion. Car il fut l‘état naturel des peuples durant quelques millénaires. Cette restauration, pour être tardive, et s’effectuer sur les dépouilles opimes de la Chrétienté, donne à penser que le paganisme religieux n’a jamais disparu durant l’époque chrétienne, le bon grain et l’ivraie croissant de conserve. La résurgence ne saurait en créer l’effroi. Pourtant, une véritable inversion ontologique est à l’œuvre : une nouvelle citoyenneté, de nouvelles valeurs, de nouveaux consensus prennent place comme mars en carême. Sans oublier la novlangue des initiés, dont l’ignorance trahit les passéistes, et les déconsidère pour mieux les traquer. Avec la modernité tardive, concept que Chantal Delsol préfère à celui de postmodernité, le temps cyclique fait son grand retour en terre déchristianisée. Qu’est-ce à dire concrètement ? Que la vie collective se déploie comme elle peut, en privilégiant ce qui repousse les conflits, et assure le « vivre-ensemble » entre deux catastrophes. A l’échelon individuel, chacun redevient Sisyphe, poussant le même rocher chaque matin, tel un jour réitéré sans fin ni mémoire.
Ouf ! Tout va bien
Pour l’académicienne, la fin de la Chrétienté n’est pas la fin du Christianisme. Certes, le discrédit du dogme, le détachement progressif des mœurs catholiques, l’éloignement de toute liturgie contribuent à vider les églises. Mais la culture chrétienne, telle que le rythme donné par les fêtes religieuses, le culte des défunts, l’admiration vouée aux cathédrales, et aux sites d’exception tels que le Mont Saint Michel, Vézelay, le Mont Sainte Odile ou Rocamadour, sans oublier les saints du calendrier, laisse perdurer la mémoire de convictions partagées, au titre, non du vrai, mais du beau. Le beau rassemble, et l’art rapproche, sans que le poète ait à justifier ses vers pourvu qu’ils rimassent, et que le romancier soit contraint à davantage qu’à la cohérence des récits de son invention. Analogiquement, nos contemporains apprécient la mythologie qui illustre sans s’imposer, et la sagesse qui s’adosse à des vertus sans contrainte. L’heure est à la décrispation, à l’optionnel, mais le libre choix est de plus en plus illusoire.
Dix ans plus tôt, en 2011, Chantal Delsol avait publié L’âge du renoncement, aux éditions du Cerf. Rien à voir avec Le lys dans la vallée de Balzac, ou La fin d’une liaison de Graham Greene. Différents entretiens disponibles sur YouTube établissent l’importance, aux yeux de l’auteur, de cet essai très consistant. Trois cent pages d’un texte dense, où chaque ligne doit être lue au moins deux fois, pour n’en rien perdre. Cette lecture donne-t-elle accès à la pensée profonde de l’auteur ? Pour celle qui déclare à KTO que, sur une île déserte, c’est Fragment d’un Paradis de Jean Giono, qui lui suffirait, un besoin intime est concédé, celui d’un profond désir d’affranchissement. L’auteur rêve d’évoluer dans le monde platonicien des idées, où son aisance spéculative pourrait se déployer. Dans la Caverne, elle étouffe. Le prêt-à-penser ecclésial ne fut tolérable, et toléré, que par les petits, les obscurs, les sans grades. En pratique, l’élitisme d’une aristocratie pensante s’est vu consacré, en sa personne, par l’Institut de France. Derrière la consécration, le piège doré? Pour autant, le titre reste énigmatique. De quel âge s’agit-il ? Et à quoi faut-il renoncer ? Eh bien, il nous faudra chercher, sans l’assurance d’arriver au but. Serons-nous comme ces protagonistes des romans d’Henry James, astreints à voir sans comprendre, tant que l’aveu n’est pas formulé ?
Incontestablement, notre académicienne est fascinée par le monde antique. De l’ère païenne du monde méditerranéen, elle admire la religion immanente, dont les dieux habitent l’espace commun, et dont les rites unissent les habitants d’une même cité. Cet esthétisme la déconnecte du bien commun catholique. Elle-même est élevée dans l’Eglise, en milieu pratiquant, mais sans l‘empreinte maternelle et les convictions de son époux, cette appartenance catholique aurait bien pu s’appauvrir. En connivence avec son père, biologiste reconnu, maurrassien, agnostique, un positivisme de fait la conduit vers les joies philosophiques, celles qu’un talent d’intellection s’autorise sans rien devoir au clergé. Du même père, elle obtient de quitter l’excellente institution qu’elle pratiquait (Chevreul) pour ne pas faire sa classe de philosophie « avec une bonne sœur », et intégrer un lycée laïc. Cette complicité avec son père est-elle à l’œuvre dans ce conservatisme qui admire et protège l’œuvre sans partager l’âme de l’artisan ? Celui qui, acceptons-en l’augure, admirait l’Arche de Salut des sociétés sans croire au Ciel, à l’instar du Maitre de Martigues, a semé chez sa fille ainée la défiance des idéologies totalitaires, à bon escient. Est-il pour quelque chose dans cette ambivalence troublante vis-à-vis de la vérité, vénérée comme quête personnelle, repoussée quand elle vient de haut? Et quel maurrassien pourrait-il déclarer que « Renoncer à la Chrétienté n’est pas un sacrifice douloureux » ? Aristotélicienne christianisé, Chantal Delsol n’est pas thomiste pour autant. Chez elle, la philosophie ne s’accomplit pas dans le service de la théologie. Elle fait son miel du mouvement des idées, qu’elle commente avec verve. Mais restituer l’agitation d’un mouvement brownien est-il une fin digne de ses dons ?
Pas une matière à option
Le rôle fédérateur des rituels religieux païens a été magnifiquement restitué par Fustel de Coulanges dans La Cité antique. Ce chef d’œuvre, perpétuellement réédité depuis sa publication en 1864, se trouve être l’exact contemporain du Syllabus de Pie IX, autre chef d’œuvre assurément. Face au relevé des erreurs modernes défiant l’axiologie de la Chrétienté, le travail minutieux de l’historien, directeur de l’Ecole Normale Supérieure de la rue d’Ulm, montre les invariants qui, dans les cités païennes de l’antiquité, œuvrent à la pérennité du lien mutuel, par le partage des rites funéraires, des sacrifices aux repas « conviviaux », dans un esprit propitiatoire, c’est-à-dire pour apaiser les dieux tout autant que les âmes des défunts. C’est dire, et Fustel ne s’en prive pas, que l’observance de ces rites fédérateurs n’est pas une matière à option, tant la conviction dominante est que le bien commun en dépend. Occulter l’intraitable exigence du religieux païen serait falsifier l’Histoire, certes ; ce serait surtout renoncer à comprendre la cohésion puissante qui s’en nourrit. Mais Fustel montre bien que la Révélation périme le paradigme antique, en le dépassant par la puissance de sa vérité d’amplitude nouvelle.
Ce monde antique, qui reprend à son compte les pratiques des sociétés traditionnelles par voie cumulative, c’est-à-dire en intégrant et non en excluant les usages des cités alliées ou conquises, porte, pour Chantal Delsol, le souci prioritaire de la vie collective. Il n’a cure des énoncés d’une « vérité » plus ou moins nécessairement clivante. La « vérité » est crainte comme ayant l’effet d’un glaive (non sans raison, cf. Math. 10,34-36). Affirmer publiquement une foi précise, c’est se comporter en fauteur de conflit, de rupture et de mort. En effet, dans le monde circulaire, celui de l’éternel retour du chaos, quelle place pour une vérité spéculative, puisque celle-ci n’aura pas le pouvoir d’entraver la circularité inévitable de la destinée ? C’est, comme l’académicienne le précise fort à propos, le judéo-christianisme, et lui seul, qui porte, de la Promesse faite à Abraham jusqu’à l’Incarnation du Verbe de Dieu, la perspective d’un temps « fléché » qui rend concevable, et désirable, l’eschatologie conçue et préparée par Dieu, qui a soin de ses créatures.
Avec la laïcisation, c’est la notion de progrès qui revendique, par prétention, le temps fléché, et présume d’une croissance continue. Et les millénarismes totalitaires qui se font messianiques, ici des lendemains qui chantent, et là, de la paix en Europe pour mille ans, sont, en vrais prométhéens, les profanateurs effectifs de l’idée de vérité. Certes, le temps fléché de la Révélation ne supplantera jamais totalement le temps circulaire ici-bas, dont l’alternance du jour et de la nuit, le rythme des saisons, le cycle de la vie et de la mort, sont les illustrations les plus évidentes. Mais savoir que l’Histoire a un sens voulu par Dieu, et prétendre que ce sens est à la portée d’un démiurge auto-proclamé, ce n’est pas la même chose. Pourquoi Chantal Delsol met-elle la Chrétienté dans le même sac que les idéologies qui l’ont combattue, en vain ?
Delsol-Foucault, même combat ?
Le propos de Chantal Delsol est rendu déconcertant par la convergence qui la rapproche des déconstructeurs, qu’ils s’inspirent des Cyniques de l’Antiquité ou d’un Foucault contemporain. A force de dédramatiser l’apostasie générale, en refermant sans vergogne la parenthèse constantinienne, l’académicienne destine l’Eglise à la condition minoritaire, sanction de ses maladresses. Hier, la Rome impériale du Vatican, odieuse à Simone Weil ; demain, la thébaïde, le communautarisme des persistants, la marginalité des nostalgiques. L’Eglise n’a, à l’en croire, que ce qu’elle mérite, victime de son hybris.
L’invraisemblable lacune de cette mise en bière désaffectivée, c’est l’oubli du Salut des âmes, raison d’être de la civilisation animée par l’Eglise. Le Ciel n’est pas présent dans son discours. Il est tenu, semble-t-il, dans la même méfiance que l’autorité du vrai. L’élitisme d’une culture classique hors du commun, qu’elle conduise l’auteur à valoriser la mythologie des esprits cultivés, ou la sagesse stoïcienne d’un Epictète, d’un Sénèque, la porte à une vénération proche de l’idolâtrie. Laquelle ferme les yeux de l’académicienne sur l’empereur Marc Aurèle, de la même école, et persécuteur des chrétiens de son temps…Lorsqu’elle conspue l’alliance de l’Eglise avec les régimes d’autorité contre-révolutionnaires, on comprend que la mémoire de la terrible menace communiste, « oubliée » par Gaudium et Spes, manque étonnement à cette anti-communiste de toujours, dès lors en pleine contradiction avec elle-même, et se livrant à un révisionnisme historique que l’on n’attendait pas de sa part. Bref, pourquoi tant de haine contre l’Eglise, au prix de son propre discrédit… ?
Force est de constater que la Coupole de l’Institut tend, sous l’influence de Chantal Delsol, à devenir le balcon d’Epicure, celui d’où les dieux se divertissent des avanies humaines. Lesquelles paraissent étrangement désincarnées, par l’effet du régime d’abstraction au niveau duquel se trouve l’oxygène de l’essayiste. Si l’Eglise est dénigrée pour sa puissance d’hier, y compris celle qui ne devait guère à l’Etat qui l’avait dépossédée du bras séculier, mais beaucoup à son zèle et à sa cohérence, ainsi qu’à la Volonté Divine, qui donc orchestrait la contestation radicale dans les faits ? Sinon le camp d’en face, celui d’un Gambetta et son aphorisme fameux, « le cléricalisme, voilà l’ennemi » ? Le voir repris à son compte par le Pape argentin est, à vrai dire, si scandaleux que le renfort de l’académicienne à cette curée passerait presque inaperçu…
La Coupole, pour s’y attarder quelque peu, fut le 14 novembre 1966, le lieu d’une trahison. Non pas de la part de l’un de ses membres éminents, mais de la part de Mgr Pierre Haubtmann, oublié de nos jours, mais mandaté à l’époque pour instruire l’éminente société que représente l’Académie des Sciences Morales et Politiques. Corédacteur de Gaudium et Spes (la funeste « constitution pastorale l’Eglise dans le monde de ce temps », que 75 pères conciliaires eurent le courage de dénoncer, sur 2 309 !), Mgr Haubtmann, recteur de l’Institut Catholique de Paris, en donnait la primeur aux illustrissimi : L’Eglise se désengage de la politique, rompt avec le triomphalisme, et ne se reconnait plus d’ennemi. Le texte en est disponible sur La Documentation Catholique (DC2012, n° 2492/17 juin 2012, p.585/590). En clair, l’Eglise du Christ n’a pas été vaincue, elle s’est rendue au monde, selon le mot exact de Maurice Clavel.
Un monde imaginaire
La fin de la Chrétienté n’est pas la lente, mais inexorable agonie que décrit Chantal Delsol. La Chrétienté, encore bien vivace jusqu’en 1960 comme en atteste l’historien Guillaume Cuchet, a été sabordée méthodiquement par le haut-clergé. Sous couvert d’un « esprit du Concile » dont les lutrins, à défaut des chaires désaffectées, nous rebattaient les oreilles. C’est l’honneur du philosophe catholique Jean Luc Marion, invité aux Bernardins, en 2012, pour le cinquantenaire de l’ouverture du concile, d’avoir fait à cette occasion une intervention décisive dont l’accueil glacial confirma le courage. Il affirmait, et ce faisant confirmait les propos antérieurs d’autres commentateurs moins en cour, que, résolue à s’adresser au « monde de ce temps », l’assemblée conciliaire avait forgé un monde imaginaire, sans rapport avec la réalité. Un interlocuteur fictif. Une superstructure trompeuse, pourrait-on ajouter. Un amphithéâtre Potemkine. La méprise fut fatale aux ambitions affichées, mais le déni en perdure inlassablement.
En 2022, le fléau qui reste à dénoncer sans ambages, c’est ce funeste concile Vatican II qui, sous des dehors pacifiques, et des rappels judicieux, recèle un poison mortel pour l’Eglise. La formule chimique de ce poison divise les chercheurs, mais, à sa façon, l’académicienne porte pierre à la critique constructive : et si Vatican II, cherchant la paix et, pour ce faire, dévaluant la vérité, avait rompu, quoique trop tard, avec son canal historique, faisant dès lors un sacrifice tout aussi fatal qu’inutile ? En somme, c’était bien vu, mais trop tardif, selon elle. Cette consomption ecclésiale, effet d’une erreur de gouvernance, réconcilierait, une fois n’est pas coutume, le temps circulaire de la fin d’un monde, et le temps fléché d’une sanction historique inéluctable. Or le terme d’erreur, dans sa mansuétude, masque le reniement, et dévie le sens de l’observable. En renonçant à porter l’Autorité du Verbe Incarné, l’Eglise dérogeait spirituellement, et, en perdant sa colonne vertébrale, assistait sans réagir à sa dévitalisation. Toutefois ses ruines désarmées forceraient sans doute, selon l’académicienne, la clémence du Monde, concédant à l’organisme brisé un sursis à exécution…En toute hypothèse, dans ce paganisme 2.0, qui donnera le ton ? Les dogmes ulcéraient les esprits forts, soit, mais les mythes n’ont pas besoin de clergé. Quant à la sagesse, pour un Socrate, combien de sophistes ?
Chaque contemporain du concile (1962/1965) peut se souvenir que la lettre recueillie dans les Actes était largement éclipsée, tant en diffusion qu’en impact, par « l’esprit du concile ». Il fallait adhérer sans rechigner, à la façon d’un enfant, car l’adhésion à l’esprit nouveau ouvrait les mentalités aux perspectives nouvelles, alors que toute réticence attestait d’un cœur sec. Tenter d’opposer la lettre du concile à la tempête enfiévrée de l’esprit incontrôlable, c’était montrer son incompréhension du nouveau paradigme, selon lequel Vatican II revendiquait de faire toute chose nouvelle sous la houlette de l’esprit nouveau.
Sur ce point, rien n’a véritablement changé concernant cette prétention perpétuellement démentie. Nonobstant le fiasco, le concile reste un bloc. On le reçoit comme tel, ou l’on endure la mort sociale au sein des diocèses. Le concile se veut, pour l’Eglise, incarner l’évènement totémique, celui qui donne la vie nouvelle. Par corollaire, un intraitable tabou interdit d’en flétrir la moindre composante. Sur ce point, la Rome postconciliaire est aussi rigide qu’une cité antique ou qu’une société primitive, à ceci près qu’un Polyeucte briseur d’idoles au nom du Christ, et martyr de l’Empereur, est aujourd’hui ostracisé par ses frères proches, au nom des frères lointains éventuels qu’il pourrait incommoder. Vatican II a créé une guerre froide dans l’Eglise, fratricide qui plus est. L’extravagante régression intellectuelle de ce totem imposé à l’Eglise par ses hiérarques, et à rebours de son Histoire, n’a sans doute pas échappé à Chantal Delsol. Mais nous formons l’hypothèse que l’effondrement subséquent n’a fait qu’amplifier un « vae victis » de sa part pour l’imposture intellectuelle protégée par les gardiens du Temple. Quand l’adversaire se saborde, il n’est pas requis de lui porter secours avant d’avoir acté sa capitulation.
Deux amours ont bâti deux cités
Dix ans avant La fin de la Chrétienté, L’âge du renoncement, par un florilège d’arguments ciselés, l’académicienne se résignait, non sans mal, à devoir choisir entre deux mondes :
« Nous abandonnons l’idée de vérité pour rejoindre le monde des croyances non exclusives et des syncrétismes. Pourtant, nous n’abandonnons pas l’universalisme qui présuppose la vérité : nous voudrions par exemple que les droits de l’homme, de vérités devenus mythes, conservent cependant leur caractère exclusif et universel, ce qui est contradictoire dans les termes. (…) Nous vivons aujourd’hui grâce aux bienfaits d’un monde que nous sommes en train d’invalider. Nous nous tenons dans une situation intermédiaire d’où la lucidité est absente. La période contemporaine est très confortable parce que nous sommes situés (…) entre deux paradigmes et profitons de façon incohérente des avantages de l’un et de l’autre, ce qui ne saurait durer bien longtemps » (p.294). L’auteur poursuit « Un choix, une option, se décide aujourd’hui en faveur de la sagesse des hommes et au détriment de la folie de Dieu » (p.295).
Non, chère Chantal Delsol, pas seulement aujourd’hui. Saint Augustin, que vous admirez, certes moins qu’Aristote, avait, dès l’Antiquité tardive, exposé magistralement, dans La Cité de Dieu, l’antagonisme permanent des deux cités : « deux amours ont donc bâti deux cités, l’amour de soi jusqu’au mépris de Dieu, la cité de la terre ; l’amour de Dieu jusqu’au mépris de soi, la cité de Dieu ». Il y a 10 ans, le choix était encore si douloureux que vous tentiez une voie tierce, que l’on qualifiera de gnostique ou de romantique selon l’humeur :
« On a envie de comprendre avec indulgence les sociétés fatiguées par les excès de la vérité. Pourtant, les fous de la vérité sont peut-être les dépositaires d’une autre âme du monde, dont ils veillent la lueur captive » (p.295).
Dix ans plus tard, votre choix est fait, avec La fin de la Chrétienté, dont la tranquille assurance vous éloigne tragiquement de la fidélité catholique, sans vous chasser, bien au contraire, du pinacle des honneurs.
Au-delà d’un cheminement individuel, aussi élégant et attristant qu’il soit, subsiste en surplomb le grand interdit: pourquoi la responsabilité du haut clergé dans la mise à mort de la Chrétienté est-elle toujours inabordable ? Est-ce parce que le bilan est désastreux et que personne ne le revendique ? Chantal Delsol abonde, hélas, la doxa trompeuse, à savoir que le Monde a vaincu l’Eglise. Et s’autorise, au nom du vainqueur, à se montrer apaisante quant au pronostic de la condition minoritaire à laquelle l’Eglise vaincue doit, selon elle, se résoudre : « Mais l’Eglise privée de son pouvoir temporel et civilisationnel ne sera pas pour autant empêchée de vivre » (p.156). Madame l’académicienne est trop aimable ! Mais qu’en sait-elle, de cette portion congrue, voire de cette dhimmitude abstraite, alors qu’elle ne mentionne pas une seule fois l’Islam conquérant d’aujourd’hui !
Jugez-en : « La mission doit-elle être forcément synonyme de conquête ? On peut penser le christianisme sur le modèle des moines de Tibhirine plutôt que sur celui de Sepulveda (l’inquisiteur…aristotélicien) » (p.170). De profundis. On vous aura prévenu…
Cet article est une version abrégée d’un texte disponible sur le site de la revue Catholica, laquelle offre en complèment une analyse ancienne d’un autre livre de Chantal Delsol, confirmant ainsi la continuité de sa pensée sur le sujet abordé dans La fin de la Chrétienté.