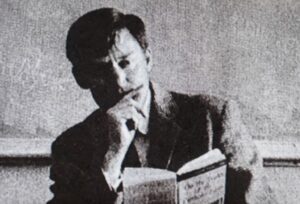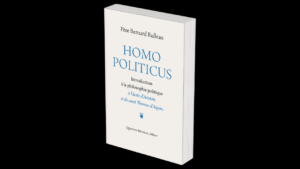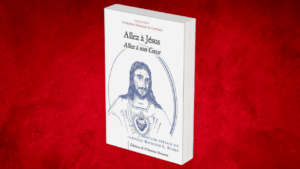Sous le titre-programme Russie d’hier et d’aujourd’hui. Perceptions croisées, le livre dirigé par Anne Pinot et Christophe Réveillard dévide un fil conducteur à travers la Russie de toujours, son âme intacte, sa culture authentique. Un va-et-vient avec la France sur les plans historique, politique et littéraire permet de mieux appréhender une Russie aujourd’hui trop décriée et qui a pourtant renoué avec le sacré.
Vous avez dirigé un ouvrgae consacré à la Russie. Pourquoi ce pays ?
Christophe Réveillard : À partir de questions que tout le monde se pose sur ce grand pays eurasien, nous avons voulu évoquer la Russie à la fois dans la perspective du temps long, civilisationnel, de sa naissance jusqu’à aujourd’hui (et demain), et en même temps à travers le prisme pluridisciplinaire, la géopolitique, l’histoire, les sciences politiques, la littérature, la religion. La démarche nous semblait s’imposer au regard de la désinformation ambiante sur la Russie dans notre pays. Enfin, nous avons souhaité un regard croisé franco-russe sur la relation entre les deux « extrémités » nationales de l’Europe en faisant intervenir des auteurs russes proches de la culture française.
Qu’est-ce que la « Sainte Russie » ?

La belle préface de Jean-Louis Backès (« doulce France et Sainte Russie ») souligne assez la difficulté de répondre à ces questions. Cette « Sainte Russie » est l’objet d’appréciations contradictoires, trop souvent sans doute fondées sur une vision teintée tantôt d’idolâtrie, tantôt de mépris, l’un et l’autre excessifs et partisans. Il faut revenir simplement à l’Histoire, comme il semble plus facile de le faire depuis que l’opposition schématique Russie impériale-Russie soviétique tend à s’estomper. Le français ne peut pas traduire sans la trahir la formule russe, c’est pourquoi nous ne percevons pas qu’elle renvoie à une Russie qui n’est ni celle d’aujourd’hui, ni même celle d’hier, mais une Russie immémoriale, et, partant, presque mythique : la Russie chrétienne qui se développe dans l’héritage de Byzance, entre la fin du Xe siècle et le début du XVIIIe et qui demeure le « berceau » de la Russie moderne. Quant à l’« âme russe », au-delà des clichés, intuitions parfois justes définissant l’âme russe comme une certaine inclination à vivre « à l’affectif » plutôt que « raisonnablement » – avec tous les excès que cela entraîne dans les relations humaines et sociales –, elle est intimement liée aux spécificités géographiques et historiques de la Russie, au sentiment paradoxal de vivre dans un pays puissant et fragile, qui attache viscéralement les Russes à leur « patrie-matrie » (comment traduire le mot rodina ?) comme à une partie d’eux-mêmes, en même temps qu’ils nourrissent une espèce d’amour universel et un détachement des choses quotidiennes à peu près indéchiffrables pour nous.
L’eurasisme russe est-il un rejet de l’Europe ?
En 1913, le Russie atteint sa plus grande expansion territoriale : 21 millions de km2, 166 millions d’habitants (aujourd’hui 17,5 millions de km2 et 141 millions d’habitants). Alors l’Eurasie est-elle l’addition des deux continents, un troisième monde à part, le heartland des géopoliticiens (Pascal Gauchon) ? Pierre le Grand indique le premier que la frontière entre Europe et Asie se situe sur l’Oural par tropisme européen en déplaçant sa capitale à Saint-Pétersbourg. Mais nous voyons bien en quoi cette distinction est imprécise et que tout au long de son Histoire récente, les élites russes ont discuté de stratégies mouvantes (eurasisme, européisme), les adoptant et les abandonnant tour à tour, au sein d’une géopolitique russe immuable. Y correspondre en respectant l’équilibre fondateur du pays est la tâche des hommes d’État, tsar comme président, qui savent être jugés à cette aune.
Que reste-t-il de la révolution russe, fille de celle de 1789 ?
L’homo sovieticus – l’œuvre de Soljenitsyne, le décrit assez pour que l’on sache tout ce qu’il doit à la Révolution française – est l’incarnation russe de la soumission volontaire mais inconsciente au totalitarisme issu de la machine terroriste. Que quelques hommes comme Soljenitsyne défient la peur et le système vacille. Contrairement à ce que l’on essaie de nous faire croire, il n’y a plus d’homo sovieticus en Russie.
Le renouveau conservateur russe est-il réel ?
Le retour à la tradition est réel, revendiqué et appuyé sur une réappropriation d’auteurs et de penseurs russes. Il est à la fois politique, culturel et religieux, le refus d’un monde unipolaire et le rejet de la décadence de la démocratie à l’occidentale, le retour du sacré. Il concerne la France non seulement parce qu’il est temps que nous nous questionnions sur notre attentisme atlantique, mais aussi parce que l’exemple russe nous oblige à nous interroger sur nous-mêmes sans que nous soyons traités pour autant de « poutinolâtres ». Sans succomber à la tentation d’une vérité qui se confonde avec l’autorité, c’est peut-être au bon usage de la liberté que nous devons réfléchir.
Sous la dir. d’Anne Pinot et de Christophe Réveillard, Russie d’hier et d’aujourd’hui, Éditions S.P.M., 322 p., 30 €.