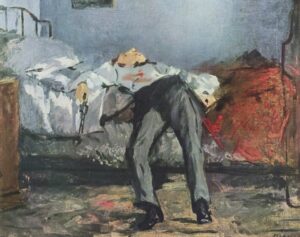À lire le pamphlet d’Erwan Le Morhedec (Identitaire, le mauvais génie du christianisme, Éd. du Cerf, 176 p., 14 e), on le croirait davantage procureur tant le ton est au réquisitoire. Le lecteur le sent indigné et en colère ; à moins que cela ne soit un mélange de peur et de honte. Passons sur les erreurs factuelles (le « spécialiste de Clovis » que serait « Henri Rouche », ou encore le général Cambronne renommé Camerone !) et les approximations et les contresens, malheureusement habituels dans ce genre littéraire, sur le paganisme de Maurras ou encore son « politique d’abord ».
Erwan Le Morhedec s’interroge : « Quel ressort peut inciter quelqu’un qui ne pratique ni régulièrement ni même occasionnellement à s’affirmer catholique quand on ne le retrouve qu’aux Rameaux pour le renouvellement de son buis ? ». Notre blogueur, qui manifestement a accès au for interne de certains de ses compatriotes, condamne ce qui lui apparaît être une instrumentalisation malhonnête de la foi chrétienne. Et il considère qu’il est de son devoir, d’une part, de dénoncer les fidèles qui acceptent avec complaisance, voire machiavélisme, cette réduction de la foi et, d’autre part, de mettre en garde les autres, naïfs, qui risqueraient de se faire manipuler par les premiers. Cela ne l’empêche pas de prêcher dans son dernier chapitre sur la nécessaire ouverture à tous et de faire l’éloge de la désormais célèbre posture de l’« Église en sortie » qui n’a pas à être une « douane ». Comprenne qui pourra.

Cet essai est-il donc à négliger ? Non, et pour deux raisons. Tout d’abord, parce qu’il pointe un réel problème, à savoir le danger d’une reprise non-critique du vocabulaire postmoderne de l’identité et donc de ses présupposés erronés ; et parce qu’il illustre à merveille une tentation inverse, que l’on peut nommer « dévote ». En critiquant à juste titre certains dangers de l’attitude identitaire, il néglige les causes ayant conduit à celle-ci et ce qu’elles manifestent en creux : la nécessaire prise en compte par la vie chrétienne de ces deux réalités naturelles que sont la famille et la nation. Il est donc à craindre que ce surnaturalisme ne fasse que renforcer le naturalisme qu’il critique. Or le défi central nous semble être d’articuler, dans le contexte actuel, effectivement très tendu, nature et grâce, foi et raison, selon le principe de Chalcédoine sur les deux natures du Christ « unies sans séparation ni confusion ».
Épidémie de phobies
Erwan Le Morhedec a raison de pointer « le caractère profondément mimétique de la dynamique identitaire ». La politique de la reconnaissance (Charles Taylor, Multiculturalisme. Différence et démocratie, Flammarion, coll. « Champs-Essai », 160 p., 8,20 €), importée d’Amérique du Nord, a transformé, dans les dernières décennies, les rapports que les citoyens entretiennent avec la chose commune. Dans ce nouveau régime mental, comme l’ont bien montré Marcel Gauchet (La Religion dans la démocratie, notamment p. 141-151, Gallimard, coll. « Folio Essais », 2002, 192 p., 5,90 €) et Pierre Manent, le discours de l’identité tend à réduire les croyances et les styles de vie à des critères de différenciation, percevant l’espace public comme vecteur de revendications propres. D’où l’actuelle épidémie de « phobies » (concurrence victimaire), qui n’est que l’envers de cette multiplication des identités, toute critique étant immédiatement vécue comme une discrimination. Comme le dit Pierre Manent « le langage de l’identité rend l’homme en quelque sorte propriétaire de son humanité. De ma propriété, je fais ce que je veux, et de cet usage je n’ai pas à rendre compte. Quand je suis sur ma propriété, on n’a pas à me demander mes raisons ». (Albert Jacquard, Pierre Manent, Alain Renaut, Une éducation sans autorité, ni sanction ?, p. 29, Grasset, 2003, 96 p., 9,90 €) Ainsi ce qui est le plus commun, mon humanité, ses capacités et ses aspirations, devient ce qui est le plus privé. En reprenant sans discernement cette posture, certains catholiques risquent de valider à leur insu cette fragmentation du commun, que ce soit le bien commun de la société ou la vérité à laquelle aspire tout être humain.
Des présupposés partiels
Cependant la mise en évidence de ces limites voire de ces dangers repose sur des présupposés eux-mêmes partiels et insuffisants. Erwan Le Morherec ne prend pas assez en compte le contexte historique dans lequel s’est développé le phénomène qu’il critique. La brutalisation du mariage par la loi Taubira a été l’occasion d’une prise de conscience par nombre de nos compatriotes de la pertinence du discours de l’Église sur l’ordre naturel familial ; et les attentats islamistes et la désastreuse « politique migratoire » de l’Union européenne d’une prise de conscience renouvelée de la réalité nationale, dans sa dimension culturelle, et donc religieuse. À la suite des pontificats de saint Jean-Paul II et de Benoît XVI, les catholiques français disposent d’un riche enseignement sur lequel ils se sont appuyés pour promouvoir le bien commun avec d’autres compatriotes, « catholiques zombies » et néo-païens fraîchement convertis (ou pas). Le fait qu’il y ait eu des maladresses légitime-t-il une suspicion de type complotiste condamnant un soi-disant entrisme animé de noirs desseins ? Surtout si une telle critique réitère ce qui justement alimente le ressentiment de certains.
Ainsi quand notre auteur déclare « qu’un pays en lui-même puisse être chrétien paraît aussi faux d’un point de vue spirituel que culturel », il annule par là des pans entiers de la réflexion de Jean-Paul II sur les patries, leur âme et le dessein divin sur elles ; et avant lui tous les papes qui ont voulu finement sortir les catholiques du nationalisme réducteur. Ou encore lorsqu’il reprend sans aucun recul critique la vulgate « droitdelhommisme » ou les poncifs habituels sur l’Église « constantinienne » et la royauté sociale de Jésus-Christ. Ce surnaturalisme n’est que le pendant du naturalisme, réel ou imaginaire, qu’il condamne. Souhaitons donc que les catholiques français ne succombent pas à la tentation dévote que Péguy a si admirablement caractérisée : « Parce qu’ils n’ont pas la force (et la grâce) d’être de la nature ils croient qu’ils sont de la grâce. Parce qu’ils n’ont pas le courage temporel ils croient qu’ils sont entrés dans la pénétration de l’éternel. Parce qu’ils n’ont pas le courage d’être du monde ils croient qu’ils sont de Dieu. » (Note conjointe sur la philosophie de Monsieur Descartes et la philosophie cartésienne, 1914).
Voir sur ce sujet l’éditorial de Philippe Maxence.