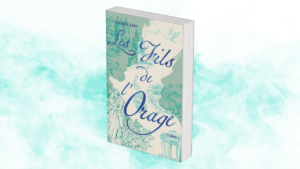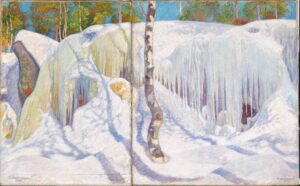Vaincre ou Mourir, le film qui raconte l’histoire du général Charette pendant les guerres de Vendée rencontre une opposition étonnamment unanime des critiques, de la presse et de certains politiques, alors que le public fait son succès. Pourquoi ? Reynald Secher, historien, docteur ès lettres (Paris IV Sorbonne), spécialiste de la résistance au totalitarisme, qui en fait l’introduction, revient sur ce phénomène.
| Le premier film du Puy du Fou, Vaincre ou mourir, montre sur grand écran le drame vécu par la Vendée au moment de la Révolution française. Vous êtes la première personne à apparaître dans ce film, à quel titre y avez-vous participé ?
À l’origine, le film devait être un « docudrame », c’est-à-dire que le réalisateur, Nicolas de Villiers, avait retenu une dizaine d’historiens de toutes tendances pour parler de la guerre de Vendée à travers un de ses héros : Charette. Mais le groupe Bolloré, en voyant la qualité des images tournées, s’est dit qu’il fallait aller plus loin et réaliser un film, ce que Nicolas de Villiers a fait. Cependant le réalisateur s’est rendu compte que pour le grand public, il était difficile de rentrer immédiatement dans le film, d’où la nécessité de proposer une introduction avec quatre historiens, qui expliquent en quelques mots ce qu’est la Révolution française, ce qu’est la Vendée et qui est Charette.
| Quelles sont la part d’histoire et la part de fiction dans ce film ?
Vaincre ou mourir compte trois dimensions : la première est la macro-histoire, qui se traduit par des dates et des événements collectifs, ou qui ont eu des répercussions, et qui concernent tout le monde. Par exemple l’exécution du roi, la conscription, les lois d’anéantissement et d’extermination, le traité de paix de la Jaunaye, la reprise de la guerre.
La deuxième dimension, puisqu’il s’agit de raconter l’histoire de Charette, c’est le récit de sa vie, entre le moment où il décide d’entrer dans la rébellion et son exécution sur la place Viarme.
Enfin, la troisième dimension, qui est liée aux deux autres, c’est la réaction de l’État, qui fait que l’on passe d’une simple guerre civile à un système d’extermination et d’anéantissement, puis…