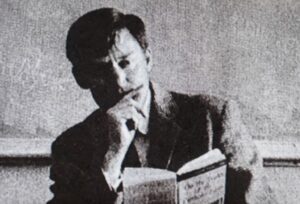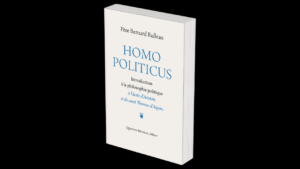Dans un ouvrage intitulé Les Colonnes infernales : violences et guerre civile en Vendée militaire (1794-1795), un professeur de l’Université catholique de l’Ouest récuse sans état d’âme le terme de génocide et témoigne d’une sympathie douteuse envers les troupes révolutionnaires. Analyse.
L’étude qu’Anne Rolland-Boulestreau, professeur à l’Université catholique de l’Ouest, consacre aux Colonnes infernales laisse le lecteur sur une curieuse impression. L’on se demande presque, à la lire, si la Vendée, en 1794, fut vraiment victime de crimes de guerre à grande échelle…
Rappelons d’abord les faits, ce que l’auteur omet, s’adressant à un cénacle de spécialistes.
Insurgée en mars 1793 contre le pouvoir révolutionnaire, la Vendée militaire, appellation qui couvre un territoire dépassant de beaucoup le département homonyme, après une série de victoires jugée déconcertante à Paris, subit, le 17 octobre 1793 devant Cholet une défaite d’une telle ampleur qu’elle contraint l’armée catholique et royale à passer la Loire. À la fin de « la virée de galerne », le 23 décembre 1793, la Vendée, écrasée à Savenay, ne représente plus une menace militaire. Il suffirait de laisser les survivants en paix pour éteindre la guerre civile.
Le plan d’extermination
Pourtant, le 17 janvier 1794, le général Turreau, avec l’appui tacite du Comité de Salut public, met en œuvre le plan d’extermination qu’il a imaginé : « douze colonnes mobiles », onze en réalité, arpenteront le pays insurgé d’est en ouest et du nord au sud avec pour consignes de tout détruire et tuer sur leur passage. Les ordres précisent que ni les civils, ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards, ni même les animaux ne doivent être épargnés. Jusqu’à la fin de l’été, avec plus ou moins de succès et en variant les méthodes, ce dispositif sera mis en œuvre.
De l’aveu d’Anne Rolland-Boulestreau, qui se perd dans ses calculs, l’on ne saura jamais combien de « Brigands », appellation générique confondant combattants et civils, ont péri pendant cette période. Elle ne dit pas non plus dans quelles circonstances, qui passent souvent l’imagination. C’est que s’arrêter aux victimes, disserter sur leur nombre ou les tortures indicibles qu’elles endurèrent risque de faire soupçonner un historien de sympathies envers une cause vendéenne assimilable à…