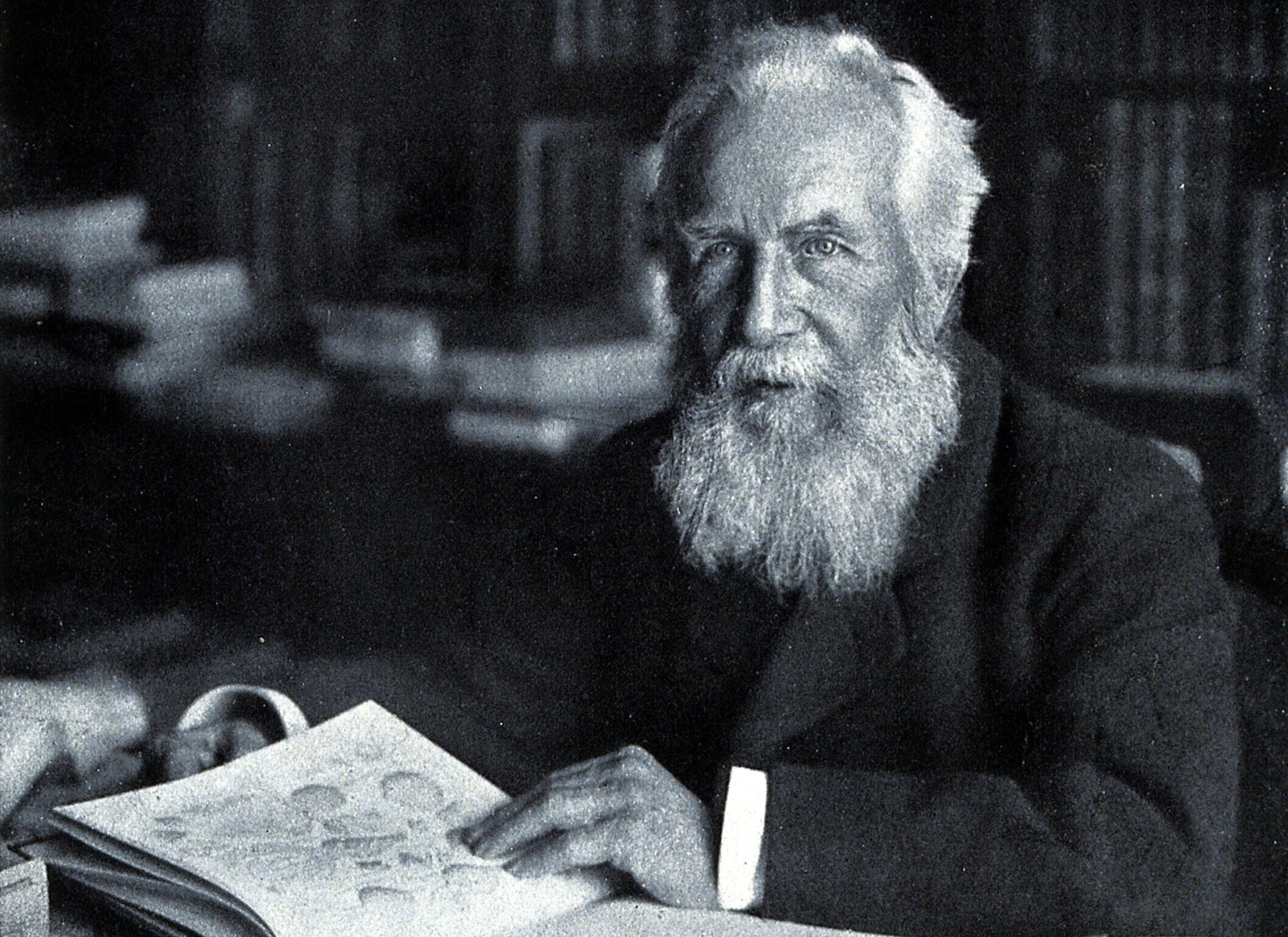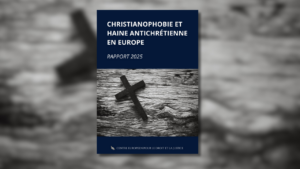> L’Essentiel de Joël Hautebert
Depuis le XIXᵉ siècle, l’organicisme naturaliste assimile la société à un corps soumis à des lois biologiques. Ce glissement matérialiste bouleverse la conception de l’État, la place de l’homme dans la nature et l’identité collective, au risque d’effacer liberté, morale et spiritualité.
Les recours aux comparaisons entre l’animal et l’homme, le corps humain et la communauté politique sont des constantes depuis l’Antiquité. Par le moyen de métaphores ou d’analogies, elles offrent au raisonnement une première approche, limitée, en vue de parvenir à la définition d’une communauté humaine. L’Église elle-même ne se définit-elle pas comme le corps mystique du Christ ? Ce procédé fort utile n’implique en aucun cas une identification entre la nature physique et ce qui relève du domaine politique, moral et spirituel. Cette manière classique d’opérer des comparaisons est rejetée par le naturalisme et l’organicisme matérialiste du XIXᵉ siècle. Le socialiste révolutionnaire Georges Sorel écrit en 1895 que « jadis, ce que la science cherchait était la détermination de l’espèce [c’est-à-dire la nature propre de chaque être]. Que vaut cette construction dans la science moderne ? Ce que peut valoir une formule de langage (…), c’est-à-dire ce que vaut une métaphore à l’usage des gens du monde » (1). Eh bien oui, ce ne sont essentiellement que des formules de langage et des métaphores autorisant l’usage dans un sens impropre d’un terme qui définit une chose pour approcher de la connaissance d’une autre, parce qu’il existe des similitudes. Approcher seulement !
Des conséquences concrètes
Doué d’un libre arbitre, l’homme n’est pas un animal comme les autres et le fonctionnement de la cité ne suit pas les lois biologiques du vivant. Pie XII a jugé bon d’insister à plusieurs reprises sur les limites de ces comparaisons, dans l’encyclique sur le corps mystique du Christ (2) et dans plusieurs discours au sujet de la communauté politique. Cette question théorique a des conséquences politiques très concrètes pour notre temps, parmi lesquelles nous nous intéressons en particulier à la conception de la communauté politique du rôle de l’État, à l’écologie et à la relation entre l’homme et la nature et à la question de l’identité. La conception purement organique de la cité fausse le principe de totalité (3). Assimiler la société à un tout soumis à des lois biologiques n’accorde aucune autonomie aux membres du corps social. Or, comme l’explique Pie XII dans…