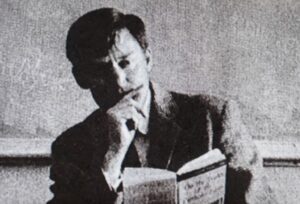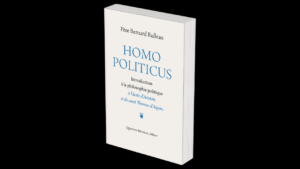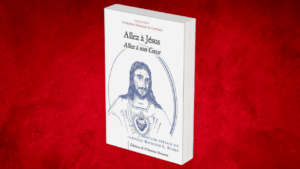Personne ne le conteste : le Pape François est un politique génial. Le document final de l’assemblée du Synode sur l’Amazonie le montre une fois encore.
Tout le monde attendait que le document demande simpliciter que soit désormais possible l’ordination sacerdotale d’hommes mûrs et éprouvés, des viri probati. Il n’en est rien, du moins apparemment : comme si les critiques très fortes venues de toute part avaient été entendues, l’assemblée, guidée d’une main sûre, ne s’est pas engagée en ce sens.
Elargissement
En revanche, elle propose, au n. 111 du document, l’ordination sacerdotale de diacres permanents, éventuellement mariés : il est demandé que l’autorité compétente établisse des critères pour ordonner prêtres des « hommes idoines et reconnus par la communauté, qui exercent un diaconat permanent fécond », lesquels pourront avoir une « famille stable légitimement établie ». Lucarne fort astucieuse par laquelle va pouvoir passer l’ordination des prêtres mariés, sans en avoir trop l’air.
On pourra même se prévaloir du fait que l’on se calque sur la discipline des Eglises orientales, qui font du diaconat une sorte de cliquet : les candidats au sacerdoce qui entendent se marier doivent l’être avant le diaconat, sinon, ils seront tenus au célibat sacerdotal.
Mesure « libératrice »
Ainsi donc, on pourra désormais ordonner prêtres ces presque prêtres que sont les diacres mariés. Et pour accéder au sacerdoce, les candidats mariés pourront d’abord être ordonnés diacres « permanents ». L’étape du diaconat étant au reste une obligation disciplinaire rigoureuse.
Du coup, la mesure « libératrice » n’aura aucun mal à devenir universelle. On devine que les évêques de nos régions, aussi pauvres en prêtres que l’Amazonie, à Langres, à Rodez, à Auch, ne vont pas tarder à demander à pouvoir ordonner prêtres leurs diacres permanents. Le célibat sacerdotal à l’imitation du Christ, gloire ascétique de l’Eglise romaine, aura vécu.
* L’abbé Claude Barthe dirige la lettre mensuelle internationale (français, anglais et italien)d’analyse et de prospective Res Novae, proposée en version papier et en version numérique.
Pour s’abonner à la version papier de Res Novae, il suffit de cliquer ici.
Pour s’abonner à la version numérique de Res Novae, il suffit de cliquer là.