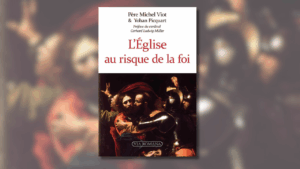>> Tribune libre du Père Louis-Marie de Blignières
Depuis l’arrivée de Marcel Clément à L’Homme Nouveau, Marthe Robin a été associée aux destinées de notre publication. De nombreux lecteurs se sont rendus à Châteauneuf-de-Galaure et un grand nombre des personnes des équipes successives qui ont réalisé au jour le jour L’Homme Nouveau ont été confortées dans leur foi et leur vie spirituelle par Marthe et les Foyers de Charité. Marthe Robin a été reconnue vénérable par le pape François en 2014 et le processus vers sa béatification est toujours en cours. Cependant, plusieurs ouvrages, émanant de spécialistes de la mystique, comme Joachim Bouflet et le père Conrad De Meester, ont mis sérieusement en question les aspects mystiques liés à Marthe Robin.
Le père de Blignières avait été alerté il y a cinquante ans par des aspects discutables de la prédication du chanoine Finet à Châteauneuf-de-Galaure et par la caution que lui apportait Marthe Robin. Reconnaissant le bien qui s’est fait dans les Foyers de charité, il revient ici sur ce cas à l’occasion des rebondissements récents. Il le fait afin d’encourager le mouvement qui se dessine, favorisant des « clés de discernement pour l’avenir » dans le traitement des phénomènes réputés extraordinaires.
Le 7 novembre 2014, le pape François autorise la promulgation du décret reconnaissant l’« héroïcité des vertus » de Marthe Robin. Depuis cette date, de nombreuses révélations ont remis en cause l’image de Marthe. L’on ne saurait leur opposer « l’autorité de la chose jugée ». Il y a des précédents historiques d’interruption, après la découverte de nouveaux éléments, du processus de béatification qui suit la reconnaissance de l’héroïcité des vertus : en 2005, le père Dehon, fondateur de la congrégation des Prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Saint-Quentin ; en 2020, le père Kentenich, fondateur du Mouvement de Schoenstatt.
Une grande influence
Marthe était considérée, dans de larges secteurs de l’Église, comme une stigmatisée authentique et une vraie mystique. Son influence a été grande sur une part du catholicisme, surtout en France. Parallèlement, une partie des catholiques s’interrogeaient sur l’orthodoxie de la doctrine enseignée à Châteauneuf-de-Galaure par le chanoine Finet : absence de la prédication du salut éternel et de l’enfer, tendances quiétistes, définitions équivoques de l’amour et du péché, présentation du respect des commandements comme signe d’un légalisme, expressions équivoques pour désigner l’Eucharistie, apologie de la modernité et critique de ce que l’Église a fait depuis le concile de Trente…
Ces articles pourraient vous intéresser :
Les « phénomènes extraordinaires » de Marthe étaient censés être une caution de sa prédication. On s’étonnait de l’absence de vérification médicale et d’expertise canonique sur ce cas. Une disproportion existait entre l’aura de Marthe et un manque persistant de vérifications incontestables. Les signes de crédibilité sur la réalité des « phénomènes » n’étaient pas établis, mais une large adhésion à Marthe Robin et à Châteauneuf-de-Galaure se développait en certains milieux catholiques.
« Depuis huit ans, une évolution remet en cause le discours hagiographique concernant Marthe. »
Remise en cause
Depuis huit ans, une évolution remet en cause le discours hagiographique concernant Marthe, tant pour la réalité des « phénomènes » que pour l’orthodoxie de sa doctrine. Des études et des révélations ont soulevé de graves problèmes à son propos ou au sujet des Foyers de charité, et ont diminué la crédibilité de leurs défenseurs.
En octobre 2017, le père Bernard Peyrous, postulateur de la cause de béatification de Marthe (à qui il attribue l’origine de sa vocation), est mis en examen pour « gestes gravement inappropriés de sa part vis-à-vis d’une femme majeure ». Il est démis de ses fonctions au sein de la postulation. Le 25 avril 2024, le père Peyrous sera mis en examen par un juge d’instruction du tribunal de Tours, pour « viol et agression sexuelle par personne abusant de son autorité ».
Le 7 mai 2020, a lieu la sortie d’un rapport qui indique que treize membres des Foyers de charité, prêtres ou laïcs, ont fait l’objet d’accusations d’abus sexuels, dont le chanoine Georges Finet, cofondateur avec Marthe des Foyers de charité en 1936, concernant pour ce dernier 26 femmes quand elles étaient adolescentes.
Le 8 octobre 2020, paraît le livre La Fraude mystique de Marthe Robin, du père Conrad De Meester, qui estime que Marthe est une plagiaire et une faussaire mystique. Le père De Meester est un spécialiste des mystiques féminines. Sa compétence théologique et sa rigueur scientifique sont reconnues. Les arguments développés par le père De Meester n’ont pas tous la même force ni le même degré de certitude. Cependant l’enquête factuelle qu’il a menée est difficilement contestable.
Le père De Meester établit de façon indiscutable que Marthe a plagié notamment les écrits de Marie-Antoinette de Geuser et des saintes Véronique Giuliani et Gemma Galgani. Il prouve que Marthe écrivait elle-même, sous différentes écritures, les textes qu’elle était censée dicter à des secrétaires. Le livre du père De Meester suscitera diverses réponses, dont certaines très passionnées.
Le rôle de caution de Marthe
Le 24 mars 2021, sort le livre La Trahison des pères de Céline Hoyeau. Elle s’interroge sur le rôle de caution que joua Marthe pour huit fondateurs, qui furent des auteurs d’abus spirituels et sexuels :
Jean Vanier et le père Thomas Philippe, fondateurs de l’Arche ; le père Marie-Dominique Philippe, fondateur de la Congrégation Saint-Jean ; sœur Alix Parmentier, fondatrice des Sœurs contemplative de Saint-Jean ; sœur Myriam Szentes, fondatrice des Petites Sœurs de la Compassion, d’Israël et de Saint-Jean ; frère Ephraïm, fondateur des Béatitudes ; le père Marie-Pierre Faye, supérieur de la Fraternité de Marie, Reine Immaculée ; Olivier Fenoy, fondateur de l’Office culturel de Cluny.
Une maladie mentale ?
Le 27 mai 2021, paraît le livre Marthe Robin. Le verdict, de Joachim Bouflet. Il explique le cas de Marthe par une maladie mentale. À la suite d’une encéphalite, elle aurait développé en elle (sans que sa bonne foi soit en cause) des personnalités différentes. Bouflet a étudié le cas d’une baptiste américaine, Mollie Fancher, présentant à la suite d’une encéphalite des personnalités multiples ainsi que nombre de phénomènes étonnants, semblables à ceux de Marthe, sans qu’il n’y ait rien de mystique dans ce cas.
Le 3 février 2024, un mémoire intitulé Les Foyers de charité ont une histoire cachée est présenté par Thierry Coustenoble, ancien secrétaire général des Foyers de charité. Il montre que la doctrine des Foyers de charité vient de deux femmes méconnues (Marie-Ange Merlier et Émilie Blanck), avant d’être reprise à son compte par Marthe.
Le 18 mars 2024, se produit la démission des membres de la « Commission d’enquête sur les Foyers de charité », dont un membre, Marie-Jo Thiel, révèle avoir des témoignages d’abus de pouvoir (spirituels ou sexuels) dans pratiquement tous les Foyers. Le statut des « Pères » placés à la tête des Foyers semble un facteur de risque spécifique. Sont connus 143 témoignages de victimes, notamment d’anciens élèves de l’école de Châteauneuf et de participants aux retraites de l’œuvre de charité.
Une analyse chronologique
Le 28 mars 2024, paraît Marthe Robin ou le secret de famille, du Dr Élisabeth Chevassus. L’auteur se livre à une recherche précise des faits à partir des registres de l’état civil. Son analyse chronologique montre des contradictions dans le discours hagiographique habituel sur Marthe. Certaines des suppositions avancées par l’auteur sont intéressantes, sur des coïncidences chronologiques ayant eu un impact psychique pathogène. D’autres semblent des extrapolations plus aventurées, comme l’hypothèse d’un avortement qui aurait été imposé à Marthe par ses parents.
Le 14 janvier 2025, une nouvelle commission d’enquête sur les Foyers de charité est créée. Un des membres, Florian Michel, professeur d’histoire à la Sorbonne, s’interroge sur les abus en tant qu’ils seraient dérivés mimétiquement d’un schème initial, celui des cas de Marthe et du père Finet. Il tient compte des conclusions des enquêtes publiées ces dernières années : celle de la Ciase, celle sur Jean Vanier, celle des Frères de Saint-Jean. Dans chacun de ces rapports, Marthe apparaît en toile de fond. Florian Michel remarque qu’un certain nombre de théologiens pervers ont cherché à Châteauneuf-de-Galaure une validation.
Florian Michel révèle les noms d’une demi-douzaine de pères de Foyers de la première génération identifiés comme « abuseurs » faisant plus de cent victimes : Georges Finet, père fondateur de l’œuvre à Châteauneuf-de-Galaure ; André Van der Borght, père fondateur du Foyer de Tressaint ; Michel Tierny, père fondateur du Foyer de Courset ; René Bonnafous, père fondateur du Foyer de Roquefort-les-Pins ; Henri Oury, père fondateur du Foyer de Spa en Belgique ; Michel Blard, père du Foyer de Baye.
Un panorama plus vaste
Le dossier est complexe et justifie que le procès de canonisation de Marthe soit actuellement en pause, selon les délégués pontificaux, sans être formellement arrêté. Florian Michel déclare :
« Il ne s’agit pas de refaire l’enquête sur Marthe Robin – le matériau est déjà ample, une enquête de canonisation est en cours avec un dossier de 14 000 pages, il y a aussi les travaux de Conrad De Meester, de Joachim Bouflet, de Thierry Coustenoble, les réponses que ces travaux ont suscitées… – mais de l’inclure dans un panorama plus vaste, une histoire institutionnelle des Foyers, de leur fondation dans les années 1930 jusqu’aux années 2000. »
Il faut reconnaître le bien spirituel qui s’est fait (et qui se fait toujours) dans les Foyers de charité depuis leur fondation. Il faut se réjouir des dévouements qu’ils ont suscités, notamment ceux des équipes de permanents qui les animent, ainsi que des grâces qui ont été reçues dans les Foyers à l’occasion des diverses retraites.
Cependant les enquêtes du père Conrad De Meester, de Céline Hoyeau, de Joachim Bouflet, et (avec certaines réserves) du Dr Chevassus, convergent de façon impressionnante sur le plan des faits. Avec des explications parfois différentes, elles établissent l’absence ou la non-surnaturalité des « phénomènes ».
Elles relèvent aussi que Marthe a cautionné les déficiences de la prédication du père Finet relevées plus haut, et qu’elle a beaucoup contribué, à l’occasion du suicide de son frère, à donner une large diffusion à la thèse de la prétendue « illumination finale ».
Cette thèse (avec diverses variantes) soutient que, à l’instant précédent, ou dans l’instant même de la mort, toute âme bénéficie d’un contact avec Dieu, qui la met en position de faire un choix pour ou contre lui. Le père Pius Noonan, o.s.b., dans L’Option finale dans la mort : Réalité ou mythe ? ( « Croire et Savoir », Téqui, 2016), a montré que cette thèse était dénuée de tout fondement théologique.
Une mise au point salutaire
Le mouvement des révélations et des mises au point qui s’accomplit sur ce dossier est salutaire. Il illustre l’importance d’une solide crédibilité, fondée sur des enquêtes médicales et canoniques indubitables, pour l’acceptation de « phénomènes extraordinaires » et des doctrines qu’ils prétendent accréditer. Il montre aussi que la crédulité en matière d’apparitions privées – récurrente chez les personnes pieuses – peut être un contre-témoignage pour l’Église.
> Lire le dossier réponse avec François-Xavier Clément et Yves Chiron : « Marthe Robin : La vérité nous rendra libres »
>> à lire également : Éditorial du Père Danziec | Dieu donnera la victoire !