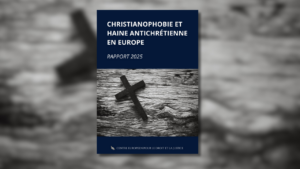En ce 21 novembre, nous fêtons la « journée mondiale de la télévision ». Le petit écran en s’introduisant invinciblement dans les maisons ces soixante dernières années est parvenue à modifier jusqu’à la société elle-même. Retour sur ces changements anthropologiques.
À la suite des régimes communistes qui ont usé et abusé de cet instrument, on a noté le rôle de renforcement, de centralisation des États, de propagande, même si l’apparition des télévisions privées a changé la donne. On a pu alors pointer, pour la dénoncer, l’utilisation mercantile, conduisant à un asservissement – après celui des régimes totalitaires – des individus devenus des consommateurs passifs, par le biais de publicités de plus en plus invasives.
Pourtant, au milieu de cela, les catholiques purent se réjouir rapidement de suivre la messe dominicale en direct (la première au monde fut la retransmission de la messe de Noël de 1948 de Notre-Dame de Paris) et, bien sûr, les bénédictions urbi et orbi du Pape. Des théologiens écrivirent d’ailleurs sur ce fait providentiel : par la télévision, l’évêque de Rome deviendrait l’évêque du monde. Là aussi, des relents de centralisation…
On ne saurait non plus nier, pour en revenir à un plan profane, que la télévision et sa sœur aînée la radio ont participé à une diffusion plus large, jusque chez les illettrés, des trésors de la culture et des sciences.
Le petit écran trône dans le salon
Changeons de focale, afin de ne pas négliger un autre changement anthropologique et culturel de la télévision : le bouleversement de l’espace familial. On ne saurait en effet, à la suite des remarques précédentes, ne considérer que les caractéristiques à grande échelle, le point de vue des concepteurs et des dirigeants des chaînes et des programmes. Il faut aussi se tourner vers les récepteurs et, disent les sociologues, vers le cadre privilégié de cette réception, le cadre familial. Le sociologue britannique David Morley a, le premier, attiré l’attention sur ce « paradigme familial » et sur les conflits que la télévision y a introduits ou auxquels elle a donné une dimension nouvelle.
Commençons par regarder l’espace de vie – salle de séjour et/ou à manger – où l’écran de télévision a pris place. Qui d’entre nous ne note, entrant dans l’une de ces pièces, la présence ou l’absence du dit objet, sa taille, sa modernité, son habillage : en définitive, trône-t-il dans la pièce ? ou le cache-t-on plus ou moins ? Qu’est-ce que cela révèle de sa fonction ordinaire dans la famille ? Nous pourrions tous citer des configurations très différentes les unes des autres, et avouer les conclusions ou jugements que nous en avons tirés. Ils auront été confirmés ou infirmés, éventuellement, par le récit des pratiques, celles des enfants et celles des parents.
La télévision impose ses représentations
Le poste de télévision est devenu peu ou prou, en beaucoup de familles, un personnage, avec lequel on échange peu, mais qui parle beaucoup, devant lequel tous se taisent. Et que dit-il ? Que montre-t-il ? Le monde, en tout cas une diversité de situations, d’opinions, des personnes que les relations « physiques » de tous les membres, même les plus étendues, ne pourraient pas par elles-mêmes faire entrer dans le salon familial.
Mais le constat ne s’arrête pas là. Hélas, les éducateurs le savent, par le biais des programmes télés en prime time, entre plus particulièrement ce ou celui à qui on aurait justement barré l’entrée s’il s’était présenté à la porte, le jugeant inconvenant ou infréquentable, inaudible ou scandaleux, ou – plus simplement – estimant peu prudent qu’il soit vu ou entendu, à ce stade de leur croissance et de leur maturation, par les enfants.
Schématisons quelque peu : Autrefois, le père de famille chrétien, ou la mère, le soir venu, lisait la Bible, la vie des saints ; le paterfamilias élargissait le cercle aux employés, aux journaliers. Les générations se rencontraient et, pensait-on, communiaient dans les mêmes pensées, la même foi, le même imaginaire quand le livre était remplacé par un conteur qui avait pris place près de l’âtre.
C’est à la télévision qu’ont échu cette dignité et cette responsabilité. La perte de maîtrise qui y en a résulté a conduit à ces conflits évoqués, entre générations, entre hommes et femmes, sur les plans politiques, sociétaux, culturels, comme sur ceux de la sensibilité et des représentations symboliques.
L’urgence d’une tempérance télévisuelle
Tant que la télévision était d’État, un certain conservatisme, allié à celui, semblable, de l’Éducation nationale, accompagnait les parents ou ne contrariait pas trop frontalement les lignes de force de ce qu’ils voulaient pour leur progéniture. La libéralisation, la privatisation, la mercantilisation de la télévision, se sont jointes aux orientations contestables de l’enseignement public, et à sa déliquescence, faisant de la vertu de tempérance télévisuelle un impératif et une urgence. D’autant qu’actuellement – après la propagande d’Etat et l’alliance du loisir et du profit… qui n’ont pas cessé – se développe un phénomène dont on ne peut que s’inquiéter dans le cadre de ce paradigme familial : l’industrie des séries, l’addiction qu’elles développent aujourd’hui, le fatras émotionnel, sociétal et imaginaire qu’elles véhiculent.
Et pourtant, hier, comme aujourd’hui, quelques perles d’intelligence, de beauté, de saine curiosité, sont offertes au plus grand nombre par la télévision. Puissent-elles, selon la parole évangélique, ne pas être jetées aux cochons !
A lire également : La tolérance, un mot valise à éclaircir – L’Homme Nouveau