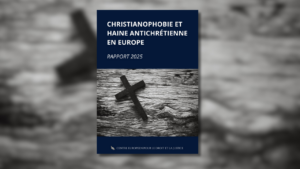Après l’avortement inscrit dans la Constitution, c’est désormais la fin de vie qui entre dans le champ des libertés encadrées par la loi et est débattue par le Sénat à partir de ce mois de septembre. Gérard Mémeteau, professeur émérite de droit, décrypte les implications du texte porté par le député Falorni : création d’un nouveau délit pour ceux qui chercheraient à dissuader, limitation des recours juridiques, rôle élargi des associations.
Sauf erreur, la première proposition de loi « relative au droit de vivre sa mort » fut déposée le 6 avril 1978 par le sénateur Henri Caillavet (cf. entretien, Tonus, 1-6 mai 1978). On relève ultérieurement la proposition n° 166, Sénat, 26 janvier 1989, de MM. Biarnès, d’Attilio et autres, « relative au droit de mourir dans la dignité », la loi belge du 28 mai 2002 « relative à l’euthanasie », la loi luxembourgeoise du 10 mars 2009 « réglementant les soins palliatifs ainsi que l’euthanasie et l’assistance au suicide », la loi des Pays-Bas du 1er avril 2002. On prend note du droit canadien récent (voir P-L. Turcotte et T. Lemmens : « La normalisation troublante de la mort médicalement administrée au Québec et au Canada : état des lieux », rapport Aporia, 2024, vol.16), révélant « la hausse fulgurante de la pratique au Canada et au Québec » et les risques des dérives et d’élargissement des conditions d’application de la loi. D’autres États ont adopté des législations libérales.
Des textes peu clairs
On ne peut isoler en France des jurisprudences permissives. Si la cour d’assises des Pyrénées-Atlantiques acquitte le 25 juin 2014 le docteur Bonnemaison, c’est parce que son intention homicide n’est pas établie (il y aura radiation par l’ordre des médecins, Dalloz 2015, p. 81), et les arrêts jugeant les cessations de traitements (d’abord l’affaire Vincent Lambert) ne s’écrivent pas sur les pages du suicide assisté ni de l’euthanasie, quoique des évocations de celle-ci traversent le « dossier Lambert » et qu’il s’agit de décider des arrêts de soins provoquant le décès. La mort est bien au chevet du malade, mais diagnostiquée et non provoquée, dans la distinction entre les soins ordinaires et les soins extraordinaires (cf. Ch. Hennau-Hublet : L’activité médicale et le droit pénal, Bruylant, 1987, préface J. Verhaegen, p. 51 ; Pie XII, allocution du 24 novembre 1957, in Le Corps humain, Desclée, 1960, p. 527)… Les temps actuels ont vu le suicide assisté et l’euthanasie reconquérir l’espace…