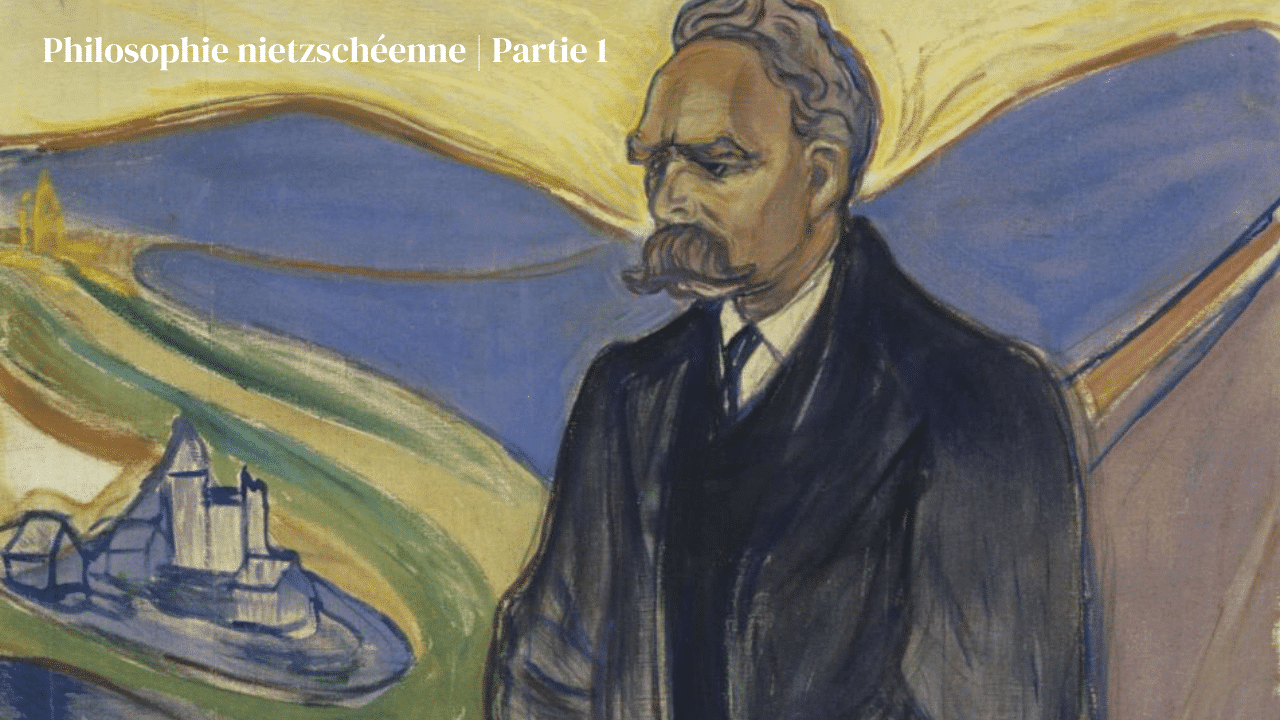Depuis quelques décennies, devant la décadence, voire l’effondrement progressif des sociétés occidentales et, notamment, de la France, certains courants de pensée prétendant faire école vont chercher chez Nietzsche les principes de leur analyse et en appellent à ces mêmes principes pour sortir de la crise de civilisation. Premier volet de notre présentation de la philosophie nietzschéenne *.
Nul ne contestera la légèreté et l’élégance de la plume de Nietzsche maniant un style tantôt ironique tantôt sibyllin et servant un propos souvent subtil et incisif ; on touche là, d’ailleurs, la raison de la séduction exercée au premier abord par son œuvre. Mais, précisément, cette séduction, en bonne part esthétique, n’en incite que davantage à examiner rationnellement son discours.
Disons tout de suite que Nietzsche, en raison même de la généalogie et du procès de la raison qu’il conduit, n’est pas un penseur systématique ; pour le parodier nous dirions qu’il laisse la systématicité aux esprits lourds et « allemands ». En revanche, il est loisible de dégager de ses œuvres un certain nombre d’assertions universelles commandant ses propos. Essayons simplement ici d’en manifester quelques-unes et d’y réfléchir.
La première est le « biologisme » : application à l’homme et à sa conduite d’un modèle d’explication animal, voire végétal, Nietzsche lui-même dirait « physiologique ». En effet, à ses yeux, l’homme est un animal mû par une force inconsciente qui traverse et anime le règne vivant (Par-delà bien et mal, § 259, trad. C. Heim, éd. Gallimard, 1971), voire commande le devenir de tout ce qui est : la volonté de puissance. Proche de l’instinct, cette force aveugle tend à s’épancher en engendrant des individus toujours plus forts. Elle pousse l’animal à agresser, dominer, opprimer, marquer de ses griffes son environnement et ses congénères (loc. cit.) afin de se conserver et, davantage, d’augmenter sa puissance en s’affirmant.
Des hommes faibles
Aussi, la conscience réfléchie et la raison ne sont ni des données originelles de la condition humaine ni des capacités essentielles de l’homme. Elles sont apparues au cours du développement de la civilisation qui a conduit les hommes – au demeurant, pour la plupart d’entre eux, faibles, c’est-à-dire incapables de s’affirmer – à refouler leur énergie au lieu de s’en servir en l’extériorisant (Généalogie de la morale, 2e Dis., § 16, trad. I. Hildenbrand et J. Gratien, éd. Gallimard, 1971). Par suite, ces mêmes hommes – torturés par ce refoulement – ont transformé leur impuissance en vertu.
Ce faisant, ils se sont justifiés en culpabilisant les forts voulant les dominer ; écoutons Nietzsche : « Et si les agneaux se disent entre eux “ces oiseaux de proie sont méchants, et celui qui est aussi peu que possible un oiseau de proie, qui en est même le contraire, un agneau, celui-là ne serait-il pas bon ?”, il n’y a rien à redire à cette façon d’ériger un idéal, si ce n’est que les oiseaux de proie regarderont tout cela d’un œil quelque peu moqueur, et se diront peut-être : “nous ne leur en voulons pas du tout, à ces bons agneaux, nous les aimons même : rien n’est plus savoureux qu’un tendre agneau”. » (op. cit., 1ère Dis., § 13).
Cette justification de l’impuissance des faibles, « des agneaux », se double d’une vengeance dans l’imaginaire – ce que Nietzsche nomme le « ressentiment » (op. cit., § 10-11) – à l’encontre de ces mêmes hommes forts.
Ce développement morbide de l’intériorité engendrant la morale a débuté avec Socrate et, triomphant avec le christianisme, a conduit l’espèce humaine – dont certains des membres étaient à l’origine des animaux forts et conquérants – à devenir un troupeau d’animaux faibles et craintifs : des moutons (Par-delà bien et mal, § 199).
Ayant amené au jour, par la « généalogie de la morale » précédente, la nature originelle de l’homme et diagnostiqué la maladie qui l’affecte, Nietzsche appelle à « transvaluer les valeurs » communes en faisant de l’affirmation de soi, de la dureté et de la force les valeurs suprêmes, second principe. Qui fera ainsi dépassera l’homme et l’homme tel qu’il est devenu, en ce sens un tel homme deviendra un « surhomme ».
Ainsi l’homme fort – non par ses attributs physiques, on l’aura compris, mais par son énergie intérieure et sa volonté de s’affirmer – se distingue du troupeau en créant ses valeurs et en réalisant ses buts, quels que soient la nature de ces derniers, les moyens utilisés et les conséquences de ses actes sur autrui, ce pourquoi le dernier chapitre d’Ainsi parlait Zarathoustra invective la pitié comme le « dernier péché » réservé à « l’homme supérieur » (trad. M. Robert, U.G.E., 1958, p. 309).
Un immoralisme total
Au nom d’une morale supérieure, Nietzsche justifie donc un immoralisme total, voire même un amoralisme radical, puisque chacun devient non seulement le principe et la mesure du bien et du mal, mais l’objet et le but même de ses actions. L’homme est de la sorte, comme l’indique le titre de l’une de ses œuvres, Par-delà bien et mal.
Enfin, rapportant toutes choses à la volonté de puissance, Nietzsche subordonne la connaissance à la vie – identifiée à cette volonté – et rejette la vérité entendue comme l’attribut d’un jugement adéquat aux choses mêmes, troisième principe. Il ne s’agit donc pas de régler son jugement sur les choses telles qu’elles sont – la pensée ne pouvant atteindre d’autre réalité que celle des instincts (Par-delà bien et mal, § 36) – mais de se demander « dans quelle mesure un jugement est apte à promouvoir la vie, à la conserver, à conserver l’espèce, voire à l’améliorer, […] » (Par-delà bien et mal, § 4).
Ainsi le réductionnisme biologique, l’exaltation de l’individu au mépris de la moralité commune et le rejet de la relation nécessaire entre une connaissance vraie et la réalité des choses sont-ils des thèmes récurrents du discours nietzschéen. Qu’en penser ?
Réduire la vie à la volonté de puissance et l’homme à un animal est purement et simplement faux – fausse aussi la réduction du monde à « un monstre de puissance » (Fragments posthumes, Automne 1884-Automne 1885, trad. M. Haar et M. B. de Launay, Gallimard, 1982, pp. 343-344). D’abord, l’on ramène ainsi le comportement animal et la vie à l’agression et à la domination – alors que l’animal n’agresse que pour se conserver et que bon nombre d’animaux sont sociaux – ; ensuite l’on réduit l’homme à un animal, or l’homo sapiens, dès l’origine, présente une différence essentielle d’avec tous les autres êtres vivants.
En effet, fabriquant des objets, inventant des signes et pratiquant des rites religieux – ce que manifestent les ouvrages de Leroi-Gourhan Le Geste et la Parole, Les religions de la préhistoire –, l’homo sapiens est indéniablement doué d’intelligence et de raison.
L’amoralisme et l’exaltation de l’individu sont des assertions à la fois fausses et dangereuses. Fausses, car il existe à l’évidence et objectivement des fins et des actes bons : se conserver, procréer et élever ses enfants, chercher la vérité, ne pas léser autrui et exercer bienveillance et justice à son égard. Dangereuses, puisque, au nom de l’affirmation de soi, les actes mauvais et ceux qui sont dépourvus de tout égard pour autrui, procédant de la méchanceté et de la cruauté, sont justifiables ou, pire encore, n’ont pas besoin de justification si ce n’est celle d’être « l’œuvre » de « l’homme supérieur ».
Une force inconsciente
Le rejet du rapport essentiel de la connaissance humaine à la réalité extérieure et le déport du critère d’évaluation d’un jugement, de l’adéquation au réel à la promotion de la vie, détruit le principe régulateur de la connaissance et subordonne la pensée à une force inconsciente, ainsi Nietzsche prétend-il que « la majeure partie de la pensée consciente doit être imputée aux activités instinctives, […] » (Par-delà bien et mal, § 3) ; ce qui, appliqué à sa propre pensée, la dépouille de toute valeur de connaissance !
Interrogeons-nous pour terminer. Peut-on reconstruire une société humaine ordonnée et digne de ce nom en faisant de l’homme un animal et de sa conscience réfléchie un avatar pathologique, en exaltant l’orgueil de chacun le proclamant par-delà bien et mal et en subordonnant le jugement humain à l’instinct ? La société politique ne requiert-elle pas, au contraire, raison et conscience morale permettant, d’une part, d’établir des critères d’évaluation objectifs partageables par tous et visant le bien commun et, d’autre part, de tenir un discours vrai – lui aussi compréhensible et partageable par autrui – car conforme aux choses telles qu’elles sont ?
* Retrouvez notre série sur Nietzsche :
- Nietzsche : du biologisme par l’amoralisme à la subversion de la notion de vérité
- L’antichristianisme de Nietzsche : haine, mystifications et confusion (1)
- L’antichristianisme de Nietzsche : haine, mystifications et confusion (2)
- Nietzsche : Généalogie historique ou continuités illusoires ?
- Nietzsche : Le surhomme, du dépassement du nihilisme par l’exaltation de soi au désespoir solitaire
>> à lire également : Augusto del Noce, un penseur pour notre temps