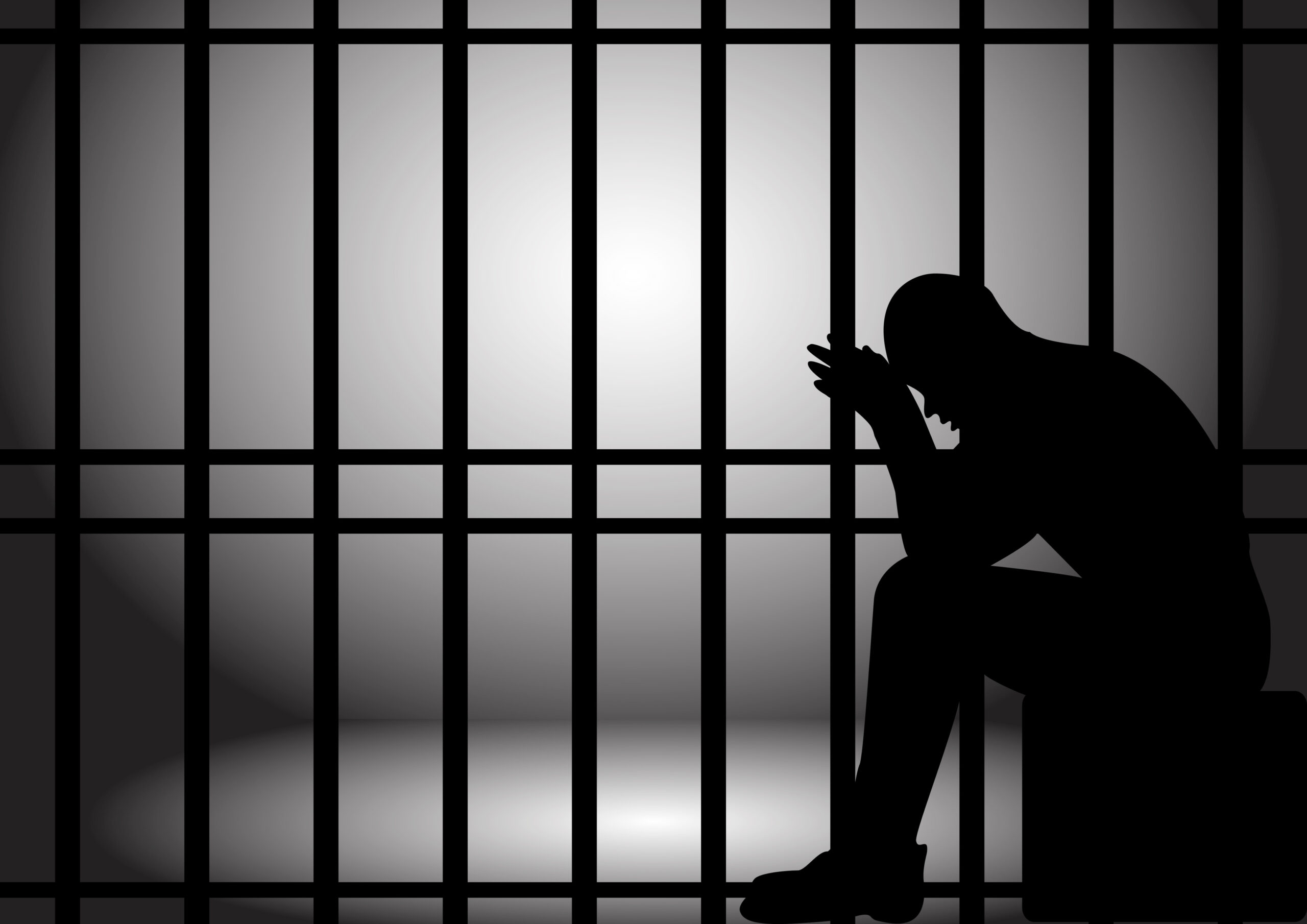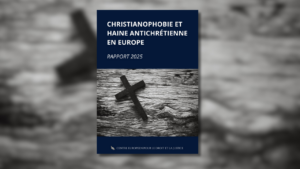Alors qu’Emmanuel Macron envisage de louer des places de prison à l’étranger face à la surpopulation carcérale, la question de la place de l’aumônerie catholique dans les prisons françaises ressurgit.
En 2010, les termes « sacrement » et « pastorale », d’origine catholique, ont été effacés du code de procédure pénale consacré aux aumôneries. Si l’évolution du vocabulaire administratif est expliquée par l’émergence des minorités religieuses (musulmanes, juives, protestantes, orthodoxes, bouddhistes…), peut-on toutefois aller jusqu’à évoquer un recul du catholicisme dans les lieux de culte en milieu carcéral ?
L’article 26 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 défend la liberté de cultes pour les prisonniers : « Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement ».
Cette liberté de cultes, qui existe aussi bien dans les hôpitaux, que dans les prisons et l’armée, s’explique notamment par l’héritage laissé par le christianisme. Historiquement, l’Église s’est toujours mobilisée dans les prisons. Il y a 406 ans, le 8 février 1619, saint Vincent de Paul est le premier prêtre nommé aumônier des galères par le roi Louis XIII. Il a pour objectif d’améliorer les conditions de vie des galériens et de les accompagner spirituellement. Dans l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (25, 35-36), il est même expressément écrit : « […] j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi ! »
Il est donc inscrit dans la tradition chrétienne de rendre visite aux prisonniers. Du côté des établissements de santé publics, la relation intime entre l’Église et les hôpitaux existe depuis le Moyen Âge puisque c’était les membres du clergé qui les administraient. C’est en 1905 qu’une loi sépare totalement les Églises de l’État. De là, l’État cesse de financer l’Église, sauf dans les lieux clos où il n’est pas possible pour les personnes de sortir pour pratiquer leur foi.
Les prisons sont tenues de permettre la célébration du culte une fois par semaine. Dû à l’accroissement de la population carcérale d’origine musulmane, l’État a mis en place un financement équivalent pour l’islam, bien que ce financement trouve tout d’abord son origine dans l’héritage chrétien. Néanmoins, si la visite de prison est prévue dans la doctrine de l’Église, ce n’est pas le cas pour l’islam, où il est difficile de trouver des personnes pour assurer l’aumônerie. L’Église considère bien que cela fait partie de sa charge d’accompagner les prisonniers dans leur spiritualité.
Par ailleurs, depuis 1988, pour contrer la pénurie de prêtres, elle a autorisé les laïcs et les religieuses à devenir aumôniers de prison. Aujourd’hui, tous ces privilèges accordés à la religion sont remis en cause pour plusieurs raisons. D’une part, les établissements ne bénéficient pas tous du même traitement. À la centrale d’Ensisheim, l’accompagnement des 200 détenus est assuré par quatre aumôniers catholiques, tandis qu’un détenu du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville relate qu’« il a fallu se battre pendant deux ans et demi pour que les détenus qui le souhaitent puissent accéder au culte catholique de manière hebdomadaire ».
D’autre part, il est aussi fréquent que le personnel carcéral « manque de vigilance» à l’heure du culte, privant les détenus de pratiquer leur foi. De nombreux témoignages mettent aussi en lumière le manque de neutralité du service public de certains surveillants, qui délaissent les croyants, les laissant pour compte.
>> à lire également : Prison 4/4 : La miséricorde divine révélée aux prisonniers